mardi, février 28, 2006
Un taxi pour Tobrouk.
 Les éditons Atlas sortent la collection Ventura, le premier numéro est à 3.00 € : un occasion à ne pas rater… "Désert de Libye, 1942. Égarés dans le désert, quatre soldats des Forces Françaises Libres s’emparent d’un blindé de l’Afrika Korps. Ils font prisonnier son officier allemand qui attire bientôt leur sympathie, à mesure qu’ils doivent survivre ensemble, pris constamment entre deux feux… Un Taxi pour Tobrouk (Fr.-GB-Esp. 1961) de Denys de la Patellière, ce grand classique du cinéma français populaire "de qualité", n’a pas pris une ride. Mieux, sa vigueur semble inaltérable et on ne s’ennuie pas une seconde au cours des 88’ que dure approximativement le film en vidéo. On l’a vu récemment au milieu d’un public d’âge et de culture très variés, en partie composé de professionnels mais aussi de public "normal" : eh bien les réactions étaient, tout compte fait, sans doute assez proches de celles que le film devait provoquer dans une salle de boulevard de 1961, signe évident de sa valeur intemporelle - celle qui caractérise les classiques authentiques. On fut donc admiratif devant la beauté – enfin restituée telle qu’en elle-même après tant d’années de recadrage ignoble par la télévision - de la photographie en DyaliScope N&B. du grand Marcel Grignon et de son chef-opérateur Charles-Henri Montel. La mise en scène de Denys de la Patellière (ici assisté de Pierre Granier-Deferre) est sobre, agrémentée de courts mouvements de grues limités strictement à la révélation d’un détail ou à la nécessité de l’avancement du récit, et traduit une merveilleuse capacité à rendre l’isolement du petit groupe dans le désert de jour comme de nuit mais aussi à filmer un aspect toujours nouveau de ce même désert. Ce qui pourrait sembler le même change tout le temps : psychologie et décors se dynamisent réciproquement et admirablement. Une mise en scène équilibrée mais qui atteint régulièrement une virtuosité digne d’un Anglais ou d’un Américain de la même époque sans effort ! On fut non moins admiratif du dialogue signé Michel Audiard dont c’était l’âge d’or authentique : ni trop vulgaire, ni trop racoleur, souvent aussi profond que brillant, hésitant entre chaleur humaine et cynisme, argot populaire et réflexions philosophiques de haute volée, rendues bien compréhensibles pour un "grand public". On le fut naturellement à nouveau du jeu des grands comédiens principaux : Lino Ventura, Maurice Biraud, Hardy Krüger, Charles Aznavour tous remarquables d’authenticité, de chaleur et de vérité humaine. Seul German Cobos paraît un peu empesé et monolithique mais c’est aussi son rôle qui le veut et il le sert à la perfection, doublé en post-synchro par … Marcel Bozzufi, l’un des meilleurs acteurs français d’une part et l’un des meilleurs doubleurs français de films étrangers de l’autre, mais aussi – la preuve – utilisé comme post-synchronisateur par ses propres compatriotes. Le scénario est charpenté et minuté comme celui d’un film de John Ford et le plan final – une superposition classique pourtant – est magnifique de puissance lyrique. Qui n’a pas vu Un Taxi pour Tobrouk ne connaît pas vraiment le cinéma français dans ce qu’il a de plus classique mais aussi, peut-être, de plus universel. "
Les éditons Atlas sortent la collection Ventura, le premier numéro est à 3.00 € : un occasion à ne pas rater… "Désert de Libye, 1942. Égarés dans le désert, quatre soldats des Forces Françaises Libres s’emparent d’un blindé de l’Afrika Korps. Ils font prisonnier son officier allemand qui attire bientôt leur sympathie, à mesure qu’ils doivent survivre ensemble, pris constamment entre deux feux… Un Taxi pour Tobrouk (Fr.-GB-Esp. 1961) de Denys de la Patellière, ce grand classique du cinéma français populaire "de qualité", n’a pas pris une ride. Mieux, sa vigueur semble inaltérable et on ne s’ennuie pas une seconde au cours des 88’ que dure approximativement le film en vidéo. On l’a vu récemment au milieu d’un public d’âge et de culture très variés, en partie composé de professionnels mais aussi de public "normal" : eh bien les réactions étaient, tout compte fait, sans doute assez proches de celles que le film devait provoquer dans une salle de boulevard de 1961, signe évident de sa valeur intemporelle - celle qui caractérise les classiques authentiques. On fut donc admiratif devant la beauté – enfin restituée telle qu’en elle-même après tant d’années de recadrage ignoble par la télévision - de la photographie en DyaliScope N&B. du grand Marcel Grignon et de son chef-opérateur Charles-Henri Montel. La mise en scène de Denys de la Patellière (ici assisté de Pierre Granier-Deferre) est sobre, agrémentée de courts mouvements de grues limités strictement à la révélation d’un détail ou à la nécessité de l’avancement du récit, et traduit une merveilleuse capacité à rendre l’isolement du petit groupe dans le désert de jour comme de nuit mais aussi à filmer un aspect toujours nouveau de ce même désert. Ce qui pourrait sembler le même change tout le temps : psychologie et décors se dynamisent réciproquement et admirablement. Une mise en scène équilibrée mais qui atteint régulièrement une virtuosité digne d’un Anglais ou d’un Américain de la même époque sans effort ! On fut non moins admiratif du dialogue signé Michel Audiard dont c’était l’âge d’or authentique : ni trop vulgaire, ni trop racoleur, souvent aussi profond que brillant, hésitant entre chaleur humaine et cynisme, argot populaire et réflexions philosophiques de haute volée, rendues bien compréhensibles pour un "grand public". On le fut naturellement à nouveau du jeu des grands comédiens principaux : Lino Ventura, Maurice Biraud, Hardy Krüger, Charles Aznavour tous remarquables d’authenticité, de chaleur et de vérité humaine. Seul German Cobos paraît un peu empesé et monolithique mais c’est aussi son rôle qui le veut et il le sert à la perfection, doublé en post-synchro par … Marcel Bozzufi, l’un des meilleurs acteurs français d’une part et l’un des meilleurs doubleurs français de films étrangers de l’autre, mais aussi – la preuve – utilisé comme post-synchronisateur par ses propres compatriotes. Le scénario est charpenté et minuté comme celui d’un film de John Ford et le plan final – une superposition classique pourtant – est magnifique de puissance lyrique. Qui n’a pas vu Un Taxi pour Tobrouk ne connaît pas vraiment le cinéma français dans ce qu’il a de plus classique mais aussi, peut-être, de plus universel. "dimanche, février 26, 2006
But where is Damoon ? (Part 1-1978)
vendredi, février 24, 2006
Quel con.
Elle chaloupait devant moi en me lançant des œillades suggestives. Je la rejoins sur la piste, on danse collés l’un à l’autre et "je lui propose de la raccompagner chez elle". Et elle me sort : "Attends, j’appelle ma copine !" J’ai dit "oui bien sûr" et je me suis retrouvé sur le périph à 4 heures du matin pour ramener deux inconnues qui habitaient à 40 Km de chez moi.
Quand j’ai proposé de "partir tout seul une semaine avec les enfants". Elle a dit oui.
Quand j’ai hurlé "La chenille ! La chenille ! " Debout sur la galette en velours rouge de ma chaise Louis XVIII, au mariage très collet monté du frère de ma copine. 250 paires d’yeux se sont braquées sur moi. Depuis, toute la famille de ma promise me prend pour un plouc.
Pour faire rire ma fiancée, j’ai crié : "Plus vite !" à la grande roue de la foire des tuileries. Le forain (retors) nous a fait faire quelques tours de plus. Et là, elle a été malade.
Quand j’ai proposé de "partir tout seul une semaine avec les enfants". Elle a dit oui.
Quand j’ai hurlé "La chenille ! La chenille ! " Debout sur la galette en velours rouge de ma chaise Louis XVIII, au mariage très collet monté du frère de ma copine. 250 paires d’yeux se sont braquées sur moi. Depuis, toute la famille de ma promise me prend pour un plouc.
Pour faire rire ma fiancée, j’ai crié : "Plus vite !" à la grande roue de la foire des tuileries. Le forain (retors) nous a fait faire quelques tours de plus. Et là, elle a été malade.
"Avez-vous lu "Figures II" de Jean Genet ?" Avec cette référence, je pensais impressionner la jeune étudiante en lettres modernes (terriblement excitante) qui me tenait le crachoir depuis cinq bonnes minutes. Sa réponse m’a pris de court : "Non, moi j’ai lu "Figures II" de Gérard Genette". A peine le temps d’ajouter : "Heu…oui Gérard bien sur" Elle avait déjà tourné les talons.
"Faites ce que vous voulez" Le coiffeur de Formentera m’a donc fait la coupe de Dracula et ma copine a ri pendant dix jours en me regardant.
Quand j’ai parié bêtement "Je finis la bouteille de Vodka" Je l’ai bue cul sec, au lieu de passer une très bonne soirée avec une bombe blonde, j’ai dû rentrer illico et mon lit a essuyé une tempête force 6.
"Passe boire un verre à la maison", ma femme sera ravie de faire ta connaissance C’est ce que j’ai dit à un ami que je n’avais pas vu depuis dix ans. Il est venu. Six mois plus tard, ma femme m’a quitté et elle est partie vivre avec lui.
Pour impressionner une inconnue, j’ai crié "Banco" au Casino, sans connaître la règle du jeu. Ca m’a coûté 2000 euros.
Quand je lui ai demandé "Qu’est ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ? " Elle a répondu "Un tête-à-tête aux chandelles" Or moi ça faisait un mois que j’essayais de mettre sur pied un anniv surprise avec trente copains.
"Tu aimes ça salope ! " Nous étions en pleins câlins et je ne sais pas ce qui m’as pris quand j’ai dit ça, Depuis ce soir là , si je ne la traite pas de chienne, de pute elle s’arrête net en pleine action en criant "Mais dis quelque chose."
"On s’est déjà rencontrés non ? " Je m’adressais à une jolie brune, un peu exubérante. Elle a répondu Oui, j’ai avorté de toi quand j’avais 17 ans.
"Ecoute ma chérie, on va pas y passer la journée, prends ce que tu veux !" Nous étions depuis deux heures dans une boutique de fringues immense. Elle a choisi un tout petit sac qui m’a semblé modeste jusqu’au moment de passer en caisse "350 € Monsieur S’il vous plait"
"Tu peux m’appeler à n’importe quel moment" J’aurais pas du employer cette formule avec ma maîtresse. Une nuit où j’avais laissé mon portable allumé, ma femme l’a jeté dans les toilettes. C’était un Motorola flambant neuf.
Pour mon anniversaire, elle m’offre mon cadeau, joliment emballé dans un paquet des Galeries Lafayette. Pour plaisanter, je lui lance "C’est pas une cravate au moins ? "
C’était une cravate.
"Faites ce que vous voulez" Le coiffeur de Formentera m’a donc fait la coupe de Dracula et ma copine a ri pendant dix jours en me regardant.
Quand j’ai parié bêtement "Je finis la bouteille de Vodka" Je l’ai bue cul sec, au lieu de passer une très bonne soirée avec une bombe blonde, j’ai dû rentrer illico et mon lit a essuyé une tempête force 6.
"Passe boire un verre à la maison", ma femme sera ravie de faire ta connaissance C’est ce que j’ai dit à un ami que je n’avais pas vu depuis dix ans. Il est venu. Six mois plus tard, ma femme m’a quitté et elle est partie vivre avec lui.
Pour impressionner une inconnue, j’ai crié "Banco" au Casino, sans connaître la règle du jeu. Ca m’a coûté 2000 euros.
Quand je lui ai demandé "Qu’est ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ? " Elle a répondu "Un tête-à-tête aux chandelles" Or moi ça faisait un mois que j’essayais de mettre sur pied un anniv surprise avec trente copains.
"Tu aimes ça salope ! " Nous étions en pleins câlins et je ne sais pas ce qui m’as pris quand j’ai dit ça, Depuis ce soir là , si je ne la traite pas de chienne, de pute elle s’arrête net en pleine action en criant "Mais dis quelque chose."
"On s’est déjà rencontrés non ? " Je m’adressais à une jolie brune, un peu exubérante. Elle a répondu Oui, j’ai avorté de toi quand j’avais 17 ans.
"Ecoute ma chérie, on va pas y passer la journée, prends ce que tu veux !" Nous étions depuis deux heures dans une boutique de fringues immense. Elle a choisi un tout petit sac qui m’a semblé modeste jusqu’au moment de passer en caisse "350 € Monsieur S’il vous plait"
"Tu peux m’appeler à n’importe quel moment" J’aurais pas du employer cette formule avec ma maîtresse. Une nuit où j’avais laissé mon portable allumé, ma femme l’a jeté dans les toilettes. C’était un Motorola flambant neuf.
Pour mon anniversaire, elle m’offre mon cadeau, joliment emballé dans un paquet des Galeries Lafayette. Pour plaisanter, je lui lance "C’est pas une cravate au moins ? "
C’était une cravate.
Elle s’était donné tant de mal pour notre premier dîner chez elle que je me suis enthousiasmé : "J’adore !" Devant cette bouillie rouge recouverte de grumeaux. J’en ai tous les dimanches depuis deux ans.
Un soir, en rentrant, je ne trouvais plus mes clefs et j’ai lâché "Sapristi !" en fouillant mes poches. Deux ans plus tard ; elle se fout encore de moi.
Un soir, en rentrant, je ne trouvais plus mes clefs et j’ai lâché "Sapristi !" en fouillant mes poches. Deux ans plus tard ; elle se fout encore de moi.
jeudi, février 23, 2006
Tiens, curieux...
Wc ouverts.
 Le film qui dégouté ma copine de la plongée. Si besoin était, la vision du DVD d’Open water apporte la preuve irréfutable que découvrir un film en salles puis le redécouvrir chez soi peut chambouler les certitudes ressenties lors de la première découverte. Car Open water fait partie de cette race de films qui prennent leur véritable mesure techniquement (la DV, ça a quand même nettement plus de gueule sur support numérique qu’en salles), mais aussi narrativement et émotionnellement, dans le confort d’une seconde "séance". Petit film indépendant bricolé surtout avec beaucoup d’ingéniosité et de courage, Open water n’est en effet pas du tout ce pseudo-thriller aquatique lorgnant à la fois du côté des Dents de la mer (l’incontournable du genre lorsqu’un aileron apparaît sur une affiche) et du Projet Blair witch (pour le côté "d’après une histoire vraie"), comme l’ont fait croire la campagne promotionnelle du film lors de sa diffusion dans divers festivals puis sa sortie couronnée de succès en salles. Si le long métrage de Chris Kentis possède bien quelques séquences de suspense redoutable (l’attaque nocturne des squales, bien que trop courte, possède une efficacité indéniable, renforcée en DVD par le rendement impressionnant de la piste VO DD 5.1 EX, l’EX ayant ici une importance capitale), le sujet du film, une fois qu’on en a découvert le dénouement (attention désormais aux énormes spoilers pour ceux qui n’auront pas encore vu le film), est tout autre qu’un simple survival en mer. Bien loin de l’exercice de style annoncé ou espéré, la seconde vision d’Open water dévoile une œuvre et un regard dur et tragique sur le couple. Le spectateur ayant désormais en tête le destin des deux infortunés héros, les vingt premières minutes du film – montrant de la manière la plus quelconque les prémices du départ en vacances du couple et son intimité tout aussi banale lors de leur dernière nuit (séquences qui apparaissaient comme insupportablement longues au cinéma) – possèdent désormais une connotation émouvante, même si cinématographiquement cela reste toujours bien maladroit. Et une fois en mer, seul aux côtés de Daniel et Susan, on assiste, gêné, mal à l’aise et même presque peiné à l’inexorable échec d’un couple en crise venu resouder leurs liens intimes et qui finira par se retrouver uniquement dans la mort. Alors que, depuis la nuit des temps, le cinéma hollywoodien aime à montrer des couples affrontant les pires obstacles pour finir main dans la main, prêts à repartir pour de nouvelles aventures (le même concept est appliqué à tous les bons buddy movie qui se respectent), Open water dresse le portrait douloureux d’un échec quasi total, non sans avoir joué auparavant durant une petite heure avec les nerfs de ses protagonistes (interprétés par un duo de comédiens excellents) et les nôtres. À l’instar d’une technique de haute tenue, l’édition DVD d’Open water propose des bonus des plus méritants dans leur capacité à cerner de manière concise (même si trop expéditifs dans l’ensemble) le processus de création bien spécifique du film de Chris Kentis. Le jeune réalisateur, justement, on le retrouve aux côtés de sa productrice de femme, Laura Lau, dans un des deux commentaires audio du DVD (VO non sous-titrée dans les deux cas) pour un flot quasi interrompu d’anecdotes de tournage quelque peu atténuées par une valse parfois un peu trop imposante de remarques autosatisfaisantes. L’autre piste commentée permet aux deux acteurs du film, Blanchard Ryan et Daniel Travis, de nous livrer leur expérience forcément fascinante du tournage. Malgré de nombreux blancs (qui auraient finalement justifié la présence d’un montage des deux commentaires), les deux comédiens ont suffisamment d’informations pertinentes (excellent passage où Ryan évoque son aversion pour les requins) pour rendre le commentaire relativement captivant jusqu’au bout… si l'on est un mordu du film. Les sept scènes inédites, dont un début différent et malheureusement non retenu qui aurait placé le film sur le mode du flash-back avec connaissance du dénouement, sont quasi exclusivement consacrées aux relations du couple en vacances la veille de leur expédition sous-marine. Seule une courte séquence de 27s se déroule en plein milieu de l’océan sans que l’on sache vraiment où elle aurait pu figurer dans le récit. Parmi les trois modules vidéo proposés, on ne retiendra pas grand-chose de celui consacré à la recette pour dénicher un bon film indépendant, recette que les grands pontes de Lions Gate Films interviewés semblent connaître sur le bout des doigts, mais qu’ils ont bien du mal (ou simplement fort logiquement pas envie) à dévoiler, restant volontairement très vagues et superficiels. Le court document (moins de 3min) montrant Chris Kentis en plein tournage avec les squales est relativement impressionnant et permet de compenser finalement le manque d’images sur la question du making of. Toutefois, ce dernier est sans aucun doute le bonus le plus intéressant de l’édition, car en moins de 16min il parvient avec un intérêt quasi constant à retracer toute la genèse d’Open water, des débuts amateurs (Kentis et sa femme choisissant leur équipement sur Internet, se renseignant sur les possibilités du numérique…) au dénouement heureux et au triomphe du film (acheté par Lions Gate, plébiscité par bon nombre de critiques américaines, dont Variety…). Open water en DVD n’a vraiment pas la même identité visuelle que Open water en salles. Souffrant d’une diffusion sur support 35mm qui trahissait considérablement le look très spécifique du tournage en DV avec des couleurs peu flashy, un grain trop présent et une définition relativement médiocre, Open water retrouve de sa superbe en DVD. L’image, sans être parfaite, loin de là (un manque de précision évident dans les détails lorsque ça bouge trop), possède désormais des couleurs bien saturées, très vives (les combinaisons du couple en tête), une très belle luminosité, le tout encodé avec un soin manifeste.
Le film qui dégouté ma copine de la plongée. Si besoin était, la vision du DVD d’Open water apporte la preuve irréfutable que découvrir un film en salles puis le redécouvrir chez soi peut chambouler les certitudes ressenties lors de la première découverte. Car Open water fait partie de cette race de films qui prennent leur véritable mesure techniquement (la DV, ça a quand même nettement plus de gueule sur support numérique qu’en salles), mais aussi narrativement et émotionnellement, dans le confort d’une seconde "séance". Petit film indépendant bricolé surtout avec beaucoup d’ingéniosité et de courage, Open water n’est en effet pas du tout ce pseudo-thriller aquatique lorgnant à la fois du côté des Dents de la mer (l’incontournable du genre lorsqu’un aileron apparaît sur une affiche) et du Projet Blair witch (pour le côté "d’après une histoire vraie"), comme l’ont fait croire la campagne promotionnelle du film lors de sa diffusion dans divers festivals puis sa sortie couronnée de succès en salles. Si le long métrage de Chris Kentis possède bien quelques séquences de suspense redoutable (l’attaque nocturne des squales, bien que trop courte, possède une efficacité indéniable, renforcée en DVD par le rendement impressionnant de la piste VO DD 5.1 EX, l’EX ayant ici une importance capitale), le sujet du film, une fois qu’on en a découvert le dénouement (attention désormais aux énormes spoilers pour ceux qui n’auront pas encore vu le film), est tout autre qu’un simple survival en mer. Bien loin de l’exercice de style annoncé ou espéré, la seconde vision d’Open water dévoile une œuvre et un regard dur et tragique sur le couple. Le spectateur ayant désormais en tête le destin des deux infortunés héros, les vingt premières minutes du film – montrant de la manière la plus quelconque les prémices du départ en vacances du couple et son intimité tout aussi banale lors de leur dernière nuit (séquences qui apparaissaient comme insupportablement longues au cinéma) – possèdent désormais une connotation émouvante, même si cinématographiquement cela reste toujours bien maladroit. Et une fois en mer, seul aux côtés de Daniel et Susan, on assiste, gêné, mal à l’aise et même presque peiné à l’inexorable échec d’un couple en crise venu resouder leurs liens intimes et qui finira par se retrouver uniquement dans la mort. Alors que, depuis la nuit des temps, le cinéma hollywoodien aime à montrer des couples affrontant les pires obstacles pour finir main dans la main, prêts à repartir pour de nouvelles aventures (le même concept est appliqué à tous les bons buddy movie qui se respectent), Open water dresse le portrait douloureux d’un échec quasi total, non sans avoir joué auparavant durant une petite heure avec les nerfs de ses protagonistes (interprétés par un duo de comédiens excellents) et les nôtres. À l’instar d’une technique de haute tenue, l’édition DVD d’Open water propose des bonus des plus méritants dans leur capacité à cerner de manière concise (même si trop expéditifs dans l’ensemble) le processus de création bien spécifique du film de Chris Kentis. Le jeune réalisateur, justement, on le retrouve aux côtés de sa productrice de femme, Laura Lau, dans un des deux commentaires audio du DVD (VO non sous-titrée dans les deux cas) pour un flot quasi interrompu d’anecdotes de tournage quelque peu atténuées par une valse parfois un peu trop imposante de remarques autosatisfaisantes. L’autre piste commentée permet aux deux acteurs du film, Blanchard Ryan et Daniel Travis, de nous livrer leur expérience forcément fascinante du tournage. Malgré de nombreux blancs (qui auraient finalement justifié la présence d’un montage des deux commentaires), les deux comédiens ont suffisamment d’informations pertinentes (excellent passage où Ryan évoque son aversion pour les requins) pour rendre le commentaire relativement captivant jusqu’au bout… si l'on est un mordu du film. Les sept scènes inédites, dont un début différent et malheureusement non retenu qui aurait placé le film sur le mode du flash-back avec connaissance du dénouement, sont quasi exclusivement consacrées aux relations du couple en vacances la veille de leur expédition sous-marine. Seule une courte séquence de 27s se déroule en plein milieu de l’océan sans que l’on sache vraiment où elle aurait pu figurer dans le récit. Parmi les trois modules vidéo proposés, on ne retiendra pas grand-chose de celui consacré à la recette pour dénicher un bon film indépendant, recette que les grands pontes de Lions Gate Films interviewés semblent connaître sur le bout des doigts, mais qu’ils ont bien du mal (ou simplement fort logiquement pas envie) à dévoiler, restant volontairement très vagues et superficiels. Le court document (moins de 3min) montrant Chris Kentis en plein tournage avec les squales est relativement impressionnant et permet de compenser finalement le manque d’images sur la question du making of. Toutefois, ce dernier est sans aucun doute le bonus le plus intéressant de l’édition, car en moins de 16min il parvient avec un intérêt quasi constant à retracer toute la genèse d’Open water, des débuts amateurs (Kentis et sa femme choisissant leur équipement sur Internet, se renseignant sur les possibilités du numérique…) au dénouement heureux et au triomphe du film (acheté par Lions Gate, plébiscité par bon nombre de critiques américaines, dont Variety…). Open water en DVD n’a vraiment pas la même identité visuelle que Open water en salles. Souffrant d’une diffusion sur support 35mm qui trahissait considérablement le look très spécifique du tournage en DV avec des couleurs peu flashy, un grain trop présent et une définition relativement médiocre, Open water retrouve de sa superbe en DVD. L’image, sans être parfaite, loin de là (un manque de précision évident dans les détails lorsque ça bouge trop), possède désormais des couleurs bien saturées, très vives (les combinaisons du couple en tête), une très belle luminosité, le tout encodé avec un soin manifeste. R.I.P Falco.

 Hans Hölzel est né à Vienne le 19 février 1957. Ses parents divorcent très tôt, il reste avec sa mère et sa grand-mère. Il quitte l'école à 16 ans, et, après avoir essayé deux ou trois petits boulots, il décide de se lancer dans une carrière musicale. Il entre au conservatoire de musique de Vienne et commence à jouer dans différents groupes, à Vienne comme à Berlin-Ouest. En 1977, il décide de changer son nom en Falco, du nom d'un skieur est-allemand, Falko Weisspflog. C’est le début d'une carrière extraordinaire. Il joue dans des groupes comme "Drahdiwaberl" et "Spinning Wheel" ou "the Hallucination Company"; même si le single "Ganz Wien" (à propos des trafics de drogues locaux) est un franc succès, dans l'ombre, il affûte sa guitare basse. Quand Marcus Spiegel, de GIG records lui offre un contrat solo, il accepte de suite. "Ganz Wien" est inclus dans son premier album solo, Einzelhaft (1982), et devient le premier morceau à être banni des radios, à cause de ses paroles. Son premier single, "Der Kommissar", est un succès international. La musique de Falco, inspirée par le style New Wave et les premiers artistes rap des Etats-Unis, avec des paroles second degrés voire caustiques dans un mix d'Anglais-Allemand-Italien est quelque chose de totalement nouveau dans les pays germanophone, et même ailleurs. "Der Kommissar" se vends à plus de 7 millions de copies. L'album "Einzelhaft", produit par Robert Ponger est également un grand succès. L'album "Junge Römer" (Jeunes Romains), qui sort en 1984, est un flop, bien que très apprécié par la critique. Trop décalé, trop loin de son époque, pour être vendu massivement. C’est en 1986 que Falco à son plus grand succès. Pour l'album "Falco 3" (1985), il choisit les frères Bolland des Pays-Bas comme producteurs. Le premier single "Rock Me Amadeus", devint numéro 1 en Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Canada. Alors que Falco pensait être au top, le single devient numéro 1 au Etats-Unis en 1986, et reste en tête du hit-parade pendant 4 semaines. Du jamais vu pour un chanteur germanophone. L'autre single de cet album, "Jeanny", fut la source d'un grand scandale à cause des paroles. "Jeanny" fut banni de bon nombre de radios et de magasins, mais finira quand même par trouver sa plaçe. L'album suivant, "Emotional", sort en 1986, et les singles comme "The Sound of Musik", "Coming Home" (la suite de "Jeanny") et "Emotional" eurent plus ou moins de succès. Après cela, Falco dû surmonter de plus en plus de problèmes dans sa vie privée (mariage avec Isabella Vitkovic, divorce, sa fille Katharina n'est effectivement pas la sienne...) serieux problèmes d’alcool et de drogue. Les albums "Wiener Blut" (1988) et "Data de Groove" (1990), restent plus ou moins dans l'ombre. En 1992, il fait un retour assez important avec "Nachtflug" qui devient numéro 1 en Autriche. Le single "Titanic" resta dans le hit-parade pendant 18 semaines, l'album pendant 17. Pour la première fois en 6 ans, Falco repart en tournée. Sa dernière apparition le 27 juin 1993 pendant le festival de la musique du Donauinsel, à Vienne restera sans doute son apogée. Ce soir-là plus de 110 000 personnes expérimentèrent ce qui sera probablement le meilleur concert de Falco. Après cela, il se concentra de nouveau sur sa vie privée pendant trois ans, jusqu'à un nouveau hit, avec le single de style-techno "Mutter, der Mann mit dem Koks ist da" (1995), qui eut du succès principalement en Allemagne. En 1996, Hans décide de quitter sa Vienne natale et déménage en République Dominicaine, fuyant les médias souvent indiscrets. Après un nouveau single sorti en 1996, "Naked", il travaille à son prochain album. Ce dernier est presque fini et doit sortir avec le titre "Egoisten". Malheureusement, Hans Hölzel trouve la mort dans un accident de la route en République Dominicaine le 6 février 1998. Il a 40 ans. Un bus percute son Mitsubishi Pajero alors qu'il sort d'un parking. Un nouvel album sort à titre posthume sous le nom de "Out Of The Dark".
Hans Hölzel est né à Vienne le 19 février 1957. Ses parents divorcent très tôt, il reste avec sa mère et sa grand-mère. Il quitte l'école à 16 ans, et, après avoir essayé deux ou trois petits boulots, il décide de se lancer dans une carrière musicale. Il entre au conservatoire de musique de Vienne et commence à jouer dans différents groupes, à Vienne comme à Berlin-Ouest. En 1977, il décide de changer son nom en Falco, du nom d'un skieur est-allemand, Falko Weisspflog. C’est le début d'une carrière extraordinaire. Il joue dans des groupes comme "Drahdiwaberl" et "Spinning Wheel" ou "the Hallucination Company"; même si le single "Ganz Wien" (à propos des trafics de drogues locaux) est un franc succès, dans l'ombre, il affûte sa guitare basse. Quand Marcus Spiegel, de GIG records lui offre un contrat solo, il accepte de suite. "Ganz Wien" est inclus dans son premier album solo, Einzelhaft (1982), et devient le premier morceau à être banni des radios, à cause de ses paroles. Son premier single, "Der Kommissar", est un succès international. La musique de Falco, inspirée par le style New Wave et les premiers artistes rap des Etats-Unis, avec des paroles second degrés voire caustiques dans un mix d'Anglais-Allemand-Italien est quelque chose de totalement nouveau dans les pays germanophone, et même ailleurs. "Der Kommissar" se vends à plus de 7 millions de copies. L'album "Einzelhaft", produit par Robert Ponger est également un grand succès. L'album "Junge Römer" (Jeunes Romains), qui sort en 1984, est un flop, bien que très apprécié par la critique. Trop décalé, trop loin de son époque, pour être vendu massivement. C’est en 1986 que Falco à son plus grand succès. Pour l'album "Falco 3" (1985), il choisit les frères Bolland des Pays-Bas comme producteurs. Le premier single "Rock Me Amadeus", devint numéro 1 en Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Canada. Alors que Falco pensait être au top, le single devient numéro 1 au Etats-Unis en 1986, et reste en tête du hit-parade pendant 4 semaines. Du jamais vu pour un chanteur germanophone. L'autre single de cet album, "Jeanny", fut la source d'un grand scandale à cause des paroles. "Jeanny" fut banni de bon nombre de radios et de magasins, mais finira quand même par trouver sa plaçe. L'album suivant, "Emotional", sort en 1986, et les singles comme "The Sound of Musik", "Coming Home" (la suite de "Jeanny") et "Emotional" eurent plus ou moins de succès. Après cela, Falco dû surmonter de plus en plus de problèmes dans sa vie privée (mariage avec Isabella Vitkovic, divorce, sa fille Katharina n'est effectivement pas la sienne...) serieux problèmes d’alcool et de drogue. Les albums "Wiener Blut" (1988) et "Data de Groove" (1990), restent plus ou moins dans l'ombre. En 1992, il fait un retour assez important avec "Nachtflug" qui devient numéro 1 en Autriche. Le single "Titanic" resta dans le hit-parade pendant 18 semaines, l'album pendant 17. Pour la première fois en 6 ans, Falco repart en tournée. Sa dernière apparition le 27 juin 1993 pendant le festival de la musique du Donauinsel, à Vienne restera sans doute son apogée. Ce soir-là plus de 110 000 personnes expérimentèrent ce qui sera probablement le meilleur concert de Falco. Après cela, il se concentra de nouveau sur sa vie privée pendant trois ans, jusqu'à un nouveau hit, avec le single de style-techno "Mutter, der Mann mit dem Koks ist da" (1995), qui eut du succès principalement en Allemagne. En 1996, Hans décide de quitter sa Vienne natale et déménage en République Dominicaine, fuyant les médias souvent indiscrets. Après un nouveau single sorti en 1996, "Naked", il travaille à son prochain album. Ce dernier est presque fini et doit sortir avec le titre "Egoisten". Malheureusement, Hans Hölzel trouve la mort dans un accident de la route en République Dominicaine le 6 février 1998. Il a 40 ans. Un bus percute son Mitsubishi Pajero alors qu'il sort d'un parking. Un nouvel album sort à titre posthume sous le nom de "Out Of The Dark". mercredi, février 22, 2006
Frissons & Rage.
 Toujours dans une période « premiers films », j’ai la super 8 qui me démange… "Réunis dans un coffret, les deux premiers films de David Cronenberg sont comme deux manifestes symptomatiques d'une époque et annonciateurs de la carrière à venir d'un cinéaste atypique. FRISSONS : dans un luxueux complexe résidentiel, une étrange créature protéiforme pénètre les habitants, les transformant en hédonistes furieux qui cherchent à se multiplier. Rapidement, un médecin tente de s’opposer à l’invasion. RAGE : à la suite d’un accident de moto qui nécessita une greffe, une jeune femme devient porteuse d’un virus qui s’apparente à la rage et qui la pousse à contaminer ses semblables. Frissons (1976) et Rage (1977) sont les deux premiers films de David Cronenberg, mais non rien d’une préhistoire. Ce sont même de bons livres de recettes pour comprendre et décrypter la manière Cronenberg et son obsession de l’organique et de la chair vive. Une obsession qui traverse de part en part sans discontinuer une filmographie pour le moins régulière, indépendante et hors norme. Frissons et Rage sont le produit de l’époque 70 autant dans leur traitement que dans leur thème : moquettes marron et sexualité extravertie, la digression maladive de la chair comme entité vivante et indépendante est au moins aussi troublante que dans le plus masochiste de ses films, Crash. Cette réunion de Frissons et de Rage dans le même coffret s’accompagne de deux documentaires sur le maître et d’un documentaire sur Marilyn Chambers que Cronenberg alla chercher pour incarner l’origine du mal de Rage alors même que la star montante du porno californien sautait de succès en succès (Derrière la porte verte, entre autre chef-d’œuvre organique, onaniste et orgasmique). La chair, toujours la chair. Le tout est un vade-mecum complet et précieux à l’usage du petit débutant qui ne cherche qu’à s’instruire.
Toujours dans une période « premiers films », j’ai la super 8 qui me démange… "Réunis dans un coffret, les deux premiers films de David Cronenberg sont comme deux manifestes symptomatiques d'une époque et annonciateurs de la carrière à venir d'un cinéaste atypique. FRISSONS : dans un luxueux complexe résidentiel, une étrange créature protéiforme pénètre les habitants, les transformant en hédonistes furieux qui cherchent à se multiplier. Rapidement, un médecin tente de s’opposer à l’invasion. RAGE : à la suite d’un accident de moto qui nécessita une greffe, une jeune femme devient porteuse d’un virus qui s’apparente à la rage et qui la pousse à contaminer ses semblables. Frissons (1976) et Rage (1977) sont les deux premiers films de David Cronenberg, mais non rien d’une préhistoire. Ce sont même de bons livres de recettes pour comprendre et décrypter la manière Cronenberg et son obsession de l’organique et de la chair vive. Une obsession qui traverse de part en part sans discontinuer une filmographie pour le moins régulière, indépendante et hors norme. Frissons et Rage sont le produit de l’époque 70 autant dans leur traitement que dans leur thème : moquettes marron et sexualité extravertie, la digression maladive de la chair comme entité vivante et indépendante est au moins aussi troublante que dans le plus masochiste de ses films, Crash. Cette réunion de Frissons et de Rage dans le même coffret s’accompagne de deux documentaires sur le maître et d’un documentaire sur Marilyn Chambers que Cronenberg alla chercher pour incarner l’origine du mal de Rage alors même que la star montante du porno californien sautait de succès en succès (Derrière la porte verte, entre autre chef-d’œuvre organique, onaniste et orgasmique). La chair, toujours la chair. Le tout est un vade-mecum complet et précieux à l’usage du petit débutant qui ne cherche qu’à s’instruire.RAGE (1977).
 A la suite d'un grave accident de moto conduite par son compagnon Hart, où elle manque de perdre la vie, Rose doit subir une intervention d'urgence. Seule la clinique chirurgicale à proximité du lieu de l'accident peut opérer dans la demi-heure. Devant la complexité de son cas le docteur Dan Keloid n'hésite pas à recourir à une technique qui n'a pas encore fait ses preuves : la "greffe sur terrain neutre" qui permet de donner à la peau transplantée la même plasticité que celle de l'embryon. Son intervention chirurgicale a de curieuses conséquences. Il pousse à l'aisselle de Rose une excroissance phallique, une sorte de dard rétractable qui lui permet de rester en vie. Car Rose a désormais besoin de sang humain pour survivre et le dard lui permet de satisfaire à cette nécessité. La première victime est un compagnon de clinique, Lloyd Walsh, qui la découverte agitée, à demi nue sur son lit d'hôpital. Elle s'enfuit une première fois et éborgne avec son dard un paysan ivre qui voulait la violer. Celui-ci sera tué dans un restaurant au bord de l'autoroute pour s'être attaqué sauvagement à la nourriture de clients. Rose tue ensuite une compagne de chambre qu'on retrouvera dans un congélateur puis le docteur Dan Keloid qui fou furieux coupe le doigt d'une infirmière en pleine opération. Rose s'enfuit en camion pour Montréal et suce le sang du camionneur. Comme les autres victimes, celui-ci va transmettre une sorte de rage foudroyante à ses proies. Rose parvient à Montréal. Des centaines d'habitants sont désormais victimes de ces attaques de personnes infectées dont le temps d'incubation n'est que de quelques heures. Une fois pénétrées, elles deviennent à leur tour des vampires. L'Etat d'urgence est déclaré. L'épidémie s'étend. L'armé abat froidement les personnes infectées qui errent dans les rues et, après chaque exécution, des techniciens vêtus de blanc viennent désinfecter l'endroit et jettent les cadavres dans des bennes pour les emmener à la destruction Empêché de rejoindre celle qu'il aime par la géographie de la ville et par la quarantaine imposée par les autorités, Hart finit par retrouver Rose. Il la surprend suçant le sang de son amie Mindy qui l'hébergeait. Hart comprend qu'elle est à l'origine de l'épidémie, l'enlace, elle l'épargne Rose devant les accusations de Hart cherche à se prouver ce qu'elle craignait elle-même. Elle s'enferme avec un homme qu'elle a mordu et se laisse suicider par lui. Son corps sera retrouvé dans une rue au petit matin. Les éboueurs ramasseront son corps pour le jeter dans une benne à ordures. Pour Cronenberg, l'enjeu pour le sujet est de recouvrer son autonomie dans un monde où la technologie, la science et la psychologie assurément que tout est normal. C'est dans l'organisme humain, lieu de tension, que s'écrit et se construit le destin de l'homme. Si son équilibre est rompu, par l'effet d'un virus par exemple, la maladie s'installe et les cellules prolifèrent de manière incontrôlée. Elles vivent leur propre vie mais engendrent un cancer qui détruit le corps et, par voie de conséquence, entraîne la mort.
A la suite d'un grave accident de moto conduite par son compagnon Hart, où elle manque de perdre la vie, Rose doit subir une intervention d'urgence. Seule la clinique chirurgicale à proximité du lieu de l'accident peut opérer dans la demi-heure. Devant la complexité de son cas le docteur Dan Keloid n'hésite pas à recourir à une technique qui n'a pas encore fait ses preuves : la "greffe sur terrain neutre" qui permet de donner à la peau transplantée la même plasticité que celle de l'embryon. Son intervention chirurgicale a de curieuses conséquences. Il pousse à l'aisselle de Rose une excroissance phallique, une sorte de dard rétractable qui lui permet de rester en vie. Car Rose a désormais besoin de sang humain pour survivre et le dard lui permet de satisfaire à cette nécessité. La première victime est un compagnon de clinique, Lloyd Walsh, qui la découverte agitée, à demi nue sur son lit d'hôpital. Elle s'enfuit une première fois et éborgne avec son dard un paysan ivre qui voulait la violer. Celui-ci sera tué dans un restaurant au bord de l'autoroute pour s'être attaqué sauvagement à la nourriture de clients. Rose tue ensuite une compagne de chambre qu'on retrouvera dans un congélateur puis le docteur Dan Keloid qui fou furieux coupe le doigt d'une infirmière en pleine opération. Rose s'enfuit en camion pour Montréal et suce le sang du camionneur. Comme les autres victimes, celui-ci va transmettre une sorte de rage foudroyante à ses proies. Rose parvient à Montréal. Des centaines d'habitants sont désormais victimes de ces attaques de personnes infectées dont le temps d'incubation n'est que de quelques heures. Une fois pénétrées, elles deviennent à leur tour des vampires. L'Etat d'urgence est déclaré. L'épidémie s'étend. L'armé abat froidement les personnes infectées qui errent dans les rues et, après chaque exécution, des techniciens vêtus de blanc viennent désinfecter l'endroit et jettent les cadavres dans des bennes pour les emmener à la destruction Empêché de rejoindre celle qu'il aime par la géographie de la ville et par la quarantaine imposée par les autorités, Hart finit par retrouver Rose. Il la surprend suçant le sang de son amie Mindy qui l'hébergeait. Hart comprend qu'elle est à l'origine de l'épidémie, l'enlace, elle l'épargne Rose devant les accusations de Hart cherche à se prouver ce qu'elle craignait elle-même. Elle s'enferme avec un homme qu'elle a mordu et se laisse suicider par lui. Son corps sera retrouvé dans une rue au petit matin. Les éboueurs ramasseront son corps pour le jeter dans une benne à ordures. Pour Cronenberg, l'enjeu pour le sujet est de recouvrer son autonomie dans un monde où la technologie, la science et la psychologie assurément que tout est normal. C'est dans l'organisme humain, lieu de tension, que s'écrit et se construit le destin de l'homme. Si son équilibre est rompu, par l'effet d'un virus par exemple, la maladie s'installe et les cellules prolifèrent de manière incontrôlée. Elles vivent leur propre vie mais engendrent un cancer qui détruit le corps et, par voie de conséquence, entraîne la mort.FRISSON (Shivers- 1976).
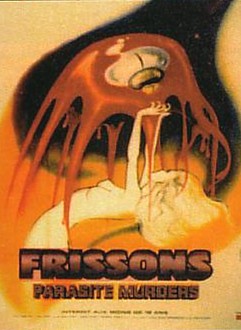 A Montréal, après avoir été artificiellement créé par un médecin, un virus se propage progressivement chez les paisibles habitants d’une résidence moderne, provoquant des troubles du comportement aussi divers qu’inavouables. La démarche d’une partie de la cinéphilie est de vouloir détecter à tout prix dans les premières œuvres d’un cinéaste les prémices et les "fondamentaux" de leur cinéma à venir : quel(s) thème(s) développe-t-il déjà ? Adopte-t-il un style reconnaissable dès maintenant ? En quoi ce film est-il le brouillon d’un chef d’œuvre futur ? Néanmoins, et ce même si Cronenberg est un auteur pur jus définition Cahiers du Cinéma, tenter de théoriser, voire même de comprendre en quoi ces premiers films parfois si particulier s’insèrent dans une œuvre de réalisateur relève parfois d’une mission impossible. De part son processus de création, son mode de diffusion à l’époque et le résultat final à l’écran, Frissons (connu aussi sous le nom de Shivers ou Parasite Murders) serait donc presque une gageure critique. Coup sur coup en 1969 puis en 1970, Cronenberg réalise deux moyens-métrages, Stereo et Crimes of the Future. Films très artisanaux, ils trahissent quelque part l’idée selon laquelle Cronenberg choisit le medium cinéma par défaut (au détriment de la littérature ou de la sculpture selon ses propres termes) pour y exprimer sa vision artistique et son intellect. Début des années 70, le réalisateur Canadien n’en est même pas réellement un à l’époque. Il ne se considère pas comme tel tant il semble persuadé avoir tout dit avec ses deux premières (courtes) œuvres. Jusqu’au jour où il décida que faire du cinéma allait tout bonnement devenir son métier. Mais métier au sens le plus noble du terme : amour de son travail ; mais amour impliquant parfois haine et rancœur : ce mode d’expression allait s’accoupler avec l’idée qu’il allait se battre sans cesse contre l’industrie cinématographique et les diktats de ses dirigeants. Cronenberg ou "La liberté contre la dictature". Frissons ne fait que marquer pour lui le début d’une lutte ‘quasi sans merci’ contre la censure et les restrictions de tout genre (budgétaires, scénaristiques). C’est ainsi qu’à cette époque Cronenberg écrivit le scénario de Frissons et se mit en tête de le proposer au studio Cinepix, studio canadien spécialisé dans le cinéma érotique et à vrai dire seul studio réellement prolifique dans cette partie de l’Amérique du Nord. C’est ainsi que de fil en aiguille et par un bon contact entre les deux parties, Cronenberg finit par réaliser une scène d’essai … pour un film érotique Vu son penchant pour la chose et l’intérêt que le cinéaste porte au sexe, cette expérience, finalement plus amusante que réellement surprenante, amène le réalisateur à prendre le taureau par les cornes en proposant clairement ses services. Seule condition pour que Cronenberg vende son scénario à Cinepix : qu’il réalise le film lui-même. De rencontres fructueuses (Roger Corman, Barbara Steele, Jonathan Demme à qui l’on a même proposé de réaliser le film !) en voyages divers (Los Angeles), Cronenberg signe donc son premier film en cette année 1975. Virus, contamination, complots politique (le bâtiment où a lieu l’action appartient à une multinationale), irrésistible attirance envers tout ce qui a attrait à la technologie (le film débute sur une présentation du bâtiment par une voix-off situant l’action dans un temps indéfini). En bref, Frissons est thématiquement une tarte à la crème recette Cronenberg. Il est amusant de constater à quel point Cronenberg utilise cet alibi du virus afin de "justifier" à l’écran ce qui pouvait choquer il y a trente ans : couple homosexuel, arsenal sado-masochiste, liaison vieux/jeune. Le réalisateur (ab)use de ce procédé afin d’échapper à toute critique morale liée à la révolution des sexes en vigueur à l’époque. Mais après tout, Everything is sexual comme il est dit dans le métrage. Il n’y a qu’à voir à quel point le virus ressemble à s’y méprendre à un sexe d’homme (l’un des titres original du film est tout de même Orgy of the Blood Parasites !). Je laisse le soin aux spectateurs que vous êtes de découvrir l’ensemble des idées qui ont traversé l’esprit du cinéaste. Pas étonnant finalement que le canadien ait choisi Marilyn Chambers comme héroïne de son film suivant, Rage (Rabid) ! De la même manière que dans eXistenZ où le cinéaste s’amusait à créer un faux orifice afin d’échapper à toute censure, ce procédé aussi amusant que culotté s’applique ici à tout le film. Ainsi, toute l’action à l’écran n’est que détournement de la réalité en vigueur en 1975. Un miroir donc. Distribué de manière très confidentielle dans les réseaux de films de genre aussi méprisés que le porno ou le gore, Frissons se présente d’emblée comme un énième film de genre aux yeux de la critique de bon goût. Cronenberg, déjà adulé à juste titre par de nombreux fans, ne peut être à cette époque qu’affilié à la mouvance underground et contestataire dont ce premier film est inextricable dans l’esprit. Film de genre en même temps que pamphlet anti-conservateur, le premier film du canadien contient, soulignons-le, de nombreuses scènes très efficaces et aux effets spéciaux de qualité (la scène de la lycéenne, les ventres "en action", le viol dans la baignoire). Alors certes, Frissons peut paraître à plusieurs reprises maladroit dans sa mise en scène, Cronenberg hésitant dans ses cadrages et sa façon de gérer l’espace (il apprenait véritablement sur le tas) mais cette première oeuvre se doit d’être abordée déjà comme l’affirmation d’une personnalité et d’un tempérament hors du commun. Personnalité qui aura tout le loisir d’exploser, de se lâcher, voire même de se libérer ultérieurement ; à l’image de l’inoubliable dernière scène du film.
A Montréal, après avoir été artificiellement créé par un médecin, un virus se propage progressivement chez les paisibles habitants d’une résidence moderne, provoquant des troubles du comportement aussi divers qu’inavouables. La démarche d’une partie de la cinéphilie est de vouloir détecter à tout prix dans les premières œuvres d’un cinéaste les prémices et les "fondamentaux" de leur cinéma à venir : quel(s) thème(s) développe-t-il déjà ? Adopte-t-il un style reconnaissable dès maintenant ? En quoi ce film est-il le brouillon d’un chef d’œuvre futur ? Néanmoins, et ce même si Cronenberg est un auteur pur jus définition Cahiers du Cinéma, tenter de théoriser, voire même de comprendre en quoi ces premiers films parfois si particulier s’insèrent dans une œuvre de réalisateur relève parfois d’une mission impossible. De part son processus de création, son mode de diffusion à l’époque et le résultat final à l’écran, Frissons (connu aussi sous le nom de Shivers ou Parasite Murders) serait donc presque une gageure critique. Coup sur coup en 1969 puis en 1970, Cronenberg réalise deux moyens-métrages, Stereo et Crimes of the Future. Films très artisanaux, ils trahissent quelque part l’idée selon laquelle Cronenberg choisit le medium cinéma par défaut (au détriment de la littérature ou de la sculpture selon ses propres termes) pour y exprimer sa vision artistique et son intellect. Début des années 70, le réalisateur Canadien n’en est même pas réellement un à l’époque. Il ne se considère pas comme tel tant il semble persuadé avoir tout dit avec ses deux premières (courtes) œuvres. Jusqu’au jour où il décida que faire du cinéma allait tout bonnement devenir son métier. Mais métier au sens le plus noble du terme : amour de son travail ; mais amour impliquant parfois haine et rancœur : ce mode d’expression allait s’accoupler avec l’idée qu’il allait se battre sans cesse contre l’industrie cinématographique et les diktats de ses dirigeants. Cronenberg ou "La liberté contre la dictature". Frissons ne fait que marquer pour lui le début d’une lutte ‘quasi sans merci’ contre la censure et les restrictions de tout genre (budgétaires, scénaristiques). C’est ainsi qu’à cette époque Cronenberg écrivit le scénario de Frissons et se mit en tête de le proposer au studio Cinepix, studio canadien spécialisé dans le cinéma érotique et à vrai dire seul studio réellement prolifique dans cette partie de l’Amérique du Nord. C’est ainsi que de fil en aiguille et par un bon contact entre les deux parties, Cronenberg finit par réaliser une scène d’essai … pour un film érotique Vu son penchant pour la chose et l’intérêt que le cinéaste porte au sexe, cette expérience, finalement plus amusante que réellement surprenante, amène le réalisateur à prendre le taureau par les cornes en proposant clairement ses services. Seule condition pour que Cronenberg vende son scénario à Cinepix : qu’il réalise le film lui-même. De rencontres fructueuses (Roger Corman, Barbara Steele, Jonathan Demme à qui l’on a même proposé de réaliser le film !) en voyages divers (Los Angeles), Cronenberg signe donc son premier film en cette année 1975. Virus, contamination, complots politique (le bâtiment où a lieu l’action appartient à une multinationale), irrésistible attirance envers tout ce qui a attrait à la technologie (le film débute sur une présentation du bâtiment par une voix-off situant l’action dans un temps indéfini). En bref, Frissons est thématiquement une tarte à la crème recette Cronenberg. Il est amusant de constater à quel point Cronenberg utilise cet alibi du virus afin de "justifier" à l’écran ce qui pouvait choquer il y a trente ans : couple homosexuel, arsenal sado-masochiste, liaison vieux/jeune. Le réalisateur (ab)use de ce procédé afin d’échapper à toute critique morale liée à la révolution des sexes en vigueur à l’époque. Mais après tout, Everything is sexual comme il est dit dans le métrage. Il n’y a qu’à voir à quel point le virus ressemble à s’y méprendre à un sexe d’homme (l’un des titres original du film est tout de même Orgy of the Blood Parasites !). Je laisse le soin aux spectateurs que vous êtes de découvrir l’ensemble des idées qui ont traversé l’esprit du cinéaste. Pas étonnant finalement que le canadien ait choisi Marilyn Chambers comme héroïne de son film suivant, Rage (Rabid) ! De la même manière que dans eXistenZ où le cinéaste s’amusait à créer un faux orifice afin d’échapper à toute censure, ce procédé aussi amusant que culotté s’applique ici à tout le film. Ainsi, toute l’action à l’écran n’est que détournement de la réalité en vigueur en 1975. Un miroir donc. Distribué de manière très confidentielle dans les réseaux de films de genre aussi méprisés que le porno ou le gore, Frissons se présente d’emblée comme un énième film de genre aux yeux de la critique de bon goût. Cronenberg, déjà adulé à juste titre par de nombreux fans, ne peut être à cette époque qu’affilié à la mouvance underground et contestataire dont ce premier film est inextricable dans l’esprit. Film de genre en même temps que pamphlet anti-conservateur, le premier film du canadien contient, soulignons-le, de nombreuses scènes très efficaces et aux effets spéciaux de qualité (la scène de la lycéenne, les ventres "en action", le viol dans la baignoire). Alors certes, Frissons peut paraître à plusieurs reprises maladroit dans sa mise en scène, Cronenberg hésitant dans ses cadrages et sa façon de gérer l’espace (il apprenait véritablement sur le tas) mais cette première oeuvre se doit d’être abordée déjà comme l’affirmation d’une personnalité et d’un tempérament hors du commun. Personnalité qui aura tout le loisir d’exploser, de se lâcher, voire même de se libérer ultérieurement ; à l’image de l’inoubliable dernière scène du film. mardi, février 21, 2006
Martin, the Crazies & the witch.
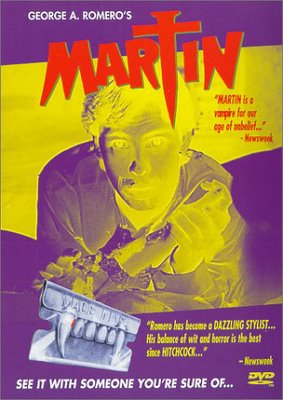 Martin sort demain chez Wild side video, l’occasion de revenir sur trois œuvres oubliées, bien plus intéressantes, à mon goût, que le Land of the dead. "Martin est un jeune homme de 17 ans. Recueilli par son oncle Cuda à Braddock en Pennsylvanie, il est rapidement mis en garde par son tuteur : Martin est un Nosferatu, un vampire âgé de 84 ans, et Cuda doit sauver son âme avant de détruire son enveloppe terrestre. Des meurtres perpétrés par Martin semblent donner raison à son oncle, meurtres au cours desquels Martin boit le sang de ses victimes mais où aucun pouvoir fantastique ne transparaît. Alors Martin : vampire moderne ? fantasme d’une communauté intégriste ? tueur en série ? Le film s’ouvre sur la montée de Martin dans un train et sa recherche d’une victime, séquence parmi les plus fortes de la riche filmographie de George A. Romero. Extrêmement découpée, elle se compose en partie d’une succession des gros plans d’une précision démoniaque qui amènent inéluctablement au cœur de la scène. Le spectateur est immédiatement plongé dans le film, et sans explication aucune, va assister au meurtre d’une passagère. Le noir et blanc fait son apparition alors que Martin a choisi sa proie. Il l’imagine l’accueillant amoureusement dans ses bras, et lorsque celle- ci lutte contre son agresseur, la vision fantasmée de la scène par Martin va venir contaminer la brutalité effective du meurtre en une juxtaposition inédite. Prodigieusement monté, le meurtre voit la fureur défensive de la femme céder la place à l’inquiétude, puis quasiment à son abandon dans les bras de son agresseur. C’est l’image même de la figure mythique de la victime d’un vampire qui succombe au charme érotique de la créature. Seulement ici, point de charme fantastique, mais l’usage d’un substitut chimique, la femme s’assoupissant sous l’effet d’une drogue. Cette séquence contient en germe ce qu’est Martin, incarnation de la frontière ténue qui sépare un fantasme religieux et mythique (le vampire et ses facultés fantastiques) d’une psychose ancrée dans le quotidien. Martin est-il un vampire ou un adolescent psychotique ? Romero n’explicite pas les doutes semés par son intrigue et rien n’interdit d’imaginer que Martin est bel et bien un Nosferatu. Le réalisateur n’assène pas sa vision et laisse le champ libre à l’interprétation, comme ailleurs il refuse d’expliquer la raison de la présence sur terre des morts vivants (juste un laconique : "quand il n’y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre") ou allégorie d’une société que Romero se plaît à disséquer (le quatuor des morts vivants). Que Martin soit un vampire ou non, il est de toute manière isolé comme nombre d’adolescent de son âge, vit les mêmes frustrations. Que Martin soit un vampire ou non, le fait est qu’il tue. Romero observe son héros en multipliant les pistes pour s’en approcher, montrant par là qu’une psychose destructrice est le fruit de nombreux éléments (frustration sexuelle, impuissance, crise d’identité, environnement familial et aliénation sociale…) mais n’est surtout pas réductible à un seul élément : "tu es mauvais, tu es un vampire". Cette fixation de l’oncle Cuda sur le Nosferatu est la critique virulente d’une vision manichéenne du monde, religieuse et rétrograde. « A l’origine, Martin est d’abord une blague. Que se passerait-il si un Vampire était vraiment condamné à vivre éternellement ? Sans doute devrait-il changer les photos de son passeport, de son permis de conduire… Au départ, l’idée était donc de faire une comédie sur les problèmes très concrets, triviaux même, auxquels serait réellement confronté un vampire. » (in. Simulacres). Si le projet abandonne rapidement les rives de la comédie, cette omniprésence du quotidien vient complètement envahir la mythologie du film de vampire, jusqu’à faire passer au second plan l’aspect fantastique pour se concentrer sur une vision naturaliste du vampirisme, vu alors comme reflet des troubles adolescents et véritable maladie mentale. Car Martin a réellement besoin de sang, dans son corps, dans sa chair. Et sa psychose se nourri de toute la fantasmagorie du vampire, véhiculée par l’obscurantisme de son oncle, seul moyen pour Martin de survivre mentalement à l’atrocité des meurtres qu’il commet. Martin est un réceptacle, un véritable héros tragique offert en sacrifice à une société en déliquescence. La ville de Braddock est l’image même de ce monde mourant, « The Magic is all gone » dit Martin. La musique absolument sublime de Donald Rubinstein, achève de donner au film un ton poignant, mêlé de tristesse et de nostalgie. Dans le cinéma de Romero, le fantastique est un moyen d’échapper à l’aliénation. C’est la sorcellerie vers laquelle se tourne l’héroïne de Season of the Witch, la folie destructrice qui s’empare des habitants de The Crazies, le vampirisme qui rassemble autour de Martin les fans (il intervient dans une émission radio) et les combattants du mal (exorcismes, foule à la poursuite du Nosferatu). Les meurtres de Martin ne sont d’ailleurs peut-être qu’un autre moyen de transfigurer son quotidien, de s’affranchir de la tristesse de la banlieue dans laquelle il évolue, de se reconstruire une vie où il est désiré et craint. La transfiguration du quotidien passe par des scènes fantasmatiques en noir et blanc qui ponctuent le parcours de Martin. Scènes de son passé de vampires pourchassé dans les Carpates, vision décalée des meurtres qu’il commet où ses victimes l’invitent dans leurs lits. Toute une imagerie gothique est ici convoquée dans une représentation caricaturale nourrie de toute l’iconographie des films de Vampire. La demeure de Cuda, avec ses icônes religieuses omniprésentes, ses crucifix, ses gousses d’ails, se plie aussi à ce folklore suranné et au fantasme du vieil homme à être une incarnation de Van Helsing. L’architecture même de la ville dévoile des apparences médiévales qui se mêlent aux paysages d’une banlieue sinistrée (voix de chemins de fers, parkings de supermarché, casses automobiles). Des immeubles semblent par moment s’élever comme des cathédrales, décors dont la puissance est accentuée par des contre plongées appuyées. On a ainsi le sentiment que toute la ville est contaminée par l’irrationnel, à la fois perception chimérique de Martin et de son oncle, et berceau de leur folie respective. Si la névrose de Martin est spectaculaire, celle de Cuda est plus insidieuse et bien plus répandue celle du jeune homme et on imagine aisément que son intégrisme est à la base d’un traumatisme enfantin de Martin. Vision fondamentaliste de la maladie mentale qui ne peut s’expliquer que par la possession démoniaque. Martin tente, quand il le peut, quand il n’est pas submergé par ce folklore, de lutter contre cette conception archaïque. Il tente de ramener son oncle à la raison, en lui montrant qu’il peut croquer dans de l’ail et tenir un crucifix. Quand dans une scène, il apparaît en vampire, c’est un véritable vampire de pacotille avec tenue grandiloquente et fausses dents… une manière de décrédibiliser le mythe, de se moquer de son oncle et de ses croyances ancestrales. Gestuelle, costume… tout confère à donner à cette scène, qui se passe près d’un manège, une apparence de foire. Le film est une lutte constante entre la normalité, même si elle passe par l’acceptation d’une psychose, et le fantastique. Une séquence est à cet égard très parlante : lors du meurtre d’un clochard, toute l’imagerie gothique s’évanouit, et c’est juste la crasse, le côté misérable dénué de toute afféterie, qui explose, qui saisit Martin. Ce meurtre ne se pare par de l’aura érotique habituelle. Martin est alors sexuellement satisfait, et étant devenu l’amant d’une habitante de Braddock, seul son besoin de sang le pousse à tuer. Il n’a plus la possibilité de se réfugier dans une vision fantasmée. La sexualité est omniprésente dans le film. La dimension érotique du vampirisme est clairement énoncée : ce n’est pas le sang qui est convoité, mais bel et bien la consommation de sexe, Martin s’entourant des bras de ses victimes endormies, les étreignant amoureusement. Alors que la production fantastique actuelle stagne dans les remakes et le second degré, que la renaissance du genre est annoncée à grands cris à chaque fois qu’un film sort un tantinet du lot pour être aussi vite oublié, que seule l’Asie nous permet encore d’échapper à l’esthétique abominable imposée par des producteurs décérébrés qui confondent pub et cinéma, il est vivifiant de se replonger dans le fantastique des années 1970 ou de véritables auteurs arrivaient à réaliser des œuvres radicales et crues, bourrées d’intelligence et de sincérité. Martin a été tourné pour un budget ridicule de 270,000$, en l’espace de six semaines. Figurants et acteurs viennent de l’entourage de Romero et de son équipe, la maison de Cuda a été gracieusement prêtée par une vieille dame tandis que la police même mettait à disposition ses véhicules. Cette manière de concevoir un film loin des studios, en toute indépendance, terme tellement galvaudé mais qui ici le décrit parfaitement, était alors possible grâce au statut de B Movies qui permettait à de tels films de tenir l’affiche durant une longue période. Ainsi ils se faisaient connaître sans avoir recours à la publicité et des œuvres radicales et décalées, qu’aucun studio n’aurait soutenu, pouvaient voir le jour sans être soumis au diktat imbécile des publicitaires et de ceux qui ne voient dans le cinéma que merchandising et box office. Martin tint ainsi 18 mois en séance de nuit, rencontra tranquillement son public et acquit tout naturellement son statut de film culte. Au-delà d’un mode de production salvateur, il faut également admettre que si Martin ne donne jamais l’impression de souffrir de son budget, c’est grâce à la motivation et au talent de chaque participant. Si le tournage en 16mm accentue grandement le côté cru de la photographie, c’est à son chef opérateur qu’on le doit. Pour sa première expérience à ce poste (poste qu’il ne tiendra d’ailleurs que dans des films de Romero) Michael Gornick fait preuve d’une maturité étonnante en captant à merveille les intérieurs, les visages, les vues de Pittsburgh. Il joue du grain de la pellicule et donne au film, sous l’œil savant de Romero, une beauté étrange et envoûtante. Si la beauté renversante de la musique transcende complètement le film, le son et le mixage jouent un rôle primordial dans la conception de l’univers si particulier de Martin. Romero dit s’être inspiré des Contes d’Hoffman de Michael Powell et Emeric Pressburger, dans des expériences visuelles et sonores où il fait s’opposer un découpage haché à une musique ralentie à l’extrême. Croyance dans les vertus du cinéma, inventivité, honnêteté, investissement, autant de valeurs qui remplacent le budget le plus confortable. Si l’on ajoute à cela l’interprétation incroyable de John Amplas, qui ouvre constamment son jeu et donne mille facettes au personnage de Martin, on obtient ce qui est pour beaucoup le meilleur film de George A. Romero, son œuvre la plus belle et la plus triste. Notes : - Les captures sont issues du dvd, et ne respectent donc pas le format d’origine du film.- Il existerait, selon Romero lui même, une version originale du film de 2h45 (il en fait mention dans les commentaires audio de l’édition Anchor Bay) entièrement en noir et blanc. Mais cette copie du film aurait été subtilisée du laboratoire. Image : Le film est présenté dans un nouveau transfert haute définition en 16 :9. Martin a été tourné en 16mm, au format 1.33, l’image a donc été matté pour obtenir une version en 1.85. Il est dommageable de découvrir le film dans ces conditions, le cadrage étant bien évidemment pensé pour du Full Frame. Mais l’édition Anchor Bay, qui respectait le format d’origine, étant épuisée, et en attendant de vérifier le choix de Wild Side pour la sortie prochaine d’un double DVD Z2, c’est actuellement la seule possibilité de voir le film (on peut citer une édition Arrow qui ne vaut guère plus qu’une VHS usagée) . Cela dit, le résultat n’est pas aussi rebutant que ce qui était prévisible, Lion’s Gate ayant visiblement réfléchi constamment à ce recadrage. Bien entendu, il est conseillé de découvrir le film dans son format d’origine, mais il n’est pas honteux de l’apprécier dans cette version, même si certaines scènes pâtissent réellement de ce choix éditorial plus que douteux. La copie est très propre et le transfert une véritable réussite, même si on peut regretter des couleurs parfois saturées. Richard Rubinstein, le producteur, précise d’ailleurs dans les commentaires audio que le coût de ce transfert correspond à la moitié du budget du film Image : Le film est au format 1.77 équivalent à l’édition Lion’s Gate ce qui nous permet d’enfoncer un peu plus le clou d’autant qu’un autre facteur rentre en jeu. En effet, la copie a subi un traitement de fond qui fait presque disparaître le grain d’origine, et l’un des charmes du Martin d’origine de s’évaporer. Cette propension à aplanir les films, à les faire rentrer dans un moule (format panoramique, image lisse et propre) ne cesse de nous surprendre. Si la raison économique saute aux yeux, il devrait être du devoir d’un éditeur aussi exigeant et cinéphile que l’est Wild Side de proposer au moins le film dans sa version d’origine. A vouloir à tout prix formater les films, que deviennent-ils au final ? Ils n’acquièrent pas une aura commerciale du fait de ces nettoyages et perdent du même coup leur saveur propre. Car le Martin que nous avons découvert en salle n’existe maintenant plus que dans notre souvenir. Cette bande rugueuse, brute, sortie de nulle part, tend à se confondre avec le reste de la production. Heureusement le chef d’œuvre de Romero pourrait subir mille outrages qu’il conserverait sa puissance unique. Mais qu’en est-il d’autres films moins personnels, moins forts, qui nous ont marqué d’abord par leur côté viscéral ? Pour en revenir au chapitre technique, le problème de ce nettoyage est de créer de légers fourmillements sur les textures claires et les visages. La colorimétrie a tendance à tirer un peu sur le vert. La luminosité est plus poussée que dans l’édition Lion’s gate, ce qui produit des scènes de nuit peut-être plus lisibles mais où les noirs sont bien moins profonds. La définition est quant à elle améliorée par rapport au zone 1.
Martin sort demain chez Wild side video, l’occasion de revenir sur trois œuvres oubliées, bien plus intéressantes, à mon goût, que le Land of the dead. "Martin est un jeune homme de 17 ans. Recueilli par son oncle Cuda à Braddock en Pennsylvanie, il est rapidement mis en garde par son tuteur : Martin est un Nosferatu, un vampire âgé de 84 ans, et Cuda doit sauver son âme avant de détruire son enveloppe terrestre. Des meurtres perpétrés par Martin semblent donner raison à son oncle, meurtres au cours desquels Martin boit le sang de ses victimes mais où aucun pouvoir fantastique ne transparaît. Alors Martin : vampire moderne ? fantasme d’une communauté intégriste ? tueur en série ? Le film s’ouvre sur la montée de Martin dans un train et sa recherche d’une victime, séquence parmi les plus fortes de la riche filmographie de George A. Romero. Extrêmement découpée, elle se compose en partie d’une succession des gros plans d’une précision démoniaque qui amènent inéluctablement au cœur de la scène. Le spectateur est immédiatement plongé dans le film, et sans explication aucune, va assister au meurtre d’une passagère. Le noir et blanc fait son apparition alors que Martin a choisi sa proie. Il l’imagine l’accueillant amoureusement dans ses bras, et lorsque celle- ci lutte contre son agresseur, la vision fantasmée de la scène par Martin va venir contaminer la brutalité effective du meurtre en une juxtaposition inédite. Prodigieusement monté, le meurtre voit la fureur défensive de la femme céder la place à l’inquiétude, puis quasiment à son abandon dans les bras de son agresseur. C’est l’image même de la figure mythique de la victime d’un vampire qui succombe au charme érotique de la créature. Seulement ici, point de charme fantastique, mais l’usage d’un substitut chimique, la femme s’assoupissant sous l’effet d’une drogue. Cette séquence contient en germe ce qu’est Martin, incarnation de la frontière ténue qui sépare un fantasme religieux et mythique (le vampire et ses facultés fantastiques) d’une psychose ancrée dans le quotidien. Martin est-il un vampire ou un adolescent psychotique ? Romero n’explicite pas les doutes semés par son intrigue et rien n’interdit d’imaginer que Martin est bel et bien un Nosferatu. Le réalisateur n’assène pas sa vision et laisse le champ libre à l’interprétation, comme ailleurs il refuse d’expliquer la raison de la présence sur terre des morts vivants (juste un laconique : "quand il n’y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre") ou allégorie d’une société que Romero se plaît à disséquer (le quatuor des morts vivants). Que Martin soit un vampire ou non, il est de toute manière isolé comme nombre d’adolescent de son âge, vit les mêmes frustrations. Que Martin soit un vampire ou non, le fait est qu’il tue. Romero observe son héros en multipliant les pistes pour s’en approcher, montrant par là qu’une psychose destructrice est le fruit de nombreux éléments (frustration sexuelle, impuissance, crise d’identité, environnement familial et aliénation sociale…) mais n’est surtout pas réductible à un seul élément : "tu es mauvais, tu es un vampire". Cette fixation de l’oncle Cuda sur le Nosferatu est la critique virulente d’une vision manichéenne du monde, religieuse et rétrograde. « A l’origine, Martin est d’abord une blague. Que se passerait-il si un Vampire était vraiment condamné à vivre éternellement ? Sans doute devrait-il changer les photos de son passeport, de son permis de conduire… Au départ, l’idée était donc de faire une comédie sur les problèmes très concrets, triviaux même, auxquels serait réellement confronté un vampire. » (in. Simulacres). Si le projet abandonne rapidement les rives de la comédie, cette omniprésence du quotidien vient complètement envahir la mythologie du film de vampire, jusqu’à faire passer au second plan l’aspect fantastique pour se concentrer sur une vision naturaliste du vampirisme, vu alors comme reflet des troubles adolescents et véritable maladie mentale. Car Martin a réellement besoin de sang, dans son corps, dans sa chair. Et sa psychose se nourri de toute la fantasmagorie du vampire, véhiculée par l’obscurantisme de son oncle, seul moyen pour Martin de survivre mentalement à l’atrocité des meurtres qu’il commet. Martin est un réceptacle, un véritable héros tragique offert en sacrifice à une société en déliquescence. La ville de Braddock est l’image même de ce monde mourant, « The Magic is all gone » dit Martin. La musique absolument sublime de Donald Rubinstein, achève de donner au film un ton poignant, mêlé de tristesse et de nostalgie. Dans le cinéma de Romero, le fantastique est un moyen d’échapper à l’aliénation. C’est la sorcellerie vers laquelle se tourne l’héroïne de Season of the Witch, la folie destructrice qui s’empare des habitants de The Crazies, le vampirisme qui rassemble autour de Martin les fans (il intervient dans une émission radio) et les combattants du mal (exorcismes, foule à la poursuite du Nosferatu). Les meurtres de Martin ne sont d’ailleurs peut-être qu’un autre moyen de transfigurer son quotidien, de s’affranchir de la tristesse de la banlieue dans laquelle il évolue, de se reconstruire une vie où il est désiré et craint. La transfiguration du quotidien passe par des scènes fantasmatiques en noir et blanc qui ponctuent le parcours de Martin. Scènes de son passé de vampires pourchassé dans les Carpates, vision décalée des meurtres qu’il commet où ses victimes l’invitent dans leurs lits. Toute une imagerie gothique est ici convoquée dans une représentation caricaturale nourrie de toute l’iconographie des films de Vampire. La demeure de Cuda, avec ses icônes religieuses omniprésentes, ses crucifix, ses gousses d’ails, se plie aussi à ce folklore suranné et au fantasme du vieil homme à être une incarnation de Van Helsing. L’architecture même de la ville dévoile des apparences médiévales qui se mêlent aux paysages d’une banlieue sinistrée (voix de chemins de fers, parkings de supermarché, casses automobiles). Des immeubles semblent par moment s’élever comme des cathédrales, décors dont la puissance est accentuée par des contre plongées appuyées. On a ainsi le sentiment que toute la ville est contaminée par l’irrationnel, à la fois perception chimérique de Martin et de son oncle, et berceau de leur folie respective. Si la névrose de Martin est spectaculaire, celle de Cuda est plus insidieuse et bien plus répandue celle du jeune homme et on imagine aisément que son intégrisme est à la base d’un traumatisme enfantin de Martin. Vision fondamentaliste de la maladie mentale qui ne peut s’expliquer que par la possession démoniaque. Martin tente, quand il le peut, quand il n’est pas submergé par ce folklore, de lutter contre cette conception archaïque. Il tente de ramener son oncle à la raison, en lui montrant qu’il peut croquer dans de l’ail et tenir un crucifix. Quand dans une scène, il apparaît en vampire, c’est un véritable vampire de pacotille avec tenue grandiloquente et fausses dents… une manière de décrédibiliser le mythe, de se moquer de son oncle et de ses croyances ancestrales. Gestuelle, costume… tout confère à donner à cette scène, qui se passe près d’un manège, une apparence de foire. Le film est une lutte constante entre la normalité, même si elle passe par l’acceptation d’une psychose, et le fantastique. Une séquence est à cet égard très parlante : lors du meurtre d’un clochard, toute l’imagerie gothique s’évanouit, et c’est juste la crasse, le côté misérable dénué de toute afféterie, qui explose, qui saisit Martin. Ce meurtre ne se pare par de l’aura érotique habituelle. Martin est alors sexuellement satisfait, et étant devenu l’amant d’une habitante de Braddock, seul son besoin de sang le pousse à tuer. Il n’a plus la possibilité de se réfugier dans une vision fantasmée. La sexualité est omniprésente dans le film. La dimension érotique du vampirisme est clairement énoncée : ce n’est pas le sang qui est convoité, mais bel et bien la consommation de sexe, Martin s’entourant des bras de ses victimes endormies, les étreignant amoureusement. Alors que la production fantastique actuelle stagne dans les remakes et le second degré, que la renaissance du genre est annoncée à grands cris à chaque fois qu’un film sort un tantinet du lot pour être aussi vite oublié, que seule l’Asie nous permet encore d’échapper à l’esthétique abominable imposée par des producteurs décérébrés qui confondent pub et cinéma, il est vivifiant de se replonger dans le fantastique des années 1970 ou de véritables auteurs arrivaient à réaliser des œuvres radicales et crues, bourrées d’intelligence et de sincérité. Martin a été tourné pour un budget ridicule de 270,000$, en l’espace de six semaines. Figurants et acteurs viennent de l’entourage de Romero et de son équipe, la maison de Cuda a été gracieusement prêtée par une vieille dame tandis que la police même mettait à disposition ses véhicules. Cette manière de concevoir un film loin des studios, en toute indépendance, terme tellement galvaudé mais qui ici le décrit parfaitement, était alors possible grâce au statut de B Movies qui permettait à de tels films de tenir l’affiche durant une longue période. Ainsi ils se faisaient connaître sans avoir recours à la publicité et des œuvres radicales et décalées, qu’aucun studio n’aurait soutenu, pouvaient voir le jour sans être soumis au diktat imbécile des publicitaires et de ceux qui ne voient dans le cinéma que merchandising et box office. Martin tint ainsi 18 mois en séance de nuit, rencontra tranquillement son public et acquit tout naturellement son statut de film culte. Au-delà d’un mode de production salvateur, il faut également admettre que si Martin ne donne jamais l’impression de souffrir de son budget, c’est grâce à la motivation et au talent de chaque participant. Si le tournage en 16mm accentue grandement le côté cru de la photographie, c’est à son chef opérateur qu’on le doit. Pour sa première expérience à ce poste (poste qu’il ne tiendra d’ailleurs que dans des films de Romero) Michael Gornick fait preuve d’une maturité étonnante en captant à merveille les intérieurs, les visages, les vues de Pittsburgh. Il joue du grain de la pellicule et donne au film, sous l’œil savant de Romero, une beauté étrange et envoûtante. Si la beauté renversante de la musique transcende complètement le film, le son et le mixage jouent un rôle primordial dans la conception de l’univers si particulier de Martin. Romero dit s’être inspiré des Contes d’Hoffman de Michael Powell et Emeric Pressburger, dans des expériences visuelles et sonores où il fait s’opposer un découpage haché à une musique ralentie à l’extrême. Croyance dans les vertus du cinéma, inventivité, honnêteté, investissement, autant de valeurs qui remplacent le budget le plus confortable. Si l’on ajoute à cela l’interprétation incroyable de John Amplas, qui ouvre constamment son jeu et donne mille facettes au personnage de Martin, on obtient ce qui est pour beaucoup le meilleur film de George A. Romero, son œuvre la plus belle et la plus triste. Notes : - Les captures sont issues du dvd, et ne respectent donc pas le format d’origine du film.- Il existerait, selon Romero lui même, une version originale du film de 2h45 (il en fait mention dans les commentaires audio de l’édition Anchor Bay) entièrement en noir et blanc. Mais cette copie du film aurait été subtilisée du laboratoire. Image : Le film est présenté dans un nouveau transfert haute définition en 16 :9. Martin a été tourné en 16mm, au format 1.33, l’image a donc été matté pour obtenir une version en 1.85. Il est dommageable de découvrir le film dans ces conditions, le cadrage étant bien évidemment pensé pour du Full Frame. Mais l’édition Anchor Bay, qui respectait le format d’origine, étant épuisée, et en attendant de vérifier le choix de Wild Side pour la sortie prochaine d’un double DVD Z2, c’est actuellement la seule possibilité de voir le film (on peut citer une édition Arrow qui ne vaut guère plus qu’une VHS usagée) . Cela dit, le résultat n’est pas aussi rebutant que ce qui était prévisible, Lion’s Gate ayant visiblement réfléchi constamment à ce recadrage. Bien entendu, il est conseillé de découvrir le film dans son format d’origine, mais il n’est pas honteux de l’apprécier dans cette version, même si certaines scènes pâtissent réellement de ce choix éditorial plus que douteux. La copie est très propre et le transfert une véritable réussite, même si on peut regretter des couleurs parfois saturées. Richard Rubinstein, le producteur, précise d’ailleurs dans les commentaires audio que le coût de ce transfert correspond à la moitié du budget du film Image : Le film est au format 1.77 équivalent à l’édition Lion’s Gate ce qui nous permet d’enfoncer un peu plus le clou d’autant qu’un autre facteur rentre en jeu. En effet, la copie a subi un traitement de fond qui fait presque disparaître le grain d’origine, et l’un des charmes du Martin d’origine de s’évaporer. Cette propension à aplanir les films, à les faire rentrer dans un moule (format panoramique, image lisse et propre) ne cesse de nous surprendre. Si la raison économique saute aux yeux, il devrait être du devoir d’un éditeur aussi exigeant et cinéphile que l’est Wild Side de proposer au moins le film dans sa version d’origine. A vouloir à tout prix formater les films, que deviennent-ils au final ? Ils n’acquièrent pas une aura commerciale du fait de ces nettoyages et perdent du même coup leur saveur propre. Car le Martin que nous avons découvert en salle n’existe maintenant plus que dans notre souvenir. Cette bande rugueuse, brute, sortie de nulle part, tend à se confondre avec le reste de la production. Heureusement le chef d’œuvre de Romero pourrait subir mille outrages qu’il conserverait sa puissance unique. Mais qu’en est-il d’autres films moins personnels, moins forts, qui nous ont marqué d’abord par leur côté viscéral ? Pour en revenir au chapitre technique, le problème de ce nettoyage est de créer de légers fourmillements sur les textures claires et les visages. La colorimétrie a tendance à tirer un peu sur le vert. La luminosité est plus poussée que dans l’édition Lion’s gate, ce qui produit des scènes de nuit peut-être plus lisibles mais où les noirs sont bien moins profonds. La définition est quant à elle améliorée par rapport au zone 1.The Crazies & Season of the witch
Les deux films de Romero furent tournés en 16mm puis gonflés en 35mm au format standard 1.33. La restauration numérique produit des miracles. Pendant longtemps, les spectateurs français n’avaient eu qu’une copie charbonneuse et sombre, à la définition sommaire, en mauvais état à visionner pour The Crazies : la fameuse copie v.f. sortie avec 7 ans de retard au cinéma et transférée telle quelle en VHS Secam. Ici la plupart de ses défauts ont disparus suite à une très belle restauration américaine. Définition, luminosité, couleurs : tout a été amélioré et le film acquiert une nouvelle jeunesse. Concernant Season of the Witch, inédit en France mis à part à la Cinémathèque Française lors d’une rétrospective Romero le jeudi 6 décembre 2001, c’est la première fois que le film bénéficie d’une distribution vidéo en France : elle est effectuée dans les mêmes conditions et le résultat est tout aussi remarquable.Reste tout de même que le transfert de Season of the Witch tire sur le vert, perturbé encore par quelques poussières et sauts d'images, la compression étant largement perfectible. The Crazies s'en sort nettement mieux de ce côté là, même si le résultat n'est pas encore parfait Seules les Mono v.o.s.t.f. nous sont proposées. C’est bien sûr l’essentiel : c’est la première fois en France que ces v.o.s.t.f. sont distribuées en vidéo et c’est une découverte magnifique. Mais on aurait aimé disposer aussi du doublage français honorable de 1979 pour The Crazies [La nuit des fous vivants]. Question de droits ou de perte du matériel toujours regrettable : on ne jette pas la pierre à l’éditeur tant les questions de droits et de matériel sont régulièrement inextricables sur certains films. Techniquement ces pistes bénéficient d'une clarté globale appréciable, même si l'on note du souffle dans certaines voix et musiques.
The Crazies (La Nuit des Fous Vivants, 1973)
 Connu aussi sous les noms "Code Name Trixie" et "Cosmos 859"Avec W.G. Mc Millan, Harold Wayne, Lane Carrol, Jones Lloyd Hollar, Lynn Lowrie, Richard Liberty,…Un virus transformé en arme bactériologique secrète, répandu accidentellement dans l’eau d’une rivière par l’armée à la suite d’un accident d’avion, transforme les habitants de la villeaméricaine la plus proche en fous meurtriers. Face à l’ampleur du carnage, l’armée délimite, boucle puis quadrille le périmètre contaminé. Washington dépêche sur place un chercheur du projet "Trixie", nom de code militaire de ce virus – qu’on se tient prêt à atomiser en cas d’excessive propagation à l’aide d’un bombardier B-52. L’armée, soumise à des assauts continuels, abat sans sommation ceux qui l’attaquent mais aussi ceux qui veulent franchir le périmètre. Un petit groupe de civils décide de se frayer un chemin armé hors du périmètre. Mais la folie guette ses membres, engagés dorénavant dans une lutte à mort de tous les instants… Second chef-d’œuvre de Romero, et son quatrième film si on suit la chronologie de sa filmographie puisqu’il fut tourné après Season of the Witch. Son importance intrinsèque justifie que nous le critiquions en premier. On peut en effet le considérer comme le chaînon manquant à sa désormais classique trilogie des morts-vivants pour qu’elle devienne une authentique tétralogie. Sorti très tardivement et confidentiellement à Paris en salles vers 1979, dans une copie bien doublée mais assez abîmée, sous un titre qui évoquait naturellement de Night of the Living Dead [La nuit des morts vivants] (USA 1968) par la suite exploitée en VHS Secam sous le titre Experiment 2000 chez Victory Video et Reflex Video, The Crazies [La nuit des fous vivants] est connu aussi aux USA sous les titres Cosmos 859 et Code Name Trixie. Le titre d’exploitation français est parfaitement adapté au climat du film et indique avec raison une analogie de structure. Deux grandes différences néanmoins entre le film de 1968 et celui de 1972 : l’emploi de la couleur d’une part et l’argument du scénario qui est moins "fantastique" que "science-fiction" et accentue même encore l’aspect "politique-fiction". On pense plus d’une fois au cinéma de Peter Watkins lorsqu’on visionne The Crazies. Mais certains aspects proprement fantastiques et son petit budget magnifiquement exploité sous forme d’une liberté parfois expérimentale à l’absolue virulence le rattachent néanmoins directement au chef-d’œuvre de 1968 dont il est clairement une variation : les morts-vivants cannibales étant remplacés par des fous assassins. À noter son extrême violence, au rythme encore plus hallucinant (on y tue pratiquement sans arrêt), et un emploi forcené de la carabine USM2 encore en dotation à l’époque dans bien des unités : elle se différencie de la USM1 originale par son sélecteur pour le tir automatique en rafales, aux effets dévastateurs dans le film comme dans la réalité. Mis à part la charmante Lynn Lowry que l’on retrouvera peu de temps après dans Parasite Murders / Shivers [Frissons] - le premier grand film fantastique de David Cronenberg -le reste de l’interprétation est pratiquement inconnu mais très souvent excellent à commencer par les deux héros, stupéfiants de présence et d’efficacité dramatique. Jean-François Rauger a justement remarqué dans son article sur Romero édité dans le Programme de la Cinémathèque Française de novembre-décembre 2001 (c’est une évidence mais il est toujours bon d’écrire une évidence : en général personne n’a songé à le faire auparavant) que le thème de l’armée anonyme dont les visages sont recouverts de masques à gaz est un point commun à The Crazies et à Dawn of the Dead. Et aussi que tout comme dans Night of the Living Dead, un groupe de rescapés est pris en tenaille entre monstres inhumains et milices ou armées contraintes à devenir non-moins inhumaines, d’où un suspense étouffant qui ne se relâche jamais. Ajoutons que ce sera aussi la structure de Day of the Dead : la société civile y est prise en tenaille de la même manière mais des interactions se produisent entre les trois groupes. En fait, elles se produisent dans les 4 films. N’importe quel individu peut passer d’une catégorie à l’autre à tout moment, au gré des bouleversements de l’action. Romero dit d’ailleurs explicitement dans son entretien que son thème profond n’est pas politique mais proprement cosmologique et donc authentiquement fantastique. Ce qui l’intéresse, c’est l’hypothèse terrifiante du remplacement, de l’absorption du monde humain par un autre monde, par une nouvelle communauté régie par ce qui n’est plus morale ou esprit mais instinct. Le fait que le thème de l’inceste fasse irruption au cœur même du film est un autre signe spectaculaire du bouleversement de l’ordre humain irréversible provoqué par la catastrophe. L’aspect critique et politique qu’on croit lire dans l’œuvre fantastique de Romero, c’est la conséquence morale parallèle de ce chevauchement que Romero s’attache à dépeindre avec précision. La précision d’une peinture eschatologique comme celle-ci engendre inévitablement un aspect critique mais il est secondaire et non primaire car conséquence n’est pas cause. La nuit des fous vivants est donc bien un très grand film, autant que ses cousins indispensable à une évaluation correcte du génie de Romero. Il était scandaleusement négligé et oublié en France et nous félicitons vivement Wild Side de l’avoir réédité en DVD. L’intégralité de la tétralogie romerienne est à présent disponible en France sur support numérique grâce à cette heureuse initiative.
Connu aussi sous les noms "Code Name Trixie" et "Cosmos 859"Avec W.G. Mc Millan, Harold Wayne, Lane Carrol, Jones Lloyd Hollar, Lynn Lowrie, Richard Liberty,…Un virus transformé en arme bactériologique secrète, répandu accidentellement dans l’eau d’une rivière par l’armée à la suite d’un accident d’avion, transforme les habitants de la villeaméricaine la plus proche en fous meurtriers. Face à l’ampleur du carnage, l’armée délimite, boucle puis quadrille le périmètre contaminé. Washington dépêche sur place un chercheur du projet "Trixie", nom de code militaire de ce virus – qu’on se tient prêt à atomiser en cas d’excessive propagation à l’aide d’un bombardier B-52. L’armée, soumise à des assauts continuels, abat sans sommation ceux qui l’attaquent mais aussi ceux qui veulent franchir le périmètre. Un petit groupe de civils décide de se frayer un chemin armé hors du périmètre. Mais la folie guette ses membres, engagés dorénavant dans une lutte à mort de tous les instants… Second chef-d’œuvre de Romero, et son quatrième film si on suit la chronologie de sa filmographie puisqu’il fut tourné après Season of the Witch. Son importance intrinsèque justifie que nous le critiquions en premier. On peut en effet le considérer comme le chaînon manquant à sa désormais classique trilogie des morts-vivants pour qu’elle devienne une authentique tétralogie. Sorti très tardivement et confidentiellement à Paris en salles vers 1979, dans une copie bien doublée mais assez abîmée, sous un titre qui évoquait naturellement de Night of the Living Dead [La nuit des morts vivants] (USA 1968) par la suite exploitée en VHS Secam sous le titre Experiment 2000 chez Victory Video et Reflex Video, The Crazies [La nuit des fous vivants] est connu aussi aux USA sous les titres Cosmos 859 et Code Name Trixie. Le titre d’exploitation français est parfaitement adapté au climat du film et indique avec raison une analogie de structure. Deux grandes différences néanmoins entre le film de 1968 et celui de 1972 : l’emploi de la couleur d’une part et l’argument du scénario qui est moins "fantastique" que "science-fiction" et accentue même encore l’aspect "politique-fiction". On pense plus d’une fois au cinéma de Peter Watkins lorsqu’on visionne The Crazies. Mais certains aspects proprement fantastiques et son petit budget magnifiquement exploité sous forme d’une liberté parfois expérimentale à l’absolue virulence le rattachent néanmoins directement au chef-d’œuvre de 1968 dont il est clairement une variation : les morts-vivants cannibales étant remplacés par des fous assassins. À noter son extrême violence, au rythme encore plus hallucinant (on y tue pratiquement sans arrêt), et un emploi forcené de la carabine USM2 encore en dotation à l’époque dans bien des unités : elle se différencie de la USM1 originale par son sélecteur pour le tir automatique en rafales, aux effets dévastateurs dans le film comme dans la réalité. Mis à part la charmante Lynn Lowry que l’on retrouvera peu de temps après dans Parasite Murders / Shivers [Frissons] - le premier grand film fantastique de David Cronenberg -le reste de l’interprétation est pratiquement inconnu mais très souvent excellent à commencer par les deux héros, stupéfiants de présence et d’efficacité dramatique. Jean-François Rauger a justement remarqué dans son article sur Romero édité dans le Programme de la Cinémathèque Française de novembre-décembre 2001 (c’est une évidence mais il est toujours bon d’écrire une évidence : en général personne n’a songé à le faire auparavant) que le thème de l’armée anonyme dont les visages sont recouverts de masques à gaz est un point commun à The Crazies et à Dawn of the Dead. Et aussi que tout comme dans Night of the Living Dead, un groupe de rescapés est pris en tenaille entre monstres inhumains et milices ou armées contraintes à devenir non-moins inhumaines, d’où un suspense étouffant qui ne se relâche jamais. Ajoutons que ce sera aussi la structure de Day of the Dead : la société civile y est prise en tenaille de la même manière mais des interactions se produisent entre les trois groupes. En fait, elles se produisent dans les 4 films. N’importe quel individu peut passer d’une catégorie à l’autre à tout moment, au gré des bouleversements de l’action. Romero dit d’ailleurs explicitement dans son entretien que son thème profond n’est pas politique mais proprement cosmologique et donc authentiquement fantastique. Ce qui l’intéresse, c’est l’hypothèse terrifiante du remplacement, de l’absorption du monde humain par un autre monde, par une nouvelle communauté régie par ce qui n’est plus morale ou esprit mais instinct. Le fait que le thème de l’inceste fasse irruption au cœur même du film est un autre signe spectaculaire du bouleversement de l’ordre humain irréversible provoqué par la catastrophe. L’aspect critique et politique qu’on croit lire dans l’œuvre fantastique de Romero, c’est la conséquence morale parallèle de ce chevauchement que Romero s’attache à dépeindre avec précision. La précision d’une peinture eschatologique comme celle-ci engendre inévitablement un aspect critique mais il est secondaire et non primaire car conséquence n’est pas cause. La nuit des fous vivants est donc bien un très grand film, autant que ses cousins indispensable à une évaluation correcte du génie de Romero. Il était scandaleusement négligé et oublié en France et nous félicitons vivement Wild Side de l’avoir réédité en DVD. L’intégralité de la tétralogie romerienne est à présent disponible en France sur support numérique grâce à cette heureuse initiative.Season of the Witch (1973)
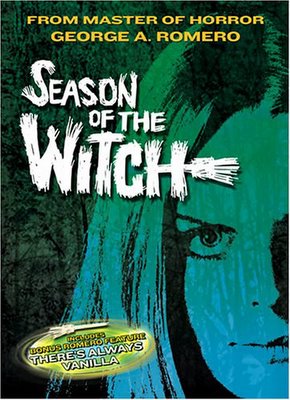 Connu aussi sous les noms "Jack’s Wife", "Hungry Wives", "Witches" Le sommeil de Joan Mitchell, mère de famille aisée mais insatisfaite, est troublé de cauchemars de plus en plus étranges. On lui présente une voisine qui, dit-on, est une sorcière. Elle hésite à la rencontrer mais devient vite fascinée au point qu’elle devient elle-même une sorcière. Imaginaire ou réalité : la ligne est ténue et bientôt rouge de sang. 3ème long-métrage tourné par Romero après Night of the Living Dead (1968) et There’s Always Vanilla (1971) et second échec financier. Romero a eu bien des difficultés à achever le film et même à la tourner. Mais il est, en dépit de son thème très classique, original. Il est tout imprégné de l’esthétique underground des années 70 mais il s’en détache par un strict découpage qui ne laisse pas place au hasard. Son échec commercial est dû tout bonnement à l’absence de violence qui n’intervient que vers la fin du film. L’hésitation entre comédie dramatique, drame psychologique, film underground et cinéma fantastique pur se traduit dans la diversité des titres sous lequel le film est connu : Jack’s Wife / Hungry Wives / Witches. Hésitation de genre, indécision foncière qui sont souvent préjudiciables au succès critique et public d’un film bien qu’elles soient pourtant souvent savoureuses et passionnantes en elles-mêmes et historiquement. C’est bien le cas ici et on s’étonne qu’il ait fallu attendre si longtemps pour découvrir un tel film en France. Les admirateurs de la trilogie/tétralogie seront évidemment un peu déçus. Mais les historiens du cinéma, et ceux qui aspirent à devenir connaisseurs émérites de l’intégralité de la filmographie romérienne, découvriront un film certes inégal mais attachant. Notons que la chanson Season of the Witch est audible dans la bande-son du film et qu’elle confère une étrange résonance à cet essai de fantastique qui dépeint une société aussi strictement contemporaine que les chefs-d’œuvre authentiques qui rendent le maître célèbre. Romero est impitoyable envers la "Beat Generation" : il la critique avec une froide lucidité. Il est de tout cœur du côté de son héroïne : son amant libertaire est présenté du début à la fin comme un personnage ridicule et fat qui ne peut lui apporter ni sincérité ni amour réel. Il n’est pas un meilleur remède à sa solitude que son mari – caricature pour sa part de l’homme américain moyen et intégré, caricature d’ailleurs tout aussi virulente ou que sa fille – adolescente égoïste appartenant à la même "Beat Generation". C’est peut-être du cœur de cette peinture de la solitude féminine – et de cette communauté de solitudes rassemblées autour du thé l’après-midi et très étonnante de vigueur - autant que du thème évident du film que surgit l’aspect proprement et authentiquement fantastique. C’est un aspect de la thématique de Romero qui sera illustré dans Martin (USA 1978) et dans Monkey Shines [Incident de parcours] (USA 1988) : l’impossibilité de communiquer réellement avec autrui engendre un déséquilibre au sein duquel le mal ou la folie naît avec la plus grande facilité. Un point commun, en somme, entre Romero et… Ingmar Bergman ! Mais un point déjà exploité, et autrement mieux, par Terence Fisher. Ce sont les satires à visée contemporaine un peu trop évidente qui vieillissent parfois les plus vites. Celui-ci échappe à cette définition précisément parce qu’il est d’abord et avant tout un honnête conte fantastique, même si habillé aux couleurs "critiques" en vigueur à l’époque.
Connu aussi sous les noms "Jack’s Wife", "Hungry Wives", "Witches" Le sommeil de Joan Mitchell, mère de famille aisée mais insatisfaite, est troublé de cauchemars de plus en plus étranges. On lui présente une voisine qui, dit-on, est une sorcière. Elle hésite à la rencontrer mais devient vite fascinée au point qu’elle devient elle-même une sorcière. Imaginaire ou réalité : la ligne est ténue et bientôt rouge de sang. 3ème long-métrage tourné par Romero après Night of the Living Dead (1968) et There’s Always Vanilla (1971) et second échec financier. Romero a eu bien des difficultés à achever le film et même à la tourner. Mais il est, en dépit de son thème très classique, original. Il est tout imprégné de l’esthétique underground des années 70 mais il s’en détache par un strict découpage qui ne laisse pas place au hasard. Son échec commercial est dû tout bonnement à l’absence de violence qui n’intervient que vers la fin du film. L’hésitation entre comédie dramatique, drame psychologique, film underground et cinéma fantastique pur se traduit dans la diversité des titres sous lequel le film est connu : Jack’s Wife / Hungry Wives / Witches. Hésitation de genre, indécision foncière qui sont souvent préjudiciables au succès critique et public d’un film bien qu’elles soient pourtant souvent savoureuses et passionnantes en elles-mêmes et historiquement. C’est bien le cas ici et on s’étonne qu’il ait fallu attendre si longtemps pour découvrir un tel film en France. Les admirateurs de la trilogie/tétralogie seront évidemment un peu déçus. Mais les historiens du cinéma, et ceux qui aspirent à devenir connaisseurs émérites de l’intégralité de la filmographie romérienne, découvriront un film certes inégal mais attachant. Notons que la chanson Season of the Witch est audible dans la bande-son du film et qu’elle confère une étrange résonance à cet essai de fantastique qui dépeint une société aussi strictement contemporaine que les chefs-d’œuvre authentiques qui rendent le maître célèbre. Romero est impitoyable envers la "Beat Generation" : il la critique avec une froide lucidité. Il est de tout cœur du côté de son héroïne : son amant libertaire est présenté du début à la fin comme un personnage ridicule et fat qui ne peut lui apporter ni sincérité ni amour réel. Il n’est pas un meilleur remède à sa solitude que son mari – caricature pour sa part de l’homme américain moyen et intégré, caricature d’ailleurs tout aussi virulente ou que sa fille – adolescente égoïste appartenant à la même "Beat Generation". C’est peut-être du cœur de cette peinture de la solitude féminine – et de cette communauté de solitudes rassemblées autour du thé l’après-midi et très étonnante de vigueur - autant que du thème évident du film que surgit l’aspect proprement et authentiquement fantastique. C’est un aspect de la thématique de Romero qui sera illustré dans Martin (USA 1978) et dans Monkey Shines [Incident de parcours] (USA 1988) : l’impossibilité de communiquer réellement avec autrui engendre un déséquilibre au sein duquel le mal ou la folie naît avec la plus grande facilité. Un point commun, en somme, entre Romero et… Ingmar Bergman ! Mais un point déjà exploité, et autrement mieux, par Terence Fisher. Ce sont les satires à visée contemporaine un peu trop évidente qui vieillissent parfois les plus vites. Celui-ci échappe à cette définition précisément parce qu’il est d’abord et avant tout un honnête conte fantastique, même si habillé aux couleurs "critiques" en vigueur à l’époque.lundi, février 20, 2006
Give peace Hutchence.
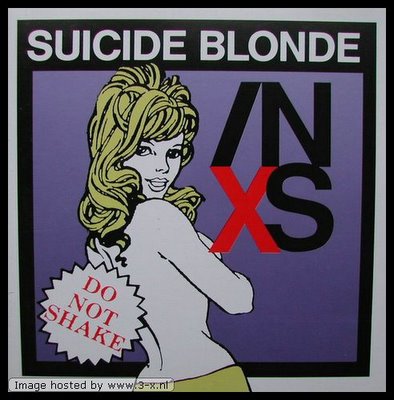 Je mate une vieille émission sur Gainsbourg où l’on visite sa maison du 5bis rue de verneuil et sur une pile de Cd le kick de INXS quoi ? un mec comme Gainsbourg qui écoutait de la popfm ? du coup je replonge dans ce groupe du siècle dernier qui à longtemps tourné sur mon walkman de 17 kg. "Le chanteur vedette du groupe de rock australien INXS, Michael Hutchence (trente-sept ans), a été découvert pendu à l’aide d’une ceinture de cuir, samedi, dans une suite luxueuse du Ritz Carlton de Sidney. Sa compagne Paula Yates, présentatrice à la télévision britannique, ancienne épouse du chanteur irlandais Bob Geldoff, "complètement bouleversée et effondrée", s’est aussitôt envolée pour l’Australie avec Tiger Lily, la petite fille qu’elle a eue avec lui. Dans la chambre de la star ont été découverts plusieurs médicaments prescrits, mais nulle drogue illégale, selon la police australienne. Le 18 octobre dernier, à Londres, Michael Hutchence avait été arrêté pour détention de drogue, puis avait été remis en liberté sous caution. Toujours selon les enquêteurs, cette mort n’est pas entourée de circonstances suspectes. Les fans de l’artiste, sitôt sa disparition annoncée, ont afflué devant l’hôtel. Hutchence était dans son pays natal pour y entamer une tournée marquant le vingtième anniversaire du groupe qu’il avait créé à Perth, en compagnie d’Andrew et Tim Farris. INXS avait vite connu le succès en Australie, puis aux Etats-Unis, notamment avec l’album intitulé "Kick". On notait néanmoins, ces derniers temps, une perte d’influence du groupe. Hutchence était beau gars. On le comparaît volontiers, pour le style, à Mick Jagger ou Jim Morrison, le chanteur des Doors, retrouvé mort le 3 juillet 1971 dans la baignoire de l’appartement qu’il avait loué à Paris. Michael Hutchence entre ainsi dans la légende sombre du rock, aux côtés de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin et quelques autres. Originaires d’Australie, le chanteur Michael Hutchence, né le 22 janvier 1960 à Lain Cove et décédé le 22 novembre 1997 à Sydney en Australie, le claviériste Andrew Farriss né le 27 mars 1959 à Perth, le guitariste Tim Farriss né le 16 août à Perth, le batteur et chanteur Jon Farriss né le 10 août 1961 à Perth, le bassiste et chanteur Garry Gary Beers né le 22 juin 1957 à Sydney et le guitariste, saxophoniste et chanteur Kirk Pengilly né le 04 août 1958 à Sydney, fondent le groupe The Farriss Brothers à Sydney en Australie le 16 Août 1977, jour de la mort d’Elvis Presley. En 1978, pendant un an, la formation compose et se produit dans des pubs de l’ouest de l’Australie. En 1979, le groupe joue en première partie des Midnight Oil et rencontre Chris Murphy, qui le lance véritablement dans le monde du rock. La même année, The Farriss Brothers devient INXS. En 1980, le groupe INXS publie son premier album éponyme, qui atteint la 38ème position dans les charts australiens, puis se lance dans une tournée dans toute l’Australie. En 1981, après de nombreux concerts, INXS publie son deuxième album « Underneath The Colours » qui inclut le single « Stay Young », classé 21ème dans les charts australiens. En 1982, à l’occasion d’une tournée, le groupe se produit pour la première fois en Nouvelle-Zélande et en fin d’année, il sort son troisième album "Shabooh Shoobah", ainsi qu’un disque qui regroupe plusieurs titres live et part en tournée dans toute l’Australie. En 1983, INXS signe sur le label Atlantic Records, réalise une véritable première tournée aux Etats-Unis et connaît le succès avec le hit "The One Thing". En fin d’année, la formation sort le hit planétaire "Original Sin", qui arrive à la place de numéro un dans les charts australiens. En 1984, après le succès du single "Original Sin", INXS entreprend sa première tournée mondiale, puis après la publication de son quatrième album "The Swing", le groupe connaît un succès retentissant et occupe la place de numéro un dans les tops musicaux de nombreux pays tels que la France et l’Argentine. En 1985, ils publient "Dekadance" en hommage à leur succès dans les charts, puis jouent pour le concert diffusé dans le monde entier "Live Aid For Africa", organisé par Bob Geldolf, star du rock en Angleterre et mari de Paula Yates. La même année, INXS arrive avec son cinquième album "Listen Like Thieves". En 1986, après un triple disque de platine pour "Listen Like Thieves", le groupe fait une pause, s’occupe de projets personnels et prépare la sortie de l’opus "Kick". En 1987, INXS sort donc son sixième album studio "Kick" et entame le "Kick World Tour". En 1988, "Kick" est certifié disque d’or et de platine, et dans le même temps, le groupe donne moult concerts à guichet fermé à New York. En fin d’année, suite à un superbe concert à Honolulu, le hit légendaire "Need You Tonight" reçoit de nombreuses récompenses. En 1989, après quatorze mois de concert, INXS s’accorde une pause et se consacre à des projets personnels. Quant au chanteur Michael Hutchence, il lance son album solo expérimental "Max-Q". En 1990, INXS revient avec l’album "X" comprenant le single "Suicide Blonde", qui connaît un énorme succès en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie. La même année, le groupe entame son "X Factor Tour", passant dans le monde entier et plus particulièrement en Europe, et dans le même temps, enregistrer le disque « Live Baby Live" en 1991. En 1992, INXS publie l’opus "Welcome To Wherever You Are" qui triomphe Outre-manche, pour arriver en 1993 avec le disque "Full Moon Dirty Hearts" qui connaît un succès mitigé bien que Ray Charles apparaisse dans le morceau "Please (You Got That)". En 1994, le groupe publie son album best of "The Greatest Hits", qui rassemble tous ses plus grands succès. En 1997, après trois ans d’absence, INXS arrive avec le simple "Elegantly Wasted », puis avec un nouvel album du même nom, pour ensuite se lancer dans une tournée mondiale. La même année, la formation célèbre ses vingt ans de carrière à Sydney et effectue son "Lose Your Head Tour". Le 22 novembre 1997, Michael Hutchence se donne malheureusement la mort, dans sa chambre d’hôtel à Sydney. Malgré cette période tragique, INXS continue de se produire dans les salles australiennes et mondiales. Deux ans après le décès de Michael Hutchence, en 1999, un album portant son nom est publié en sa mémoire. L’aventure d’INXS représente un peu plus de vingt années d’existence, durant lesquelles la formation écoule plus de vingt millions d’albums.
Je mate une vieille émission sur Gainsbourg où l’on visite sa maison du 5bis rue de verneuil et sur une pile de Cd le kick de INXS quoi ? un mec comme Gainsbourg qui écoutait de la popfm ? du coup je replonge dans ce groupe du siècle dernier qui à longtemps tourné sur mon walkman de 17 kg. "Le chanteur vedette du groupe de rock australien INXS, Michael Hutchence (trente-sept ans), a été découvert pendu à l’aide d’une ceinture de cuir, samedi, dans une suite luxueuse du Ritz Carlton de Sidney. Sa compagne Paula Yates, présentatrice à la télévision britannique, ancienne épouse du chanteur irlandais Bob Geldoff, "complètement bouleversée et effondrée", s’est aussitôt envolée pour l’Australie avec Tiger Lily, la petite fille qu’elle a eue avec lui. Dans la chambre de la star ont été découverts plusieurs médicaments prescrits, mais nulle drogue illégale, selon la police australienne. Le 18 octobre dernier, à Londres, Michael Hutchence avait été arrêté pour détention de drogue, puis avait été remis en liberté sous caution. Toujours selon les enquêteurs, cette mort n’est pas entourée de circonstances suspectes. Les fans de l’artiste, sitôt sa disparition annoncée, ont afflué devant l’hôtel. Hutchence était dans son pays natal pour y entamer une tournée marquant le vingtième anniversaire du groupe qu’il avait créé à Perth, en compagnie d’Andrew et Tim Farris. INXS avait vite connu le succès en Australie, puis aux Etats-Unis, notamment avec l’album intitulé "Kick". On notait néanmoins, ces derniers temps, une perte d’influence du groupe. Hutchence était beau gars. On le comparaît volontiers, pour le style, à Mick Jagger ou Jim Morrison, le chanteur des Doors, retrouvé mort le 3 juillet 1971 dans la baignoire de l’appartement qu’il avait loué à Paris. Michael Hutchence entre ainsi dans la légende sombre du rock, aux côtés de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin et quelques autres. Originaires d’Australie, le chanteur Michael Hutchence, né le 22 janvier 1960 à Lain Cove et décédé le 22 novembre 1997 à Sydney en Australie, le claviériste Andrew Farriss né le 27 mars 1959 à Perth, le guitariste Tim Farriss né le 16 août à Perth, le batteur et chanteur Jon Farriss né le 10 août 1961 à Perth, le bassiste et chanteur Garry Gary Beers né le 22 juin 1957 à Sydney et le guitariste, saxophoniste et chanteur Kirk Pengilly né le 04 août 1958 à Sydney, fondent le groupe The Farriss Brothers à Sydney en Australie le 16 Août 1977, jour de la mort d’Elvis Presley. En 1978, pendant un an, la formation compose et se produit dans des pubs de l’ouest de l’Australie. En 1979, le groupe joue en première partie des Midnight Oil et rencontre Chris Murphy, qui le lance véritablement dans le monde du rock. La même année, The Farriss Brothers devient INXS. En 1980, le groupe INXS publie son premier album éponyme, qui atteint la 38ème position dans les charts australiens, puis se lance dans une tournée dans toute l’Australie. En 1981, après de nombreux concerts, INXS publie son deuxième album « Underneath The Colours » qui inclut le single « Stay Young », classé 21ème dans les charts australiens. En 1982, à l’occasion d’une tournée, le groupe se produit pour la première fois en Nouvelle-Zélande et en fin d’année, il sort son troisième album "Shabooh Shoobah", ainsi qu’un disque qui regroupe plusieurs titres live et part en tournée dans toute l’Australie. En 1983, INXS signe sur le label Atlantic Records, réalise une véritable première tournée aux Etats-Unis et connaît le succès avec le hit "The One Thing". En fin d’année, la formation sort le hit planétaire "Original Sin", qui arrive à la place de numéro un dans les charts australiens. En 1984, après le succès du single "Original Sin", INXS entreprend sa première tournée mondiale, puis après la publication de son quatrième album "The Swing", le groupe connaît un succès retentissant et occupe la place de numéro un dans les tops musicaux de nombreux pays tels que la France et l’Argentine. En 1985, ils publient "Dekadance" en hommage à leur succès dans les charts, puis jouent pour le concert diffusé dans le monde entier "Live Aid For Africa", organisé par Bob Geldolf, star du rock en Angleterre et mari de Paula Yates. La même année, INXS arrive avec son cinquième album "Listen Like Thieves". En 1986, après un triple disque de platine pour "Listen Like Thieves", le groupe fait une pause, s’occupe de projets personnels et prépare la sortie de l’opus "Kick". En 1987, INXS sort donc son sixième album studio "Kick" et entame le "Kick World Tour". En 1988, "Kick" est certifié disque d’or et de platine, et dans le même temps, le groupe donne moult concerts à guichet fermé à New York. En fin d’année, suite à un superbe concert à Honolulu, le hit légendaire "Need You Tonight" reçoit de nombreuses récompenses. En 1989, après quatorze mois de concert, INXS s’accorde une pause et se consacre à des projets personnels. Quant au chanteur Michael Hutchence, il lance son album solo expérimental "Max-Q". En 1990, INXS revient avec l’album "X" comprenant le single "Suicide Blonde", qui connaît un énorme succès en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie. La même année, le groupe entame son "X Factor Tour", passant dans le monde entier et plus particulièrement en Europe, et dans le même temps, enregistrer le disque « Live Baby Live" en 1991. En 1992, INXS publie l’opus "Welcome To Wherever You Are" qui triomphe Outre-manche, pour arriver en 1993 avec le disque "Full Moon Dirty Hearts" qui connaît un succès mitigé bien que Ray Charles apparaisse dans le morceau "Please (You Got That)". En 1994, le groupe publie son album best of "The Greatest Hits", qui rassemble tous ses plus grands succès. En 1997, après trois ans d’absence, INXS arrive avec le simple "Elegantly Wasted », puis avec un nouvel album du même nom, pour ensuite se lancer dans une tournée mondiale. La même année, la formation célèbre ses vingt ans de carrière à Sydney et effectue son "Lose Your Head Tour". Le 22 novembre 1997, Michael Hutchence se donne malheureusement la mort, dans sa chambre d’hôtel à Sydney. Malgré cette période tragique, INXS continue de se produire dans les salles australiennes et mondiales. Deux ans après le décès de Michael Hutchence, en 1999, un album portant son nom est publié en sa mémoire. L’aventure d’INXS représente un peu plus de vingt années d’existence, durant lesquelles la formation écoule plus de vingt millions d’albums. Love & Hate.
 Il ressort en salles, je ressort ma vieille VHS "Réalisé par Charles Laughton en 1955, La Nuit du chasseur fut le seul film de l’acteur anglais Charles Laughton. Echec commercial, peu commenté par les critiques de l’époque, ce premier film fit peu à peu parler de lui au fil des années pour finalement devenir ce qu’il est aujourd’hui : un chef d’œuvre incontournable et bien plus complexe qu’il n’y paraît. Sous son apparente féerie, ce conte adapté du roman de Davis Grubb est d’une noirceur rarement égalée. Juste avant d’être arrêté par la police et condamné à la potence, Ben Harper confie à son très jeune fils, John, le butin de son braquage. Caché dans le ventre de la poupée de la petite sœur, Pearl, la somme d’argent va susciter la convoitise d’un compagnon de cellule, le révérend Harry Powell. Sitôt libéré, ce dernier va rechercher la petite famille, épouser la veuve Harper et tenter de mettre la main sur cet argent que John et Pearl gardent à l’insu de tout le monde. Après le meurtre de leur mère, les deux jeunes enfants s’enfuient par la rivière. Un peu plus en aval, ils sont recueillis par une femme forte et indépendante qui les protège envers et contre tout. Filmé du point de vue du petit John Harper, La Nuit du chasseur est une œuvre forte sur la fin de cette innocence qui caractérise - souvent à tort selon Freud - les années de l’enfance. John, même pas dix ans, est contraint par les événements d’agir en adulte car ces mêmes adultes qui peuplent l’univers de Laughton sont totalement défaillants, voire démoniaques. Bien sûr, plusieurs lectures du film sont possibles et c’est ce qui fait généralement la force des films de l’Age d’Or d’Hollywood où la censure exerçait une pression à ce point importante, que les réalisateurs devaient user de stratagèmes ingénieux pour évoquer un sujet alors considéré comme tabou. Car dans La Nuit du chasseur, l’argent revêt surtout une symbolique sexuelle complexe qui lie fatalement l’enfant à la figure du père. Le traumatisme et le cauchemar des enfants Harper, c’est avant tout l’ombre du pédophile, du violeur (le révérend Harry Powell) qui menace continuellement de tuer leur innocence d’un coup de phallus tranchant. La morbidité à laquelle sont violemment exposés les enfants - première scène traumatique du film - est parfaitement illustrée dans l’une des premières scènes du film commentées par Lillian Gish où l’on voit un jeune groupe jouer à cache-cache et finalement découvrir le corps inerte d’une jeune femme. Comme l’indique le passage rapide d’un train sur les rails, le personnage du révérend Harry Powell est régulièrement associé à des symboles phalliques., signe de surpuissance masculine. Powell a conclu un pacte avec Dieu : se débarasser de ces catins, veuves de surcroît, qui ne sauraient que faire de l’argent laissé par des maris défunts, à part se parfumer, se maquiller, et forniquer. Dans l’une des premières scènes du film, on voit l’homme assister à la danse lascive d’une jeune femme dans un cabaret. La lumière qui l’entoure forme le trou d’une serrure. Tandis qu’il fustige le dévergondage du sexe féminin, le désir prend forme. La lame de son couteau, posée près de son entrejambe, sort d’un coup en déchirant la poche dans lequel il était contenu. La pulsion sexuelle du révérend est immédiatement associée au meurtre, tout autant obsessionnel. Mais pour approcher les enfants qu’il convoite, Harry Powell tente s’octroyer une identité respectable, en contrepoint du père biologique. Une fois accueilli dans la famille, il harcèle continuellement John pour qu’il confie son secret, pour qu’il se donne à lui, en fait. Pour protéger sa soeur, Pearl, qui possède la poupée et qui n’a pas conscience de la valeur de cet objet tant désiré, John se surexpose et subit régulièrement les assauts de son nouveau beau-père. Dans une autre scène où les deux enfants tentent de trouver refuge dans la cave (lieu du refoulé par excellence), la crasse ambiante laisse des traces sur leur jeune visage. Salis, ils le sont, surtout lorsque Harry Powell déboule pour attraper John. Plaqué sur un tonneau, le jeune garçon est à la merci de l’homme d’église qui se tient juste derrière lui, prêt à le violer sous les yeux de sa soeur en pleurs qui avoue pour le sauver que l’argent est finalement caché dans sa poupée. Finalement, les deux enfants parviennent à s’enfuir par la rivière dans laquelle le corps de leur mère est dissimulé. Laissant dériver la barque au fil du courant, John et Pearl assistent à un spectacle féerique où les animaux se succèdent. Inquiétante d’une certaine manière, la nature semble pourtant reprendre ses droits, écartant les deux enfants du danger qui les menace. L’atmosphère féerique de cette fuite vers un ailleurs inconnu, agit comme une parenthèse durant laquelle ils retrouvent un tant soit peu leur innocence. Mais il ne s’agit que d’une parenthèse. Un peu plus en aval, John et Pearl se réfugient dans une grange pour se reposer. Il s’agit de la première scène où l’on voit les deux enfants s’abandonner au sommeil, dans un lieu autre que la barque sur laquelle il navigue. .Pourtant, ce repos sera troublé par le chant du révérend. Réveillé, John se redresse et voit l’ombre sombre d’Harry Powell se dessiner au loin. Sa remarque (« Il ne dort donc jamais ? ») est à l’image de ce que vit le jeune garçon abusé. Poursuivi jusque dans son sommeil, la nuit est source de dangers : il décide de reprendre la route avec sa jeune soeur. De là, ils vont à nouveau s’échouer sur une rive où, à l’instar de Moïse, les enfants sont recueillis par une femme vieillissante (Lillian Gish), généreuse mais déterminée. Rachel Cooper, la vieille femme (Lillian Gish), est le seul adulte responsable et lucide dans La Nuit du chasseur. A la fois père, mère, grand-mère, bienfaitrice, elle accueille les enfants abandonnés à leur sort pour les aider à survivre durant la période de la Dépression. Dès qu’elle découvre Pearl et John, endormis dans la barque, l’un de ses premiers automatismes est de les laver. Cette scène a bien sûr une portée purificatrice pour ces deux enfants qui ont subi les attaques incessantes d’un révérend lubrique. Sommé de partir, le révérend sort son couteau pour attraper le jeune garçon qui lui échappe encore une fois. Mais cette nouvelle tentative de viol se fait devant témoin et la vieille femme n’hésite pas à s’emparer d’un fusil et l’oblige à déserter les lieux. Reclus dans leur maison, la femme et les enfants montent la garde contre le révérend. Finalement arrêté par la police, Harry Powell est plaqué au sol devant John faisant écho à la scène traumatique du début du film où le terrible secret naissait. Secoué, le jeune garçon se jette sur l’homme à terre, le frappe de la poupée, libérant tous les billets qui étaient la source de sa honte. Il adresse à son beau-père les reproches qu’il aurait souhaité faire à son vrai père. Alors que l’avarice se rapproche de la rétention anale la générosité de John - lorsqu’il offre une pomme à sa mère de substitution - se rapproche de l’expulsion (le secret enfin sorti de lui-même, de son ventre) en tant que cadeau, don à la mère. A la fin du film, la femme interprétée par Lillian Gish répète : "ils (les enfants) supportent et résistent". Cette phrase sonne comme la morale de ce conte immoral. En recevant une montre en cadeau de noël, le petit John voit désormais le temps reprendre son chemin habituel et peut désormais aspirer à une vie normale.
Il ressort en salles, je ressort ma vieille VHS "Réalisé par Charles Laughton en 1955, La Nuit du chasseur fut le seul film de l’acteur anglais Charles Laughton. Echec commercial, peu commenté par les critiques de l’époque, ce premier film fit peu à peu parler de lui au fil des années pour finalement devenir ce qu’il est aujourd’hui : un chef d’œuvre incontournable et bien plus complexe qu’il n’y paraît. Sous son apparente féerie, ce conte adapté du roman de Davis Grubb est d’une noirceur rarement égalée. Juste avant d’être arrêté par la police et condamné à la potence, Ben Harper confie à son très jeune fils, John, le butin de son braquage. Caché dans le ventre de la poupée de la petite sœur, Pearl, la somme d’argent va susciter la convoitise d’un compagnon de cellule, le révérend Harry Powell. Sitôt libéré, ce dernier va rechercher la petite famille, épouser la veuve Harper et tenter de mettre la main sur cet argent que John et Pearl gardent à l’insu de tout le monde. Après le meurtre de leur mère, les deux jeunes enfants s’enfuient par la rivière. Un peu plus en aval, ils sont recueillis par une femme forte et indépendante qui les protège envers et contre tout. Filmé du point de vue du petit John Harper, La Nuit du chasseur est une œuvre forte sur la fin de cette innocence qui caractérise - souvent à tort selon Freud - les années de l’enfance. John, même pas dix ans, est contraint par les événements d’agir en adulte car ces mêmes adultes qui peuplent l’univers de Laughton sont totalement défaillants, voire démoniaques. Bien sûr, plusieurs lectures du film sont possibles et c’est ce qui fait généralement la force des films de l’Age d’Or d’Hollywood où la censure exerçait une pression à ce point importante, que les réalisateurs devaient user de stratagèmes ingénieux pour évoquer un sujet alors considéré comme tabou. Car dans La Nuit du chasseur, l’argent revêt surtout une symbolique sexuelle complexe qui lie fatalement l’enfant à la figure du père. Le traumatisme et le cauchemar des enfants Harper, c’est avant tout l’ombre du pédophile, du violeur (le révérend Harry Powell) qui menace continuellement de tuer leur innocence d’un coup de phallus tranchant. La morbidité à laquelle sont violemment exposés les enfants - première scène traumatique du film - est parfaitement illustrée dans l’une des premières scènes du film commentées par Lillian Gish où l’on voit un jeune groupe jouer à cache-cache et finalement découvrir le corps inerte d’une jeune femme. Comme l’indique le passage rapide d’un train sur les rails, le personnage du révérend Harry Powell est régulièrement associé à des symboles phalliques., signe de surpuissance masculine. Powell a conclu un pacte avec Dieu : se débarasser de ces catins, veuves de surcroît, qui ne sauraient que faire de l’argent laissé par des maris défunts, à part se parfumer, se maquiller, et forniquer. Dans l’une des premières scènes du film, on voit l’homme assister à la danse lascive d’une jeune femme dans un cabaret. La lumière qui l’entoure forme le trou d’une serrure. Tandis qu’il fustige le dévergondage du sexe féminin, le désir prend forme. La lame de son couteau, posée près de son entrejambe, sort d’un coup en déchirant la poche dans lequel il était contenu. La pulsion sexuelle du révérend est immédiatement associée au meurtre, tout autant obsessionnel. Mais pour approcher les enfants qu’il convoite, Harry Powell tente s’octroyer une identité respectable, en contrepoint du père biologique. Une fois accueilli dans la famille, il harcèle continuellement John pour qu’il confie son secret, pour qu’il se donne à lui, en fait. Pour protéger sa soeur, Pearl, qui possède la poupée et qui n’a pas conscience de la valeur de cet objet tant désiré, John se surexpose et subit régulièrement les assauts de son nouveau beau-père. Dans une autre scène où les deux enfants tentent de trouver refuge dans la cave (lieu du refoulé par excellence), la crasse ambiante laisse des traces sur leur jeune visage. Salis, ils le sont, surtout lorsque Harry Powell déboule pour attraper John. Plaqué sur un tonneau, le jeune garçon est à la merci de l’homme d’église qui se tient juste derrière lui, prêt à le violer sous les yeux de sa soeur en pleurs qui avoue pour le sauver que l’argent est finalement caché dans sa poupée. Finalement, les deux enfants parviennent à s’enfuir par la rivière dans laquelle le corps de leur mère est dissimulé. Laissant dériver la barque au fil du courant, John et Pearl assistent à un spectacle féerique où les animaux se succèdent. Inquiétante d’une certaine manière, la nature semble pourtant reprendre ses droits, écartant les deux enfants du danger qui les menace. L’atmosphère féerique de cette fuite vers un ailleurs inconnu, agit comme une parenthèse durant laquelle ils retrouvent un tant soit peu leur innocence. Mais il ne s’agit que d’une parenthèse. Un peu plus en aval, John et Pearl se réfugient dans une grange pour se reposer. Il s’agit de la première scène où l’on voit les deux enfants s’abandonner au sommeil, dans un lieu autre que la barque sur laquelle il navigue. .Pourtant, ce repos sera troublé par le chant du révérend. Réveillé, John se redresse et voit l’ombre sombre d’Harry Powell se dessiner au loin. Sa remarque (« Il ne dort donc jamais ? ») est à l’image de ce que vit le jeune garçon abusé. Poursuivi jusque dans son sommeil, la nuit est source de dangers : il décide de reprendre la route avec sa jeune soeur. De là, ils vont à nouveau s’échouer sur une rive où, à l’instar de Moïse, les enfants sont recueillis par une femme vieillissante (Lillian Gish), généreuse mais déterminée. Rachel Cooper, la vieille femme (Lillian Gish), est le seul adulte responsable et lucide dans La Nuit du chasseur. A la fois père, mère, grand-mère, bienfaitrice, elle accueille les enfants abandonnés à leur sort pour les aider à survivre durant la période de la Dépression. Dès qu’elle découvre Pearl et John, endormis dans la barque, l’un de ses premiers automatismes est de les laver. Cette scène a bien sûr une portée purificatrice pour ces deux enfants qui ont subi les attaques incessantes d’un révérend lubrique. Sommé de partir, le révérend sort son couteau pour attraper le jeune garçon qui lui échappe encore une fois. Mais cette nouvelle tentative de viol se fait devant témoin et la vieille femme n’hésite pas à s’emparer d’un fusil et l’oblige à déserter les lieux. Reclus dans leur maison, la femme et les enfants montent la garde contre le révérend. Finalement arrêté par la police, Harry Powell est plaqué au sol devant John faisant écho à la scène traumatique du début du film où le terrible secret naissait. Secoué, le jeune garçon se jette sur l’homme à terre, le frappe de la poupée, libérant tous les billets qui étaient la source de sa honte. Il adresse à son beau-père les reproches qu’il aurait souhaité faire à son vrai père. Alors que l’avarice se rapproche de la rétention anale la générosité de John - lorsqu’il offre une pomme à sa mère de substitution - se rapproche de l’expulsion (le secret enfin sorti de lui-même, de son ventre) en tant que cadeau, don à la mère. A la fin du film, la femme interprétée par Lillian Gish répète : "ils (les enfants) supportent et résistent". Cette phrase sonne comme la morale de ce conte immoral. En recevant une montre en cadeau de noël, le petit John voit désormais le temps reprendre son chemin habituel et peut désormais aspirer à une vie normale. samedi, février 18, 2006
Le numérik c'est fantastik.
Mes Blorks.
vendredi, février 17, 2006
War over Normandy.
Le matin elle mange des "Kriss Kross" et ne regarde jamais la météo sur la deux, parce que "les cartes elles sont pas belles"...Satanée blondasse...
Memories of murder.
 Vraiment un de mes cinq films préférés de l'année dernière "Milieu des années 80. Dans une petite ville de province près de Séoul, on découvre à quelques semaines d'intervalle les corps de deux femmes atrocement mutilées. La police locale est rapidement dépassée par les événements. Le cinéma coréen n’a pas fini de nous étonner. Avant la sortie d’Old Boy de Park Chan-Wok, Grand Prix du Jury à Cannes et une semaine après celle de Deux Sœurs, vertigineux film d’horreur, s’expose enfin sur nos écrans le magnifique Memories of Murder, chef-d’œuvre multi-primé au Festival du Film Policier de Cognac et peut-être le meilleur polar orchestré depuis Se7en de David Fincher. Il y a décidément quelque chose de magique au pays du matin calme. Aidée par des subventions mises en place par le ministre-réalisateur de la Culture, Lee Chang-Dong (Oasis), une jeune génération de cinéastes revisite avec bonheur tous les genres du septième art pour en écrire les pages les plus contemporaines. Sur le papier, rien ne semble différencier Memories of Murder du thriller lambda. Des femmes sont mystérieusement assassinées à la campagne et des flics aux méthodes diamétralement opposées enquêtent sur le terrain au gré des indices relevés. Dès l'ouverture joyeusement bordélique autour d’une scène de crime impossible à faire respecter, on devine toutefois que l’on n’assistera pas à une énième traque de serial-killer, personnages monolithiques et discours binaire à la clé. Inspiré de faits réels qui ont secoué la Corée du Sud dans les années 80, Memories of Murder est avant tout un film d’époque, une comédie noire de pays sous-développé comme le définit lui-même le metteur en scène. Alors que la Corée est secouée par une frénésie paranoïaque - succession de couvre-feu et répression sanglante des grèves étudiantes -, trois hommes partent à la recherche du mystérieux criminel: le détective Park Doo-Man, agent bourru et sûr de lui qui pense pouvoir identifier un voyou en le dévisageant, son acolyte le sergent Koo Hee-Bong, spécialiste de l'aveu spontané à grands coups de taloches dans le visage des prévenus, et enfin le beau et ténébreux détective Seo Tae-Yoon. Venu de Séoul, ce dernier ne croit qu’en une approche scientifique de l’affaire et ne jure que par les méthodes américaines. Inexpérimentés face à une telle série de meurtres et peu enclins à s’entraider, ils se lancent à corps perdus dans la moindre piste et cèdent même aux charmes de la voyance… Bong Joon-Ho, dont c’est le second long métrage après une comédie inédite en France, adopte un point de vue réaliste. Il met en scène le quotidien d’enquêteurs sans moyen, dépassés par les événements et plus soucieux de leur plan de carrière que de la résolution de l'énigme, du moins dans un premier temps. Fabrication de fausses preuves, passages à tabac, arrestation arbitraire de l’idiot du village à qui les deux premiers soufflent les questions et les réponses pour briller devant l’opinion publique, Memories of Murder pourrait être un conte sordide si sa noirceur n’était contre-balancée par une ironie constante, un second degré salutaire qui prend en compte l’intelligence du spectateur, sa connaissance des codes du genre. Sans abandonner l’intrigue en elle-même, Bong Joon-Ho dresse le portrait de personnages profondément humains, faillibles et attachants. D’abord décrit comme un loser patenté, Park Doo-Man (génial Song Kan-Ho, héros de Joint Security Area et Sympathy for Mr Vengeance de Park Chan-Wok) parvient malgré ses nombreuses erreurs, à nous attendrir. Cet ours à l’ego surdimensionné qui parade comme un coq lors de la capture d’un nouveau suspect cache une véritable sensibilité, une affection réelle pour son compagnon de route, Koo Hee-Bong, et finit pour l’amour d’une infirmière par abandonner son poste de policier. Plus professionnel dans son approche du métier, Seo Tae-yoon (Kim Sang-Kyung déjà vu dans Turning Gate de Hong Sang-Soo) se laisse lui aussi peu à peu gagner par le doute. La mise en scène est virtuose. Bong Joon-Ho limite les effets visuels pour en renforcer la puissance. Le moindre ralenti a un sens, comique ou dramatique, et parvient à susciter l’effroi dans des scènes nocturnes noyées sous la pluie. Tapi dans l’ombre, jamais à visage découvert, l’assassin rôde dans les hautes herbes, guette sa future proie au sommet d’une colline, tel un prédateur insaisissable dont le sang froid s’oppose à la confusion des policiers. Tout devient alors suspect: un visage impassible, le bredouillement d’un débile léger devant une photo, une absence d’alibi, une dédicace radio… La quête de la vérité ne garantit aucun aboutissement et le très bel épilogue laisse la porte ouverte à toutes les interprétations."
Vraiment un de mes cinq films préférés de l'année dernière "Milieu des années 80. Dans une petite ville de province près de Séoul, on découvre à quelques semaines d'intervalle les corps de deux femmes atrocement mutilées. La police locale est rapidement dépassée par les événements. Le cinéma coréen n’a pas fini de nous étonner. Avant la sortie d’Old Boy de Park Chan-Wok, Grand Prix du Jury à Cannes et une semaine après celle de Deux Sœurs, vertigineux film d’horreur, s’expose enfin sur nos écrans le magnifique Memories of Murder, chef-d’œuvre multi-primé au Festival du Film Policier de Cognac et peut-être le meilleur polar orchestré depuis Se7en de David Fincher. Il y a décidément quelque chose de magique au pays du matin calme. Aidée par des subventions mises en place par le ministre-réalisateur de la Culture, Lee Chang-Dong (Oasis), une jeune génération de cinéastes revisite avec bonheur tous les genres du septième art pour en écrire les pages les plus contemporaines. Sur le papier, rien ne semble différencier Memories of Murder du thriller lambda. Des femmes sont mystérieusement assassinées à la campagne et des flics aux méthodes diamétralement opposées enquêtent sur le terrain au gré des indices relevés. Dès l'ouverture joyeusement bordélique autour d’une scène de crime impossible à faire respecter, on devine toutefois que l’on n’assistera pas à une énième traque de serial-killer, personnages monolithiques et discours binaire à la clé. Inspiré de faits réels qui ont secoué la Corée du Sud dans les années 80, Memories of Murder est avant tout un film d’époque, une comédie noire de pays sous-développé comme le définit lui-même le metteur en scène. Alors que la Corée est secouée par une frénésie paranoïaque - succession de couvre-feu et répression sanglante des grèves étudiantes -, trois hommes partent à la recherche du mystérieux criminel: le détective Park Doo-Man, agent bourru et sûr de lui qui pense pouvoir identifier un voyou en le dévisageant, son acolyte le sergent Koo Hee-Bong, spécialiste de l'aveu spontané à grands coups de taloches dans le visage des prévenus, et enfin le beau et ténébreux détective Seo Tae-Yoon. Venu de Séoul, ce dernier ne croit qu’en une approche scientifique de l’affaire et ne jure que par les méthodes américaines. Inexpérimentés face à une telle série de meurtres et peu enclins à s’entraider, ils se lancent à corps perdus dans la moindre piste et cèdent même aux charmes de la voyance… Bong Joon-Ho, dont c’est le second long métrage après une comédie inédite en France, adopte un point de vue réaliste. Il met en scène le quotidien d’enquêteurs sans moyen, dépassés par les événements et plus soucieux de leur plan de carrière que de la résolution de l'énigme, du moins dans un premier temps. Fabrication de fausses preuves, passages à tabac, arrestation arbitraire de l’idiot du village à qui les deux premiers soufflent les questions et les réponses pour briller devant l’opinion publique, Memories of Murder pourrait être un conte sordide si sa noirceur n’était contre-balancée par une ironie constante, un second degré salutaire qui prend en compte l’intelligence du spectateur, sa connaissance des codes du genre. Sans abandonner l’intrigue en elle-même, Bong Joon-Ho dresse le portrait de personnages profondément humains, faillibles et attachants. D’abord décrit comme un loser patenté, Park Doo-Man (génial Song Kan-Ho, héros de Joint Security Area et Sympathy for Mr Vengeance de Park Chan-Wok) parvient malgré ses nombreuses erreurs, à nous attendrir. Cet ours à l’ego surdimensionné qui parade comme un coq lors de la capture d’un nouveau suspect cache une véritable sensibilité, une affection réelle pour son compagnon de route, Koo Hee-Bong, et finit pour l’amour d’une infirmière par abandonner son poste de policier. Plus professionnel dans son approche du métier, Seo Tae-yoon (Kim Sang-Kyung déjà vu dans Turning Gate de Hong Sang-Soo) se laisse lui aussi peu à peu gagner par le doute. La mise en scène est virtuose. Bong Joon-Ho limite les effets visuels pour en renforcer la puissance. Le moindre ralenti a un sens, comique ou dramatique, et parvient à susciter l’effroi dans des scènes nocturnes noyées sous la pluie. Tapi dans l’ombre, jamais à visage découvert, l’assassin rôde dans les hautes herbes, guette sa future proie au sommet d’une colline, tel un prédateur insaisissable dont le sang froid s’oppose à la confusion des policiers. Tout devient alors suspect: un visage impassible, le bredouillement d’un débile léger devant une photo, une absence d’alibi, une dédicace radio… La quête de la vérité ne garantit aucun aboutissement et le très bel épilogue laisse la porte ouverte à toutes les interprétations." Infernal affairs trilogy.
 Je viens de terminer la trilogie : le premier est une bombe, la préquel est formidable et le dernier est craignos. "Premier épisode d'une trilogie, rarement un film policier de cette envergure n'aura été aussi prenant et réussi. Tony Leung Chiu-Wai (In The Mood for Love, Hero) et Andy Lau (Fulltime Killer) se partagent l'affiche, aux côtés d'une distribution impeccable. Ming (Andy Lau) et Yan (Tony Leung Chiu-wai) sont tous deux issus de l’académie de police de Hong Kong. Le premier connaît un début de carrière exemplaire, multipliant les prix et les éloges de ses supérieurs. Le second, tout aussi brillant, a été choisi par le superintendent Wong (Anthony Wong) pour infiltrer la bande d’un dangereux parrain de la drogue, Sam (Eric Tsang). Le problème vient de ce que Ming est lui aussi un indic, mais pour le compte de Sam. Chaque camp ignorant qui est la taupe de l'autre, la chasse peut commencer… Présenté hors compétition en clôture du Festival du film asiatique de Deauville en 2003 puis à Udine lors de la 5ème édition du Far East Film où il récolta le prix du film le plus populaire, Infernal Affairs de Andrew Law (The Stormriders) et Alan Mak ( A War Named Desire) aurait mérité à ce moment son lot de récompenses, à commencer par un Prix d’interprétation pour les deux stars du film, Tony Leung et Andy Lau, qui sont tout simplement impossibles à départager ! Certes, le jury des Hong Kong Films Awards l’a fait quelques semaines plus tard (Tony Leung a été désigné vainqueur,) mais les délibérations ont dû être longues et houleuses. Rarement, en effet, deux acteurs n’auront aussi bien réussi à partager la première place à l’écran. Le match nul est d’autant plus fantastique que, en dehors du duel classique qui existe toujours lorsqu’un film réunit deux grosses stars et où chacun cherche à tirer la couverture de son côté, le thème même du film est proprement le duel. L'opposition ici est entre un policier qui se sent contraint de trahir son clan (la police) pour venir en aide à un mafioso sans scrupule et, de l’autre côté, un autre policier contraint d’obéir à son supérieur hiérarchique en faisant ami-ami avec le même mafioso sans scrupule. Duel, duquel par définition un seul peut sortir vainqueur. Infernal Affairs joue la carte de la confrontation à tous les niveaux. Nous, spectateurs, savons qui est la taupe dans chaque clan. C'est à partir de cette simple idée que le film arrive à nous tenir en haleine, nous poussant dans le stress constant que l'un des deux se fasse prendre. L'aspect dramatique de l'histoire, chacune des taupes est coincée depuis dix ans dans l'autre camp et n'aspire qu'à une vie normale, renforce l'intensité de l'intrigue. Tony Leung Chi-wai trouve donc ici un rôle similaire à celui qu'il tenait tout juste dix ans plus tôt, dans le classique de John Woo A toute épreuve : une scène d'ailleurs, la discussion entre Yan et le superintendant, est clairement un hommage (réussi) au film du réalisateur de The Killer. Plus encore, la crapule que Tony Leung infiltrait dix ans plus tôt était interprétée par Anthony Wong... qui joue ici le superintendant ! Si le jeu de Tony Leung impressionne toujours autant, par sa sobriété toute en nuance, la surprise vient d’Andy Lau. Producteur du film, il était légitime de s’attendre de la star de Fulltime Killer à une nouvelle démonstration d’excentricité. Une tactique comme une autre pour se démarquer et faire contraste avec la personnalité de Tony Leung. Mais Andy semble avoir retenu la leçon du film de Johnny To qui avait tourné à l’avantage de son partenaire Japonais. En choisissant de jouer le jeu de Tony, c'est à dire sobre et nuancé, il décroche le gros lot, nous surprend chaque seconde, et nous livre ici ce qui constitue tout simplement son meilleur rôle. Andrew Lau qui n'avait pas tourné un bon film depuis des lustres revient à son genre de prédilection, le polar, dont il livra un des sommets dix ans plus tôt avec Jacky Cheung (To Live & Die In Tsim Tsa Tsui). Très malin dans sa construction, Infernal Affairs est un polar magistral aux fausses allures de série B, qui réussit à installer le spectateur au cœur d’un suspense psychologique d’une rare efficacité. Le sens visuel du cinéaste et de son partenaire Alan Mak (qui signe également le scénario du film et de sa préquelle prévue pour Juillet 2003), associé au talent de monteur de Danny Pang (réalisateur du clipesque Nothing To Lose / 1+1=0), aboutit à un équilibre parfait entre des plans à la beauté époustouflante (la scène finale sur les toit entre autres) et ceux plus intimistes, destinés à capter les réactions les plus furtives des personnages. La bande originale signée Comfort Chan très réussie (en particulier la chorale qui résonne aux différents moments clés du film), colle au plus près des images tout en transcendant leur potentiel émotionnel. Prix de la meilleure mise en scène, du meilleure montage, de la meilleure chanson (Andy Lau & Tony Leung dont les carrière respectives de chanteurs sont toujours aussi populaires auprès du public local… De nombreuses catégories où le nom d’Infernal Affairs mérite à juste titre de figurer en première place. Même les acteurs secondaires sont à l’honneur. Anthony Wong (un prix pour lui également pour son personnage de chef de police aux accents paternalistes vis-à-vis de celui de Tony Leung) en particulier qui se montre très impressionnant en dépit d’un rôle plus court que les autres. Eric Tsang livre une interprétation plus extravertie de mafioso, dans la continuité de Cop On A Mission, un polar au point de départ assez similaire (Daniel Wu y incarne un flic undercover qui doit faire tomber un parrain de la mafia incarné par Tsang) où il cabotinait beaucoup plus. Coindence ou vif intérêt pour le ''nouveau'' polar de Hong Kong, les droits de remake américains ont été acheté pour les deux films (également pour The Mission, un incontournable de cette nouvelle vague). Dans Infernal Affairs, Eric Tsang dégage une inquiétante présence qui contraste fortement avec sa petite taille et sa bonhomie habituellement mises en valeur dans ses films. Seules les femmes – Sammi Cheng et Kelly Chan - sont laissées pour compte dans des rôles qui se réduisent à des apparitions cameo, destinées à rameuter les fans des deux actrices/chanteuses. On sent dans ces scènes un peu lourdes (surtout le parrallèle entre l'histoire qu'écrit Sammi Cheng et celle que vit Andy Lau concernant sa personnailté instable) que le film lorgne sur le Heat de Michael Mann. Elles constituent la seule petite déception de ce très grand film, qui revitalisa l'industrie du ciné HK dont l'année 2002 fût l'une des plus désastreuses en terme de box-office et de qualité, et qui on l'espère redonnera ses lettres de noblesse au film policier chinois dans nos contrées.
Je viens de terminer la trilogie : le premier est une bombe, la préquel est formidable et le dernier est craignos. "Premier épisode d'une trilogie, rarement un film policier de cette envergure n'aura été aussi prenant et réussi. Tony Leung Chiu-Wai (In The Mood for Love, Hero) et Andy Lau (Fulltime Killer) se partagent l'affiche, aux côtés d'une distribution impeccable. Ming (Andy Lau) et Yan (Tony Leung Chiu-wai) sont tous deux issus de l’académie de police de Hong Kong. Le premier connaît un début de carrière exemplaire, multipliant les prix et les éloges de ses supérieurs. Le second, tout aussi brillant, a été choisi par le superintendent Wong (Anthony Wong) pour infiltrer la bande d’un dangereux parrain de la drogue, Sam (Eric Tsang). Le problème vient de ce que Ming est lui aussi un indic, mais pour le compte de Sam. Chaque camp ignorant qui est la taupe de l'autre, la chasse peut commencer… Présenté hors compétition en clôture du Festival du film asiatique de Deauville en 2003 puis à Udine lors de la 5ème édition du Far East Film où il récolta le prix du film le plus populaire, Infernal Affairs de Andrew Law (The Stormriders) et Alan Mak ( A War Named Desire) aurait mérité à ce moment son lot de récompenses, à commencer par un Prix d’interprétation pour les deux stars du film, Tony Leung et Andy Lau, qui sont tout simplement impossibles à départager ! Certes, le jury des Hong Kong Films Awards l’a fait quelques semaines plus tard (Tony Leung a été désigné vainqueur,) mais les délibérations ont dû être longues et houleuses. Rarement, en effet, deux acteurs n’auront aussi bien réussi à partager la première place à l’écran. Le match nul est d’autant plus fantastique que, en dehors du duel classique qui existe toujours lorsqu’un film réunit deux grosses stars et où chacun cherche à tirer la couverture de son côté, le thème même du film est proprement le duel. L'opposition ici est entre un policier qui se sent contraint de trahir son clan (la police) pour venir en aide à un mafioso sans scrupule et, de l’autre côté, un autre policier contraint d’obéir à son supérieur hiérarchique en faisant ami-ami avec le même mafioso sans scrupule. Duel, duquel par définition un seul peut sortir vainqueur. Infernal Affairs joue la carte de la confrontation à tous les niveaux. Nous, spectateurs, savons qui est la taupe dans chaque clan. C'est à partir de cette simple idée que le film arrive à nous tenir en haleine, nous poussant dans le stress constant que l'un des deux se fasse prendre. L'aspect dramatique de l'histoire, chacune des taupes est coincée depuis dix ans dans l'autre camp et n'aspire qu'à une vie normale, renforce l'intensité de l'intrigue. Tony Leung Chi-wai trouve donc ici un rôle similaire à celui qu'il tenait tout juste dix ans plus tôt, dans le classique de John Woo A toute épreuve : une scène d'ailleurs, la discussion entre Yan et le superintendant, est clairement un hommage (réussi) au film du réalisateur de The Killer. Plus encore, la crapule que Tony Leung infiltrait dix ans plus tôt était interprétée par Anthony Wong... qui joue ici le superintendant ! Si le jeu de Tony Leung impressionne toujours autant, par sa sobriété toute en nuance, la surprise vient d’Andy Lau. Producteur du film, il était légitime de s’attendre de la star de Fulltime Killer à une nouvelle démonstration d’excentricité. Une tactique comme une autre pour se démarquer et faire contraste avec la personnalité de Tony Leung. Mais Andy semble avoir retenu la leçon du film de Johnny To qui avait tourné à l’avantage de son partenaire Japonais. En choisissant de jouer le jeu de Tony, c'est à dire sobre et nuancé, il décroche le gros lot, nous surprend chaque seconde, et nous livre ici ce qui constitue tout simplement son meilleur rôle. Andrew Lau qui n'avait pas tourné un bon film depuis des lustres revient à son genre de prédilection, le polar, dont il livra un des sommets dix ans plus tôt avec Jacky Cheung (To Live & Die In Tsim Tsa Tsui). Très malin dans sa construction, Infernal Affairs est un polar magistral aux fausses allures de série B, qui réussit à installer le spectateur au cœur d’un suspense psychologique d’une rare efficacité. Le sens visuel du cinéaste et de son partenaire Alan Mak (qui signe également le scénario du film et de sa préquelle prévue pour Juillet 2003), associé au talent de monteur de Danny Pang (réalisateur du clipesque Nothing To Lose / 1+1=0), aboutit à un équilibre parfait entre des plans à la beauté époustouflante (la scène finale sur les toit entre autres) et ceux plus intimistes, destinés à capter les réactions les plus furtives des personnages. La bande originale signée Comfort Chan très réussie (en particulier la chorale qui résonne aux différents moments clés du film), colle au plus près des images tout en transcendant leur potentiel émotionnel. Prix de la meilleure mise en scène, du meilleure montage, de la meilleure chanson (Andy Lau & Tony Leung dont les carrière respectives de chanteurs sont toujours aussi populaires auprès du public local… De nombreuses catégories où le nom d’Infernal Affairs mérite à juste titre de figurer en première place. Même les acteurs secondaires sont à l’honneur. Anthony Wong (un prix pour lui également pour son personnage de chef de police aux accents paternalistes vis-à-vis de celui de Tony Leung) en particulier qui se montre très impressionnant en dépit d’un rôle plus court que les autres. Eric Tsang livre une interprétation plus extravertie de mafioso, dans la continuité de Cop On A Mission, un polar au point de départ assez similaire (Daniel Wu y incarne un flic undercover qui doit faire tomber un parrain de la mafia incarné par Tsang) où il cabotinait beaucoup plus. Coindence ou vif intérêt pour le ''nouveau'' polar de Hong Kong, les droits de remake américains ont été acheté pour les deux films (également pour The Mission, un incontournable de cette nouvelle vague). Dans Infernal Affairs, Eric Tsang dégage une inquiétante présence qui contraste fortement avec sa petite taille et sa bonhomie habituellement mises en valeur dans ses films. Seules les femmes – Sammi Cheng et Kelly Chan - sont laissées pour compte dans des rôles qui se réduisent à des apparitions cameo, destinées à rameuter les fans des deux actrices/chanteuses. On sent dans ces scènes un peu lourdes (surtout le parrallèle entre l'histoire qu'écrit Sammi Cheng et celle que vit Andy Lau concernant sa personnailté instable) que le film lorgne sur le Heat de Michael Mann. Elles constituent la seule petite déception de ce très grand film, qui revitalisa l'industrie du ciné HK dont l'année 2002 fût l'une des plus désastreuses en terme de box-office et de qualité, et qui on l'espère redonnera ses lettres de noblesse au film policier chinois dans nos contrées. jeudi, février 16, 2006
A rat in a Cage.
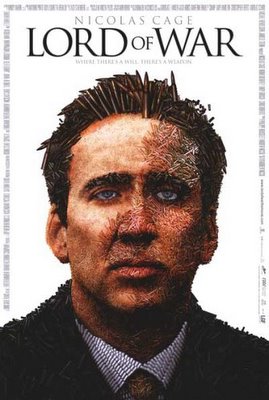 Fan de comics et de rock ? J’aime bien ce mec… "Nicholas Kim Coppola, rebaptisé Nicolas Cage en hommage au super héros black Luke Cage, est devenu un phénomène incontournable du cinéma américain contemporain. Né au cœur du teen-movie des années 1980, couvé par son oncle Francis puis coqueluche du cinéma indépendant pour finir star planétaire, la vie de cet acteur est à elle seule un récit qui mérite d’être conté. Né le 7 janvier 1964 dans l'une des plus grandes familles du cinéma, récompensée sur trois générations par les Oscars, Nicholas Coppola se destine très vite à la comédie. D’un père professeur de littérature et d’une mère chorégraphe, c’est surtout de son oncle Francis et de sa tante Talia Shire qu’il reçoit l’influence. Il entre au conservatoire de comédie de San Francisco, qu’il abandonne rapidement par désir de rejoindre au plus vite les plateaux de cinéma. Son premier rôle, dans Fast times at Rigemont High, est presque entièrement coupé au montage, l’obligeant un temps à vendre du pop-corn dans un cinéma de Los Angeles. Il se lie tout de même d’amitié avec Sean Penn, avec qui il tournera également Les Moissons du printemps deux ans plus tard. En 1983, Nicolas devient également Cage, et tourne, en premier rôle, Valley Girl, pour ensuite rejoindre les rangs Coppola dans Rusty James (1984) puis Cotton Club (1985), où il incarne magnifiquement le frère brutal de Richard Gere, et où il est remarqué pour la première fois. A l’époque, son oncle lui suggère la lecture de Stanislavski, qui ne quittera jamais l’acteur, personnage hystérique se canalisant au cinéma, ou laissant aller sa folie où bon lui semble, ce qui lui fera dire: "Hollywood ne savait pas si j’étais un acteur ou un fou ou si j’étais ce personnage malade que j’incarnais. J’avais développé une image inhabituelle, différente et sauvage". Cette réputation vaut à Nicolas Cage une place à part et les rôles qu’il interprète alors jouent énormément de ce rapport étrange qu’il entretient avec lui-même. Dans Birdy ou Arizona Junior, lui vaut une renommée grandissante et sa première nomination aux Golden Globes. Mais Nicolas Cage ne s’arrête pas là: coqueluche du cinéma indépendant, il tourne en 1990 Sailor et Lula, sous la direction de David Lynch (Palme d’or à Cannes), où son regard perçant, sa voix cassée et sa veste en peau de lézard marquent les esprits et signent pour Cage le sommet d’une certaine gloire au sein du monde d’Hollywood. Le début des années 1990 est difficile pour Cage, ses rôles commerciaux dans Un ange gardien pour Tess ou Milliardaire malgré lui en policier généreux l’éloignent de sa gloire passée et il souffre de cette image. C’est en retrouvant un rôle à sa mesure dans Kiss of Death, que Nicolas Cage redevient un homme important. Dans le rôle de Little Junior Brown, l’acteur affiche un physique nouveau, puissant et fragile à la fois, qui lui permet d’envisager un autre cinéma. Il tourne alors les deux films qui constitueront le bouleversement de sa carrière. Leaving Las Vegas de Mike Figgis, lui vaut l’Oscar du meilleur acteur en 1995, et Rock, son premier grand succès public. Nicolas Cage devient soudainement une valeur sûre et enchaîne les productions populaires: Les Ailes de l’enfer (Simon West, 1997) et Volte/face (John Woo, 1997) achèvent de faire de lui une star du cinéma d’action, tandis que La Cité des anges (Brad Silberling, 1998) et Snake Eyes (Brian De Palma, 1998) lui permettent d’explorer des facettes inédites de son jeu, ou de travailler avec l'une de ses idoles, Brian De Palma. Cette alternance de projets différents, commerciaux ou ambitieux, aujourd’hui très répandue parmi les stars hollywoodiennes, ne faisaient alors pas l’unanimité, et les critiques pleuvent sur Nicolas Cage lors du festival de Berlin 1999, notamment de la part de l’un de ses meilleurs amis, Sean Penn, qui le qualifiera de non-acteur. Mais les rancoeurs n’animent pas le comédien, qui enchaîne alors A tombeau ouvert, et 60 secondes chrono, deux rôles totalement antinomiques. Mais les succès s’estompent et des projets comme Capitaine Corelli ou Windtalkers ne trouvent pas leur public. Nicolas Cage décide alors d’explorer les autres opportunités que son succès lui offre. La production tout d’abord, avec Saturn Production qu’il fonde et avec laquelle il présente notamment L’Ombre du vampire ou encore les films d'Alan Parker (La Vie de David Gale, 2003) et Andrew Nicol (Lord of War, 2005). Il réalise également, en 2002, son premier film, Sonny, œuvre simple et attachante, réalisée en peu de temps et dans laquelle explose James Franco en gigolo meurtri, image rebelle de Nicolas Cage jeune, perturbé par son propre travail de comédien, entre schizophrénie et sacrifice. En 2002, Nicolas Cage obtient sa seconde nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour Adaptation (Spike Jonze), où il incarne Charlie Kaufman, scénariste du film, et son frère jumeau Donald. La performance de l’acteur est suivie par la rencontre avec Ridley Scott pour la comédie Les Associés (2003). Nicolas Cage permet ensuite à Benjamin Gates, projet qu’il portait avec lui depuis des années, de devenir le grand succès surprise de la fin d’année 2004, lui donnant la possibilité de tenter de nouvelles choses, dans des projets plus ambitieux. En 2005, Nicolas Cage présentait deux films anti-commerciaux au possible, le faux indépendant The Weather Man et le ténébreux Lord of War. Les deux films, par leur caractère subversif, ne rencontrent aucun succès en salle, faute de trouver un moyen de vendre des œuvres exigeantes à un public difficile: "Ils ne marchent pas parce qu’ils ne correspondent pas à ce à quoi les gens s’attendent. Les chiffres des entrées finissent ensuite dans un ordinateur et les gens des studios se disent 'Nicolas Cage ne rapporte pas un rond, ne l’engageons plus'. C’est pour cette raison que de moins en moins d’acteurs prennent le risque de faire ce genre de films". En 2006, Nicolas Cage présentera deux films encore inédits, le premier étant un remake du film de Robin Hardy, The Wicker Man (1973), sous la direction de Neil La Bute, puis il apparaîtra dans le rôle principal de l’un des films les plus attendus de l'année, World Trade Center, d’Oliver Stone. FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE: 2007 Ghost Rider 2006 Ant Bully (voix) 2006 World Trade Center 2006 The Wicker Man 2005 Lord of War 2003 Les Associés 2002 Adaptation 2002 Sonny (+ réal) 2002 Windtalkers 2000 60 secondes chrono 1999 A Tombeau ouvert 1999 8MM 1998 Snake Eyes 1998 La Cité des anges 1997 Volte/face 1997 Les Ailes de l'enfer 1996 The Rock 1995 Leaving Las Vegas 1995 Kiss of Death 1994 Un ange gardien pour Tess 1992 Lune de miel à Las Vegas 1991 Sailor et Lula 1986 Peggy Sue s'est mariée 1984 Birdy 1984 Cotton Club 1982 Fast Times at Ridgemont High Nicolas Cage a lancé la carrière de Johnny Depp, le présentant à son agent après une partie de Monopoly chez un ami commun. Un an après cette rencontre, on découvrait Johnny dans Les Griffes de la nuit de Wes Craven (1983). Le meilleur ami de Nicolas Cage n’est autre que Jim Carrey, depuis le tournage de Peggy Sue s'est mariée (Coppola, 1986). On lui connaît aussi des amitiés avec Rob Zombie, Tom Waits ou encore Johnny Ramones, auquel il rendait hommage en janvier 2005. Il lui a fallu passer un nombre d’épreuves incroyable pour convaincre Patricia Arquette de son amour. Sean Connery a accepté le rôle de John Mason pour pouvoir travailler avec Nicolas Cage. Son amour du comic book l’a poussé à tourner Ghost Rider de Mark Steven Johnson (sortie en 2007). Nicolas Cage était auparavant lié aux projets de faire renaître Superman (avec Tim Burton) et Spider-Man (dans le rôle du bouffon vert). Il possède par ailleurs toujours les droits de Hard Boiled, bande dessinée de Frank Miller que David Fincher devait réaliser. Enfin son dernier enfant, né en 2004, se nomme Kal-el, soit le vrai prénom de Superman. Parmi ses nombreux futurs films, on note l’adaptation d’une nouvelle de Philip K. Dick (Next, de Lee Tamahori, avec Julianne Moore), un film sur le poker (Amarillo Slim, de Milos Forman), la suite de National Treasure (prévue pour 2007) ou encore une comédie avec Will Smith (Time Share).
Fan de comics et de rock ? J’aime bien ce mec… "Nicholas Kim Coppola, rebaptisé Nicolas Cage en hommage au super héros black Luke Cage, est devenu un phénomène incontournable du cinéma américain contemporain. Né au cœur du teen-movie des années 1980, couvé par son oncle Francis puis coqueluche du cinéma indépendant pour finir star planétaire, la vie de cet acteur est à elle seule un récit qui mérite d’être conté. Né le 7 janvier 1964 dans l'une des plus grandes familles du cinéma, récompensée sur trois générations par les Oscars, Nicholas Coppola se destine très vite à la comédie. D’un père professeur de littérature et d’une mère chorégraphe, c’est surtout de son oncle Francis et de sa tante Talia Shire qu’il reçoit l’influence. Il entre au conservatoire de comédie de San Francisco, qu’il abandonne rapidement par désir de rejoindre au plus vite les plateaux de cinéma. Son premier rôle, dans Fast times at Rigemont High, est presque entièrement coupé au montage, l’obligeant un temps à vendre du pop-corn dans un cinéma de Los Angeles. Il se lie tout de même d’amitié avec Sean Penn, avec qui il tournera également Les Moissons du printemps deux ans plus tard. En 1983, Nicolas devient également Cage, et tourne, en premier rôle, Valley Girl, pour ensuite rejoindre les rangs Coppola dans Rusty James (1984) puis Cotton Club (1985), où il incarne magnifiquement le frère brutal de Richard Gere, et où il est remarqué pour la première fois. A l’époque, son oncle lui suggère la lecture de Stanislavski, qui ne quittera jamais l’acteur, personnage hystérique se canalisant au cinéma, ou laissant aller sa folie où bon lui semble, ce qui lui fera dire: "Hollywood ne savait pas si j’étais un acteur ou un fou ou si j’étais ce personnage malade que j’incarnais. J’avais développé une image inhabituelle, différente et sauvage". Cette réputation vaut à Nicolas Cage une place à part et les rôles qu’il interprète alors jouent énormément de ce rapport étrange qu’il entretient avec lui-même. Dans Birdy ou Arizona Junior, lui vaut une renommée grandissante et sa première nomination aux Golden Globes. Mais Nicolas Cage ne s’arrête pas là: coqueluche du cinéma indépendant, il tourne en 1990 Sailor et Lula, sous la direction de David Lynch (Palme d’or à Cannes), où son regard perçant, sa voix cassée et sa veste en peau de lézard marquent les esprits et signent pour Cage le sommet d’une certaine gloire au sein du monde d’Hollywood. Le début des années 1990 est difficile pour Cage, ses rôles commerciaux dans Un ange gardien pour Tess ou Milliardaire malgré lui en policier généreux l’éloignent de sa gloire passée et il souffre de cette image. C’est en retrouvant un rôle à sa mesure dans Kiss of Death, que Nicolas Cage redevient un homme important. Dans le rôle de Little Junior Brown, l’acteur affiche un physique nouveau, puissant et fragile à la fois, qui lui permet d’envisager un autre cinéma. Il tourne alors les deux films qui constitueront le bouleversement de sa carrière. Leaving Las Vegas de Mike Figgis, lui vaut l’Oscar du meilleur acteur en 1995, et Rock, son premier grand succès public. Nicolas Cage devient soudainement une valeur sûre et enchaîne les productions populaires: Les Ailes de l’enfer (Simon West, 1997) et Volte/face (John Woo, 1997) achèvent de faire de lui une star du cinéma d’action, tandis que La Cité des anges (Brad Silberling, 1998) et Snake Eyes (Brian De Palma, 1998) lui permettent d’explorer des facettes inédites de son jeu, ou de travailler avec l'une de ses idoles, Brian De Palma. Cette alternance de projets différents, commerciaux ou ambitieux, aujourd’hui très répandue parmi les stars hollywoodiennes, ne faisaient alors pas l’unanimité, et les critiques pleuvent sur Nicolas Cage lors du festival de Berlin 1999, notamment de la part de l’un de ses meilleurs amis, Sean Penn, qui le qualifiera de non-acteur. Mais les rancoeurs n’animent pas le comédien, qui enchaîne alors A tombeau ouvert, et 60 secondes chrono, deux rôles totalement antinomiques. Mais les succès s’estompent et des projets comme Capitaine Corelli ou Windtalkers ne trouvent pas leur public. Nicolas Cage décide alors d’explorer les autres opportunités que son succès lui offre. La production tout d’abord, avec Saturn Production qu’il fonde et avec laquelle il présente notamment L’Ombre du vampire ou encore les films d'Alan Parker (La Vie de David Gale, 2003) et Andrew Nicol (Lord of War, 2005). Il réalise également, en 2002, son premier film, Sonny, œuvre simple et attachante, réalisée en peu de temps et dans laquelle explose James Franco en gigolo meurtri, image rebelle de Nicolas Cage jeune, perturbé par son propre travail de comédien, entre schizophrénie et sacrifice. En 2002, Nicolas Cage obtient sa seconde nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour Adaptation (Spike Jonze), où il incarne Charlie Kaufman, scénariste du film, et son frère jumeau Donald. La performance de l’acteur est suivie par la rencontre avec Ridley Scott pour la comédie Les Associés (2003). Nicolas Cage permet ensuite à Benjamin Gates, projet qu’il portait avec lui depuis des années, de devenir le grand succès surprise de la fin d’année 2004, lui donnant la possibilité de tenter de nouvelles choses, dans des projets plus ambitieux. En 2005, Nicolas Cage présentait deux films anti-commerciaux au possible, le faux indépendant The Weather Man et le ténébreux Lord of War. Les deux films, par leur caractère subversif, ne rencontrent aucun succès en salle, faute de trouver un moyen de vendre des œuvres exigeantes à un public difficile: "Ils ne marchent pas parce qu’ils ne correspondent pas à ce à quoi les gens s’attendent. Les chiffres des entrées finissent ensuite dans un ordinateur et les gens des studios se disent 'Nicolas Cage ne rapporte pas un rond, ne l’engageons plus'. C’est pour cette raison que de moins en moins d’acteurs prennent le risque de faire ce genre de films". En 2006, Nicolas Cage présentera deux films encore inédits, le premier étant un remake du film de Robin Hardy, The Wicker Man (1973), sous la direction de Neil La Bute, puis il apparaîtra dans le rôle principal de l’un des films les plus attendus de l'année, World Trade Center, d’Oliver Stone. FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE: 2007 Ghost Rider 2006 Ant Bully (voix) 2006 World Trade Center 2006 The Wicker Man 2005 Lord of War 2003 Les Associés 2002 Adaptation 2002 Sonny (+ réal) 2002 Windtalkers 2000 60 secondes chrono 1999 A Tombeau ouvert 1999 8MM 1998 Snake Eyes 1998 La Cité des anges 1997 Volte/face 1997 Les Ailes de l'enfer 1996 The Rock 1995 Leaving Las Vegas 1995 Kiss of Death 1994 Un ange gardien pour Tess 1992 Lune de miel à Las Vegas 1991 Sailor et Lula 1986 Peggy Sue s'est mariée 1984 Birdy 1984 Cotton Club 1982 Fast Times at Ridgemont High Nicolas Cage a lancé la carrière de Johnny Depp, le présentant à son agent après une partie de Monopoly chez un ami commun. Un an après cette rencontre, on découvrait Johnny dans Les Griffes de la nuit de Wes Craven (1983). Le meilleur ami de Nicolas Cage n’est autre que Jim Carrey, depuis le tournage de Peggy Sue s'est mariée (Coppola, 1986). On lui connaît aussi des amitiés avec Rob Zombie, Tom Waits ou encore Johnny Ramones, auquel il rendait hommage en janvier 2005. Il lui a fallu passer un nombre d’épreuves incroyable pour convaincre Patricia Arquette de son amour. Sean Connery a accepté le rôle de John Mason pour pouvoir travailler avec Nicolas Cage. Son amour du comic book l’a poussé à tourner Ghost Rider de Mark Steven Johnson (sortie en 2007). Nicolas Cage était auparavant lié aux projets de faire renaître Superman (avec Tim Burton) et Spider-Man (dans le rôle du bouffon vert). Il possède par ailleurs toujours les droits de Hard Boiled, bande dessinée de Frank Miller que David Fincher devait réaliser. Enfin son dernier enfant, né en 2004, se nomme Kal-el, soit le vrai prénom de Superman. Parmi ses nombreux futurs films, on note l’adaptation d’une nouvelle de Philip K. Dick (Next, de Lee Tamahori, avec Julianne Moore), un film sur le poker (Amarillo Slim, de Milos Forman), la suite de National Treasure (prévue pour 2007) ou encore une comédie avec Will Smith (Time Share). mercredi, février 15, 2006
Sur un air de rodéo mongol.


 1994 : Naissance du groupe punk-rock Haforciory ,avec à sa tête, Pierrot (guitare et chant). 1995 : Naissance du groupe rock Bobby Burns, avec à sa tête, Chico (guitare et chant). 1996 : Festival Electrorock à Tonneins (47), les deux groupes font partie de la programmation et sympathisent. 1997 : Chico intègre les Haforciory qui ont décidé d'ajouter une guitare à la formation, tout en continuant de jouer avec Bobby Burns. 1998 : Séparation des Bobby BurnsAprès une cinquantaine de concerts, l'enregistrement d'une démo 4 titres ("Beware of the Mad Cow"), et une présélection au tremplin Ultrason, la power-pop atypique du groupe finissait par obtenir une reconnaissance tant attendue. Les désaccords au sein du groupe ont cependant raison de celui-ci: ils annulent toutes les dates prévues pour ne se produire qu'une dernière fois à Marmande, au bar Le Liberté. Juin 1999 : Séparation des HaforcioryLe groupe aura définitivement marqué la scène punk du Sud-Ouest au cours de la centaine de concerts assénés de Toulouse à Bordeaux, d'Agen à Bayonne…Ils laisseront derrière eux deux démos("Moi, Lui et l'Autre" et "Sauve qui peut") et un album-calvaire ("Quartier Ivre")qui ne sera jamais distribué mais qui influencera le groupe dans sa décision de jeter l'éponge. Ils choisiront de donner leur dernier concert le 26 juin, lors de la traditionnelle "Fête à Roger" au Pont-Canal à Agen. Juillet 1999 : Naissance du groupe punk Bandera NegraPierrot abandonne le chant mais garde sa guitare... Décembre 1999 : Naissance du projet MONGOL RODEO Chico décide de mettre un terme aux compromis musicaux en enregistrant seul, un répertoire d'une dizaine de titres sur un magnétophone 8 pistes. Il se lance ensuite à la recherche de musiciens pour assurer avec lui la partie scénique. La galère commence...Mars 2001 : Suite au départ de leur bassiste, les Bandera Negra recrute Chico afin d'en assurer le remplacement. Juillet 2001 : C'est décidé, Pierrot sera le guitariste de Mongol Rodéo! Mars 2002 : Sim's, guitariste du groupe Mascarade (deux albums sur le label On A Faim!Records : "Raaah!!!" et "Hé Bé!"), propose ses services au Rodéo afin de les aider à gérer toute la partie électronique et sonorisation en passant derrière les consoles. Ce qui était ressenti comme un handicap lors des premières répétitions va grâce à lui étoffer le rock'n'roll zarbi et braillard des Mongols, d'une touche électro.C'est finalement Ness, photographe attitrée, qui prend le relais de Sim's sur scène, lorsque celui-ci est obligé de quitter le groupe pour des problèmes de santé. MONGOL RODEO c/o CHICO"Lacourège"47400 Gontaud.
1994 : Naissance du groupe punk-rock Haforciory ,avec à sa tête, Pierrot (guitare et chant). 1995 : Naissance du groupe rock Bobby Burns, avec à sa tête, Chico (guitare et chant). 1996 : Festival Electrorock à Tonneins (47), les deux groupes font partie de la programmation et sympathisent. 1997 : Chico intègre les Haforciory qui ont décidé d'ajouter une guitare à la formation, tout en continuant de jouer avec Bobby Burns. 1998 : Séparation des Bobby BurnsAprès une cinquantaine de concerts, l'enregistrement d'une démo 4 titres ("Beware of the Mad Cow"), et une présélection au tremplin Ultrason, la power-pop atypique du groupe finissait par obtenir une reconnaissance tant attendue. Les désaccords au sein du groupe ont cependant raison de celui-ci: ils annulent toutes les dates prévues pour ne se produire qu'une dernière fois à Marmande, au bar Le Liberté. Juin 1999 : Séparation des HaforcioryLe groupe aura définitivement marqué la scène punk du Sud-Ouest au cours de la centaine de concerts assénés de Toulouse à Bordeaux, d'Agen à Bayonne…Ils laisseront derrière eux deux démos("Moi, Lui et l'Autre" et "Sauve qui peut") et un album-calvaire ("Quartier Ivre")qui ne sera jamais distribué mais qui influencera le groupe dans sa décision de jeter l'éponge. Ils choisiront de donner leur dernier concert le 26 juin, lors de la traditionnelle "Fête à Roger" au Pont-Canal à Agen. Juillet 1999 : Naissance du groupe punk Bandera NegraPierrot abandonne le chant mais garde sa guitare... Décembre 1999 : Naissance du projet MONGOL RODEO Chico décide de mettre un terme aux compromis musicaux en enregistrant seul, un répertoire d'une dizaine de titres sur un magnétophone 8 pistes. Il se lance ensuite à la recherche de musiciens pour assurer avec lui la partie scénique. La galère commence...Mars 2001 : Suite au départ de leur bassiste, les Bandera Negra recrute Chico afin d'en assurer le remplacement. Juillet 2001 : C'est décidé, Pierrot sera le guitariste de Mongol Rodéo! Mars 2002 : Sim's, guitariste du groupe Mascarade (deux albums sur le label On A Faim!Records : "Raaah!!!" et "Hé Bé!"), propose ses services au Rodéo afin de les aider à gérer toute la partie électronique et sonorisation en passant derrière les consoles. Ce qui était ressenti comme un handicap lors des premières répétitions va grâce à lui étoffer le rock'n'roll zarbi et braillard des Mongols, d'une touche électro.C'est finalement Ness, photographe attitrée, qui prend le relais de Sim's sur scène, lorsque celui-ci est obligé de quitter le groupe pour des problèmes de santé. MONGOL RODEO c/o CHICO"Lacourège"47400 Gontaud.tel: 06 08 09 66 30 Email: http://www.panx.net/bruit/mongolrodeo














