mardi, février 21, 2006
Martin, the Crazies & the witch.
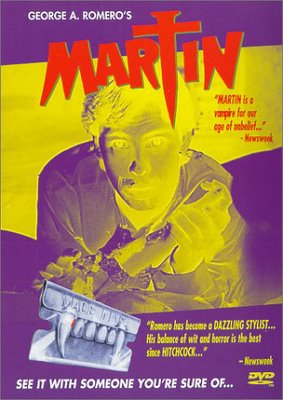 Martin sort demain chez Wild side video, l’occasion de revenir sur trois œuvres oubliées, bien plus intéressantes, à mon goût, que le Land of the dead. "Martin est un jeune homme de 17 ans. Recueilli par son oncle Cuda à Braddock en Pennsylvanie, il est rapidement mis en garde par son tuteur : Martin est un Nosferatu, un vampire âgé de 84 ans, et Cuda doit sauver son âme avant de détruire son enveloppe terrestre. Des meurtres perpétrés par Martin semblent donner raison à son oncle, meurtres au cours desquels Martin boit le sang de ses victimes mais où aucun pouvoir fantastique ne transparaît. Alors Martin : vampire moderne ? fantasme d’une communauté intégriste ? tueur en série ? Le film s’ouvre sur la montée de Martin dans un train et sa recherche d’une victime, séquence parmi les plus fortes de la riche filmographie de George A. Romero. Extrêmement découpée, elle se compose en partie d’une succession des gros plans d’une précision démoniaque qui amènent inéluctablement au cœur de la scène. Le spectateur est immédiatement plongé dans le film, et sans explication aucune, va assister au meurtre d’une passagère. Le noir et blanc fait son apparition alors que Martin a choisi sa proie. Il l’imagine l’accueillant amoureusement dans ses bras, et lorsque celle- ci lutte contre son agresseur, la vision fantasmée de la scène par Martin va venir contaminer la brutalité effective du meurtre en une juxtaposition inédite. Prodigieusement monté, le meurtre voit la fureur défensive de la femme céder la place à l’inquiétude, puis quasiment à son abandon dans les bras de son agresseur. C’est l’image même de la figure mythique de la victime d’un vampire qui succombe au charme érotique de la créature. Seulement ici, point de charme fantastique, mais l’usage d’un substitut chimique, la femme s’assoupissant sous l’effet d’une drogue. Cette séquence contient en germe ce qu’est Martin, incarnation de la frontière ténue qui sépare un fantasme religieux et mythique (le vampire et ses facultés fantastiques) d’une psychose ancrée dans le quotidien. Martin est-il un vampire ou un adolescent psychotique ? Romero n’explicite pas les doutes semés par son intrigue et rien n’interdit d’imaginer que Martin est bel et bien un Nosferatu. Le réalisateur n’assène pas sa vision et laisse le champ libre à l’interprétation, comme ailleurs il refuse d’expliquer la raison de la présence sur terre des morts vivants (juste un laconique : "quand il n’y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre") ou allégorie d’une société que Romero se plaît à disséquer (le quatuor des morts vivants). Que Martin soit un vampire ou non, il est de toute manière isolé comme nombre d’adolescent de son âge, vit les mêmes frustrations. Que Martin soit un vampire ou non, le fait est qu’il tue. Romero observe son héros en multipliant les pistes pour s’en approcher, montrant par là qu’une psychose destructrice est le fruit de nombreux éléments (frustration sexuelle, impuissance, crise d’identité, environnement familial et aliénation sociale…) mais n’est surtout pas réductible à un seul élément : "tu es mauvais, tu es un vampire". Cette fixation de l’oncle Cuda sur le Nosferatu est la critique virulente d’une vision manichéenne du monde, religieuse et rétrograde. « A l’origine, Martin est d’abord une blague. Que se passerait-il si un Vampire était vraiment condamné à vivre éternellement ? Sans doute devrait-il changer les photos de son passeport, de son permis de conduire… Au départ, l’idée était donc de faire une comédie sur les problèmes très concrets, triviaux même, auxquels serait réellement confronté un vampire. » (in. Simulacres). Si le projet abandonne rapidement les rives de la comédie, cette omniprésence du quotidien vient complètement envahir la mythologie du film de vampire, jusqu’à faire passer au second plan l’aspect fantastique pour se concentrer sur une vision naturaliste du vampirisme, vu alors comme reflet des troubles adolescents et véritable maladie mentale. Car Martin a réellement besoin de sang, dans son corps, dans sa chair. Et sa psychose se nourri de toute la fantasmagorie du vampire, véhiculée par l’obscurantisme de son oncle, seul moyen pour Martin de survivre mentalement à l’atrocité des meurtres qu’il commet. Martin est un réceptacle, un véritable héros tragique offert en sacrifice à une société en déliquescence. La ville de Braddock est l’image même de ce monde mourant, « The Magic is all gone » dit Martin. La musique absolument sublime de Donald Rubinstein, achève de donner au film un ton poignant, mêlé de tristesse et de nostalgie. Dans le cinéma de Romero, le fantastique est un moyen d’échapper à l’aliénation. C’est la sorcellerie vers laquelle se tourne l’héroïne de Season of the Witch, la folie destructrice qui s’empare des habitants de The Crazies, le vampirisme qui rassemble autour de Martin les fans (il intervient dans une émission radio) et les combattants du mal (exorcismes, foule à la poursuite du Nosferatu). Les meurtres de Martin ne sont d’ailleurs peut-être qu’un autre moyen de transfigurer son quotidien, de s’affranchir de la tristesse de la banlieue dans laquelle il évolue, de se reconstruire une vie où il est désiré et craint. La transfiguration du quotidien passe par des scènes fantasmatiques en noir et blanc qui ponctuent le parcours de Martin. Scènes de son passé de vampires pourchassé dans les Carpates, vision décalée des meurtres qu’il commet où ses victimes l’invitent dans leurs lits. Toute une imagerie gothique est ici convoquée dans une représentation caricaturale nourrie de toute l’iconographie des films de Vampire. La demeure de Cuda, avec ses icônes religieuses omniprésentes, ses crucifix, ses gousses d’ails, se plie aussi à ce folklore suranné et au fantasme du vieil homme à être une incarnation de Van Helsing. L’architecture même de la ville dévoile des apparences médiévales qui se mêlent aux paysages d’une banlieue sinistrée (voix de chemins de fers, parkings de supermarché, casses automobiles). Des immeubles semblent par moment s’élever comme des cathédrales, décors dont la puissance est accentuée par des contre plongées appuyées. On a ainsi le sentiment que toute la ville est contaminée par l’irrationnel, à la fois perception chimérique de Martin et de son oncle, et berceau de leur folie respective. Si la névrose de Martin est spectaculaire, celle de Cuda est plus insidieuse et bien plus répandue celle du jeune homme et on imagine aisément que son intégrisme est à la base d’un traumatisme enfantin de Martin. Vision fondamentaliste de la maladie mentale qui ne peut s’expliquer que par la possession démoniaque. Martin tente, quand il le peut, quand il n’est pas submergé par ce folklore, de lutter contre cette conception archaïque. Il tente de ramener son oncle à la raison, en lui montrant qu’il peut croquer dans de l’ail et tenir un crucifix. Quand dans une scène, il apparaît en vampire, c’est un véritable vampire de pacotille avec tenue grandiloquente et fausses dents… une manière de décrédibiliser le mythe, de se moquer de son oncle et de ses croyances ancestrales. Gestuelle, costume… tout confère à donner à cette scène, qui se passe près d’un manège, une apparence de foire. Le film est une lutte constante entre la normalité, même si elle passe par l’acceptation d’une psychose, et le fantastique. Une séquence est à cet égard très parlante : lors du meurtre d’un clochard, toute l’imagerie gothique s’évanouit, et c’est juste la crasse, le côté misérable dénué de toute afféterie, qui explose, qui saisit Martin. Ce meurtre ne se pare par de l’aura érotique habituelle. Martin est alors sexuellement satisfait, et étant devenu l’amant d’une habitante de Braddock, seul son besoin de sang le pousse à tuer. Il n’a plus la possibilité de se réfugier dans une vision fantasmée. La sexualité est omniprésente dans le film. La dimension érotique du vampirisme est clairement énoncée : ce n’est pas le sang qui est convoité, mais bel et bien la consommation de sexe, Martin s’entourant des bras de ses victimes endormies, les étreignant amoureusement. Alors que la production fantastique actuelle stagne dans les remakes et le second degré, que la renaissance du genre est annoncée à grands cris à chaque fois qu’un film sort un tantinet du lot pour être aussi vite oublié, que seule l’Asie nous permet encore d’échapper à l’esthétique abominable imposée par des producteurs décérébrés qui confondent pub et cinéma, il est vivifiant de se replonger dans le fantastique des années 1970 ou de véritables auteurs arrivaient à réaliser des œuvres radicales et crues, bourrées d’intelligence et de sincérité. Martin a été tourné pour un budget ridicule de 270,000$, en l’espace de six semaines. Figurants et acteurs viennent de l’entourage de Romero et de son équipe, la maison de Cuda a été gracieusement prêtée par une vieille dame tandis que la police même mettait à disposition ses véhicules. Cette manière de concevoir un film loin des studios, en toute indépendance, terme tellement galvaudé mais qui ici le décrit parfaitement, était alors possible grâce au statut de B Movies qui permettait à de tels films de tenir l’affiche durant une longue période. Ainsi ils se faisaient connaître sans avoir recours à la publicité et des œuvres radicales et décalées, qu’aucun studio n’aurait soutenu, pouvaient voir le jour sans être soumis au diktat imbécile des publicitaires et de ceux qui ne voient dans le cinéma que merchandising et box office. Martin tint ainsi 18 mois en séance de nuit, rencontra tranquillement son public et acquit tout naturellement son statut de film culte. Au-delà d’un mode de production salvateur, il faut également admettre que si Martin ne donne jamais l’impression de souffrir de son budget, c’est grâce à la motivation et au talent de chaque participant. Si le tournage en 16mm accentue grandement le côté cru de la photographie, c’est à son chef opérateur qu’on le doit. Pour sa première expérience à ce poste (poste qu’il ne tiendra d’ailleurs que dans des films de Romero) Michael Gornick fait preuve d’une maturité étonnante en captant à merveille les intérieurs, les visages, les vues de Pittsburgh. Il joue du grain de la pellicule et donne au film, sous l’œil savant de Romero, une beauté étrange et envoûtante. Si la beauté renversante de la musique transcende complètement le film, le son et le mixage jouent un rôle primordial dans la conception de l’univers si particulier de Martin. Romero dit s’être inspiré des Contes d’Hoffman de Michael Powell et Emeric Pressburger, dans des expériences visuelles et sonores où il fait s’opposer un découpage haché à une musique ralentie à l’extrême. Croyance dans les vertus du cinéma, inventivité, honnêteté, investissement, autant de valeurs qui remplacent le budget le plus confortable. Si l’on ajoute à cela l’interprétation incroyable de John Amplas, qui ouvre constamment son jeu et donne mille facettes au personnage de Martin, on obtient ce qui est pour beaucoup le meilleur film de George A. Romero, son œuvre la plus belle et la plus triste. Notes : - Les captures sont issues du dvd, et ne respectent donc pas le format d’origine du film.- Il existerait, selon Romero lui même, une version originale du film de 2h45 (il en fait mention dans les commentaires audio de l’édition Anchor Bay) entièrement en noir et blanc. Mais cette copie du film aurait été subtilisée du laboratoire. Image : Le film est présenté dans un nouveau transfert haute définition en 16 :9. Martin a été tourné en 16mm, au format 1.33, l’image a donc été matté pour obtenir une version en 1.85. Il est dommageable de découvrir le film dans ces conditions, le cadrage étant bien évidemment pensé pour du Full Frame. Mais l’édition Anchor Bay, qui respectait le format d’origine, étant épuisée, et en attendant de vérifier le choix de Wild Side pour la sortie prochaine d’un double DVD Z2, c’est actuellement la seule possibilité de voir le film (on peut citer une édition Arrow qui ne vaut guère plus qu’une VHS usagée) . Cela dit, le résultat n’est pas aussi rebutant que ce qui était prévisible, Lion’s Gate ayant visiblement réfléchi constamment à ce recadrage. Bien entendu, il est conseillé de découvrir le film dans son format d’origine, mais il n’est pas honteux de l’apprécier dans cette version, même si certaines scènes pâtissent réellement de ce choix éditorial plus que douteux. La copie est très propre et le transfert une véritable réussite, même si on peut regretter des couleurs parfois saturées. Richard Rubinstein, le producteur, précise d’ailleurs dans les commentaires audio que le coût de ce transfert correspond à la moitié du budget du film Image : Le film est au format 1.77 équivalent à l’édition Lion’s Gate ce qui nous permet d’enfoncer un peu plus le clou d’autant qu’un autre facteur rentre en jeu. En effet, la copie a subi un traitement de fond qui fait presque disparaître le grain d’origine, et l’un des charmes du Martin d’origine de s’évaporer. Cette propension à aplanir les films, à les faire rentrer dans un moule (format panoramique, image lisse et propre) ne cesse de nous surprendre. Si la raison économique saute aux yeux, il devrait être du devoir d’un éditeur aussi exigeant et cinéphile que l’est Wild Side de proposer au moins le film dans sa version d’origine. A vouloir à tout prix formater les films, que deviennent-ils au final ? Ils n’acquièrent pas une aura commerciale du fait de ces nettoyages et perdent du même coup leur saveur propre. Car le Martin que nous avons découvert en salle n’existe maintenant plus que dans notre souvenir. Cette bande rugueuse, brute, sortie de nulle part, tend à se confondre avec le reste de la production. Heureusement le chef d’œuvre de Romero pourrait subir mille outrages qu’il conserverait sa puissance unique. Mais qu’en est-il d’autres films moins personnels, moins forts, qui nous ont marqué d’abord par leur côté viscéral ? Pour en revenir au chapitre technique, le problème de ce nettoyage est de créer de légers fourmillements sur les textures claires et les visages. La colorimétrie a tendance à tirer un peu sur le vert. La luminosité est plus poussée que dans l’édition Lion’s gate, ce qui produit des scènes de nuit peut-être plus lisibles mais où les noirs sont bien moins profonds. La définition est quant à elle améliorée par rapport au zone 1.
Martin sort demain chez Wild side video, l’occasion de revenir sur trois œuvres oubliées, bien plus intéressantes, à mon goût, que le Land of the dead. "Martin est un jeune homme de 17 ans. Recueilli par son oncle Cuda à Braddock en Pennsylvanie, il est rapidement mis en garde par son tuteur : Martin est un Nosferatu, un vampire âgé de 84 ans, et Cuda doit sauver son âme avant de détruire son enveloppe terrestre. Des meurtres perpétrés par Martin semblent donner raison à son oncle, meurtres au cours desquels Martin boit le sang de ses victimes mais où aucun pouvoir fantastique ne transparaît. Alors Martin : vampire moderne ? fantasme d’une communauté intégriste ? tueur en série ? Le film s’ouvre sur la montée de Martin dans un train et sa recherche d’une victime, séquence parmi les plus fortes de la riche filmographie de George A. Romero. Extrêmement découpée, elle se compose en partie d’une succession des gros plans d’une précision démoniaque qui amènent inéluctablement au cœur de la scène. Le spectateur est immédiatement plongé dans le film, et sans explication aucune, va assister au meurtre d’une passagère. Le noir et blanc fait son apparition alors que Martin a choisi sa proie. Il l’imagine l’accueillant amoureusement dans ses bras, et lorsque celle- ci lutte contre son agresseur, la vision fantasmée de la scène par Martin va venir contaminer la brutalité effective du meurtre en une juxtaposition inédite. Prodigieusement monté, le meurtre voit la fureur défensive de la femme céder la place à l’inquiétude, puis quasiment à son abandon dans les bras de son agresseur. C’est l’image même de la figure mythique de la victime d’un vampire qui succombe au charme érotique de la créature. Seulement ici, point de charme fantastique, mais l’usage d’un substitut chimique, la femme s’assoupissant sous l’effet d’une drogue. Cette séquence contient en germe ce qu’est Martin, incarnation de la frontière ténue qui sépare un fantasme religieux et mythique (le vampire et ses facultés fantastiques) d’une psychose ancrée dans le quotidien. Martin est-il un vampire ou un adolescent psychotique ? Romero n’explicite pas les doutes semés par son intrigue et rien n’interdit d’imaginer que Martin est bel et bien un Nosferatu. Le réalisateur n’assène pas sa vision et laisse le champ libre à l’interprétation, comme ailleurs il refuse d’expliquer la raison de la présence sur terre des morts vivants (juste un laconique : "quand il n’y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre") ou allégorie d’une société que Romero se plaît à disséquer (le quatuor des morts vivants). Que Martin soit un vampire ou non, il est de toute manière isolé comme nombre d’adolescent de son âge, vit les mêmes frustrations. Que Martin soit un vampire ou non, le fait est qu’il tue. Romero observe son héros en multipliant les pistes pour s’en approcher, montrant par là qu’une psychose destructrice est le fruit de nombreux éléments (frustration sexuelle, impuissance, crise d’identité, environnement familial et aliénation sociale…) mais n’est surtout pas réductible à un seul élément : "tu es mauvais, tu es un vampire". Cette fixation de l’oncle Cuda sur le Nosferatu est la critique virulente d’une vision manichéenne du monde, religieuse et rétrograde. « A l’origine, Martin est d’abord une blague. Que se passerait-il si un Vampire était vraiment condamné à vivre éternellement ? Sans doute devrait-il changer les photos de son passeport, de son permis de conduire… Au départ, l’idée était donc de faire une comédie sur les problèmes très concrets, triviaux même, auxquels serait réellement confronté un vampire. » (in. Simulacres). Si le projet abandonne rapidement les rives de la comédie, cette omniprésence du quotidien vient complètement envahir la mythologie du film de vampire, jusqu’à faire passer au second plan l’aspect fantastique pour se concentrer sur une vision naturaliste du vampirisme, vu alors comme reflet des troubles adolescents et véritable maladie mentale. Car Martin a réellement besoin de sang, dans son corps, dans sa chair. Et sa psychose se nourri de toute la fantasmagorie du vampire, véhiculée par l’obscurantisme de son oncle, seul moyen pour Martin de survivre mentalement à l’atrocité des meurtres qu’il commet. Martin est un réceptacle, un véritable héros tragique offert en sacrifice à une société en déliquescence. La ville de Braddock est l’image même de ce monde mourant, « The Magic is all gone » dit Martin. La musique absolument sublime de Donald Rubinstein, achève de donner au film un ton poignant, mêlé de tristesse et de nostalgie. Dans le cinéma de Romero, le fantastique est un moyen d’échapper à l’aliénation. C’est la sorcellerie vers laquelle se tourne l’héroïne de Season of the Witch, la folie destructrice qui s’empare des habitants de The Crazies, le vampirisme qui rassemble autour de Martin les fans (il intervient dans une émission radio) et les combattants du mal (exorcismes, foule à la poursuite du Nosferatu). Les meurtres de Martin ne sont d’ailleurs peut-être qu’un autre moyen de transfigurer son quotidien, de s’affranchir de la tristesse de la banlieue dans laquelle il évolue, de se reconstruire une vie où il est désiré et craint. La transfiguration du quotidien passe par des scènes fantasmatiques en noir et blanc qui ponctuent le parcours de Martin. Scènes de son passé de vampires pourchassé dans les Carpates, vision décalée des meurtres qu’il commet où ses victimes l’invitent dans leurs lits. Toute une imagerie gothique est ici convoquée dans une représentation caricaturale nourrie de toute l’iconographie des films de Vampire. La demeure de Cuda, avec ses icônes religieuses omniprésentes, ses crucifix, ses gousses d’ails, se plie aussi à ce folklore suranné et au fantasme du vieil homme à être une incarnation de Van Helsing. L’architecture même de la ville dévoile des apparences médiévales qui se mêlent aux paysages d’une banlieue sinistrée (voix de chemins de fers, parkings de supermarché, casses automobiles). Des immeubles semblent par moment s’élever comme des cathédrales, décors dont la puissance est accentuée par des contre plongées appuyées. On a ainsi le sentiment que toute la ville est contaminée par l’irrationnel, à la fois perception chimérique de Martin et de son oncle, et berceau de leur folie respective. Si la névrose de Martin est spectaculaire, celle de Cuda est plus insidieuse et bien plus répandue celle du jeune homme et on imagine aisément que son intégrisme est à la base d’un traumatisme enfantin de Martin. Vision fondamentaliste de la maladie mentale qui ne peut s’expliquer que par la possession démoniaque. Martin tente, quand il le peut, quand il n’est pas submergé par ce folklore, de lutter contre cette conception archaïque. Il tente de ramener son oncle à la raison, en lui montrant qu’il peut croquer dans de l’ail et tenir un crucifix. Quand dans une scène, il apparaît en vampire, c’est un véritable vampire de pacotille avec tenue grandiloquente et fausses dents… une manière de décrédibiliser le mythe, de se moquer de son oncle et de ses croyances ancestrales. Gestuelle, costume… tout confère à donner à cette scène, qui se passe près d’un manège, une apparence de foire. Le film est une lutte constante entre la normalité, même si elle passe par l’acceptation d’une psychose, et le fantastique. Une séquence est à cet égard très parlante : lors du meurtre d’un clochard, toute l’imagerie gothique s’évanouit, et c’est juste la crasse, le côté misérable dénué de toute afféterie, qui explose, qui saisit Martin. Ce meurtre ne se pare par de l’aura érotique habituelle. Martin est alors sexuellement satisfait, et étant devenu l’amant d’une habitante de Braddock, seul son besoin de sang le pousse à tuer. Il n’a plus la possibilité de se réfugier dans une vision fantasmée. La sexualité est omniprésente dans le film. La dimension érotique du vampirisme est clairement énoncée : ce n’est pas le sang qui est convoité, mais bel et bien la consommation de sexe, Martin s’entourant des bras de ses victimes endormies, les étreignant amoureusement. Alors que la production fantastique actuelle stagne dans les remakes et le second degré, que la renaissance du genre est annoncée à grands cris à chaque fois qu’un film sort un tantinet du lot pour être aussi vite oublié, que seule l’Asie nous permet encore d’échapper à l’esthétique abominable imposée par des producteurs décérébrés qui confondent pub et cinéma, il est vivifiant de se replonger dans le fantastique des années 1970 ou de véritables auteurs arrivaient à réaliser des œuvres radicales et crues, bourrées d’intelligence et de sincérité. Martin a été tourné pour un budget ridicule de 270,000$, en l’espace de six semaines. Figurants et acteurs viennent de l’entourage de Romero et de son équipe, la maison de Cuda a été gracieusement prêtée par une vieille dame tandis que la police même mettait à disposition ses véhicules. Cette manière de concevoir un film loin des studios, en toute indépendance, terme tellement galvaudé mais qui ici le décrit parfaitement, était alors possible grâce au statut de B Movies qui permettait à de tels films de tenir l’affiche durant une longue période. Ainsi ils se faisaient connaître sans avoir recours à la publicité et des œuvres radicales et décalées, qu’aucun studio n’aurait soutenu, pouvaient voir le jour sans être soumis au diktat imbécile des publicitaires et de ceux qui ne voient dans le cinéma que merchandising et box office. Martin tint ainsi 18 mois en séance de nuit, rencontra tranquillement son public et acquit tout naturellement son statut de film culte. Au-delà d’un mode de production salvateur, il faut également admettre que si Martin ne donne jamais l’impression de souffrir de son budget, c’est grâce à la motivation et au talent de chaque participant. Si le tournage en 16mm accentue grandement le côté cru de la photographie, c’est à son chef opérateur qu’on le doit. Pour sa première expérience à ce poste (poste qu’il ne tiendra d’ailleurs que dans des films de Romero) Michael Gornick fait preuve d’une maturité étonnante en captant à merveille les intérieurs, les visages, les vues de Pittsburgh. Il joue du grain de la pellicule et donne au film, sous l’œil savant de Romero, une beauté étrange et envoûtante. Si la beauté renversante de la musique transcende complètement le film, le son et le mixage jouent un rôle primordial dans la conception de l’univers si particulier de Martin. Romero dit s’être inspiré des Contes d’Hoffman de Michael Powell et Emeric Pressburger, dans des expériences visuelles et sonores où il fait s’opposer un découpage haché à une musique ralentie à l’extrême. Croyance dans les vertus du cinéma, inventivité, honnêteté, investissement, autant de valeurs qui remplacent le budget le plus confortable. Si l’on ajoute à cela l’interprétation incroyable de John Amplas, qui ouvre constamment son jeu et donne mille facettes au personnage de Martin, on obtient ce qui est pour beaucoup le meilleur film de George A. Romero, son œuvre la plus belle et la plus triste. Notes : - Les captures sont issues du dvd, et ne respectent donc pas le format d’origine du film.- Il existerait, selon Romero lui même, une version originale du film de 2h45 (il en fait mention dans les commentaires audio de l’édition Anchor Bay) entièrement en noir et blanc. Mais cette copie du film aurait été subtilisée du laboratoire. Image : Le film est présenté dans un nouveau transfert haute définition en 16 :9. Martin a été tourné en 16mm, au format 1.33, l’image a donc été matté pour obtenir une version en 1.85. Il est dommageable de découvrir le film dans ces conditions, le cadrage étant bien évidemment pensé pour du Full Frame. Mais l’édition Anchor Bay, qui respectait le format d’origine, étant épuisée, et en attendant de vérifier le choix de Wild Side pour la sortie prochaine d’un double DVD Z2, c’est actuellement la seule possibilité de voir le film (on peut citer une édition Arrow qui ne vaut guère plus qu’une VHS usagée) . Cela dit, le résultat n’est pas aussi rebutant que ce qui était prévisible, Lion’s Gate ayant visiblement réfléchi constamment à ce recadrage. Bien entendu, il est conseillé de découvrir le film dans son format d’origine, mais il n’est pas honteux de l’apprécier dans cette version, même si certaines scènes pâtissent réellement de ce choix éditorial plus que douteux. La copie est très propre et le transfert une véritable réussite, même si on peut regretter des couleurs parfois saturées. Richard Rubinstein, le producteur, précise d’ailleurs dans les commentaires audio que le coût de ce transfert correspond à la moitié du budget du film Image : Le film est au format 1.77 équivalent à l’édition Lion’s Gate ce qui nous permet d’enfoncer un peu plus le clou d’autant qu’un autre facteur rentre en jeu. En effet, la copie a subi un traitement de fond qui fait presque disparaître le grain d’origine, et l’un des charmes du Martin d’origine de s’évaporer. Cette propension à aplanir les films, à les faire rentrer dans un moule (format panoramique, image lisse et propre) ne cesse de nous surprendre. Si la raison économique saute aux yeux, il devrait être du devoir d’un éditeur aussi exigeant et cinéphile que l’est Wild Side de proposer au moins le film dans sa version d’origine. A vouloir à tout prix formater les films, que deviennent-ils au final ? Ils n’acquièrent pas une aura commerciale du fait de ces nettoyages et perdent du même coup leur saveur propre. Car le Martin que nous avons découvert en salle n’existe maintenant plus que dans notre souvenir. Cette bande rugueuse, brute, sortie de nulle part, tend à se confondre avec le reste de la production. Heureusement le chef d’œuvre de Romero pourrait subir mille outrages qu’il conserverait sa puissance unique. Mais qu’en est-il d’autres films moins personnels, moins forts, qui nous ont marqué d’abord par leur côté viscéral ? Pour en revenir au chapitre technique, le problème de ce nettoyage est de créer de légers fourmillements sur les textures claires et les visages. La colorimétrie a tendance à tirer un peu sur le vert. La luminosité est plus poussée que dans l’édition Lion’s gate, ce qui produit des scènes de nuit peut-être plus lisibles mais où les noirs sont bien moins profonds. La définition est quant à elle améliorée par rapport au zone 1.The Crazies & Season of the witch
Les deux films de Romero furent tournés en 16mm puis gonflés en 35mm au format standard 1.33. La restauration numérique produit des miracles. Pendant longtemps, les spectateurs français n’avaient eu qu’une copie charbonneuse et sombre, à la définition sommaire, en mauvais état à visionner pour The Crazies : la fameuse copie v.f. sortie avec 7 ans de retard au cinéma et transférée telle quelle en VHS Secam. Ici la plupart de ses défauts ont disparus suite à une très belle restauration américaine. Définition, luminosité, couleurs : tout a été amélioré et le film acquiert une nouvelle jeunesse. Concernant Season of the Witch, inédit en France mis à part à la Cinémathèque Française lors d’une rétrospective Romero le jeudi 6 décembre 2001, c’est la première fois que le film bénéficie d’une distribution vidéo en France : elle est effectuée dans les mêmes conditions et le résultat est tout aussi remarquable.Reste tout de même que le transfert de Season of the Witch tire sur le vert, perturbé encore par quelques poussières et sauts d'images, la compression étant largement perfectible. The Crazies s'en sort nettement mieux de ce côté là, même si le résultat n'est pas encore parfait Seules les Mono v.o.s.t.f. nous sont proposées. C’est bien sûr l’essentiel : c’est la première fois en France que ces v.o.s.t.f. sont distribuées en vidéo et c’est une découverte magnifique. Mais on aurait aimé disposer aussi du doublage français honorable de 1979 pour The Crazies [La nuit des fous vivants]. Question de droits ou de perte du matériel toujours regrettable : on ne jette pas la pierre à l’éditeur tant les questions de droits et de matériel sont régulièrement inextricables sur certains films. Techniquement ces pistes bénéficient d'une clarté globale appréciable, même si l'on note du souffle dans certaines voix et musiques.
The Crazies (La Nuit des Fous Vivants, 1973)
 Connu aussi sous les noms "Code Name Trixie" et "Cosmos 859"Avec W.G. Mc Millan, Harold Wayne, Lane Carrol, Jones Lloyd Hollar, Lynn Lowrie, Richard Liberty,…Un virus transformé en arme bactériologique secrète, répandu accidentellement dans l’eau d’une rivière par l’armée à la suite d’un accident d’avion, transforme les habitants de la villeaméricaine la plus proche en fous meurtriers. Face à l’ampleur du carnage, l’armée délimite, boucle puis quadrille le périmètre contaminé. Washington dépêche sur place un chercheur du projet "Trixie", nom de code militaire de ce virus – qu’on se tient prêt à atomiser en cas d’excessive propagation à l’aide d’un bombardier B-52. L’armée, soumise à des assauts continuels, abat sans sommation ceux qui l’attaquent mais aussi ceux qui veulent franchir le périmètre. Un petit groupe de civils décide de se frayer un chemin armé hors du périmètre. Mais la folie guette ses membres, engagés dorénavant dans une lutte à mort de tous les instants… Second chef-d’œuvre de Romero, et son quatrième film si on suit la chronologie de sa filmographie puisqu’il fut tourné après Season of the Witch. Son importance intrinsèque justifie que nous le critiquions en premier. On peut en effet le considérer comme le chaînon manquant à sa désormais classique trilogie des morts-vivants pour qu’elle devienne une authentique tétralogie. Sorti très tardivement et confidentiellement à Paris en salles vers 1979, dans une copie bien doublée mais assez abîmée, sous un titre qui évoquait naturellement de Night of the Living Dead [La nuit des morts vivants] (USA 1968) par la suite exploitée en VHS Secam sous le titre Experiment 2000 chez Victory Video et Reflex Video, The Crazies [La nuit des fous vivants] est connu aussi aux USA sous les titres Cosmos 859 et Code Name Trixie. Le titre d’exploitation français est parfaitement adapté au climat du film et indique avec raison une analogie de structure. Deux grandes différences néanmoins entre le film de 1968 et celui de 1972 : l’emploi de la couleur d’une part et l’argument du scénario qui est moins "fantastique" que "science-fiction" et accentue même encore l’aspect "politique-fiction". On pense plus d’une fois au cinéma de Peter Watkins lorsqu’on visionne The Crazies. Mais certains aspects proprement fantastiques et son petit budget magnifiquement exploité sous forme d’une liberté parfois expérimentale à l’absolue virulence le rattachent néanmoins directement au chef-d’œuvre de 1968 dont il est clairement une variation : les morts-vivants cannibales étant remplacés par des fous assassins. À noter son extrême violence, au rythme encore plus hallucinant (on y tue pratiquement sans arrêt), et un emploi forcené de la carabine USM2 encore en dotation à l’époque dans bien des unités : elle se différencie de la USM1 originale par son sélecteur pour le tir automatique en rafales, aux effets dévastateurs dans le film comme dans la réalité. Mis à part la charmante Lynn Lowry que l’on retrouvera peu de temps après dans Parasite Murders / Shivers [Frissons] - le premier grand film fantastique de David Cronenberg -le reste de l’interprétation est pratiquement inconnu mais très souvent excellent à commencer par les deux héros, stupéfiants de présence et d’efficacité dramatique. Jean-François Rauger a justement remarqué dans son article sur Romero édité dans le Programme de la Cinémathèque Française de novembre-décembre 2001 (c’est une évidence mais il est toujours bon d’écrire une évidence : en général personne n’a songé à le faire auparavant) que le thème de l’armée anonyme dont les visages sont recouverts de masques à gaz est un point commun à The Crazies et à Dawn of the Dead. Et aussi que tout comme dans Night of the Living Dead, un groupe de rescapés est pris en tenaille entre monstres inhumains et milices ou armées contraintes à devenir non-moins inhumaines, d’où un suspense étouffant qui ne se relâche jamais. Ajoutons que ce sera aussi la structure de Day of the Dead : la société civile y est prise en tenaille de la même manière mais des interactions se produisent entre les trois groupes. En fait, elles se produisent dans les 4 films. N’importe quel individu peut passer d’une catégorie à l’autre à tout moment, au gré des bouleversements de l’action. Romero dit d’ailleurs explicitement dans son entretien que son thème profond n’est pas politique mais proprement cosmologique et donc authentiquement fantastique. Ce qui l’intéresse, c’est l’hypothèse terrifiante du remplacement, de l’absorption du monde humain par un autre monde, par une nouvelle communauté régie par ce qui n’est plus morale ou esprit mais instinct. Le fait que le thème de l’inceste fasse irruption au cœur même du film est un autre signe spectaculaire du bouleversement de l’ordre humain irréversible provoqué par la catastrophe. L’aspect critique et politique qu’on croit lire dans l’œuvre fantastique de Romero, c’est la conséquence morale parallèle de ce chevauchement que Romero s’attache à dépeindre avec précision. La précision d’une peinture eschatologique comme celle-ci engendre inévitablement un aspect critique mais il est secondaire et non primaire car conséquence n’est pas cause. La nuit des fous vivants est donc bien un très grand film, autant que ses cousins indispensable à une évaluation correcte du génie de Romero. Il était scandaleusement négligé et oublié en France et nous félicitons vivement Wild Side de l’avoir réédité en DVD. L’intégralité de la tétralogie romerienne est à présent disponible en France sur support numérique grâce à cette heureuse initiative.
Connu aussi sous les noms "Code Name Trixie" et "Cosmos 859"Avec W.G. Mc Millan, Harold Wayne, Lane Carrol, Jones Lloyd Hollar, Lynn Lowrie, Richard Liberty,…Un virus transformé en arme bactériologique secrète, répandu accidentellement dans l’eau d’une rivière par l’armée à la suite d’un accident d’avion, transforme les habitants de la villeaméricaine la plus proche en fous meurtriers. Face à l’ampleur du carnage, l’armée délimite, boucle puis quadrille le périmètre contaminé. Washington dépêche sur place un chercheur du projet "Trixie", nom de code militaire de ce virus – qu’on se tient prêt à atomiser en cas d’excessive propagation à l’aide d’un bombardier B-52. L’armée, soumise à des assauts continuels, abat sans sommation ceux qui l’attaquent mais aussi ceux qui veulent franchir le périmètre. Un petit groupe de civils décide de se frayer un chemin armé hors du périmètre. Mais la folie guette ses membres, engagés dorénavant dans une lutte à mort de tous les instants… Second chef-d’œuvre de Romero, et son quatrième film si on suit la chronologie de sa filmographie puisqu’il fut tourné après Season of the Witch. Son importance intrinsèque justifie que nous le critiquions en premier. On peut en effet le considérer comme le chaînon manquant à sa désormais classique trilogie des morts-vivants pour qu’elle devienne une authentique tétralogie. Sorti très tardivement et confidentiellement à Paris en salles vers 1979, dans une copie bien doublée mais assez abîmée, sous un titre qui évoquait naturellement de Night of the Living Dead [La nuit des morts vivants] (USA 1968) par la suite exploitée en VHS Secam sous le titre Experiment 2000 chez Victory Video et Reflex Video, The Crazies [La nuit des fous vivants] est connu aussi aux USA sous les titres Cosmos 859 et Code Name Trixie. Le titre d’exploitation français est parfaitement adapté au climat du film et indique avec raison une analogie de structure. Deux grandes différences néanmoins entre le film de 1968 et celui de 1972 : l’emploi de la couleur d’une part et l’argument du scénario qui est moins "fantastique" que "science-fiction" et accentue même encore l’aspect "politique-fiction". On pense plus d’une fois au cinéma de Peter Watkins lorsqu’on visionne The Crazies. Mais certains aspects proprement fantastiques et son petit budget magnifiquement exploité sous forme d’une liberté parfois expérimentale à l’absolue virulence le rattachent néanmoins directement au chef-d’œuvre de 1968 dont il est clairement une variation : les morts-vivants cannibales étant remplacés par des fous assassins. À noter son extrême violence, au rythme encore plus hallucinant (on y tue pratiquement sans arrêt), et un emploi forcené de la carabine USM2 encore en dotation à l’époque dans bien des unités : elle se différencie de la USM1 originale par son sélecteur pour le tir automatique en rafales, aux effets dévastateurs dans le film comme dans la réalité. Mis à part la charmante Lynn Lowry que l’on retrouvera peu de temps après dans Parasite Murders / Shivers [Frissons] - le premier grand film fantastique de David Cronenberg -le reste de l’interprétation est pratiquement inconnu mais très souvent excellent à commencer par les deux héros, stupéfiants de présence et d’efficacité dramatique. Jean-François Rauger a justement remarqué dans son article sur Romero édité dans le Programme de la Cinémathèque Française de novembre-décembre 2001 (c’est une évidence mais il est toujours bon d’écrire une évidence : en général personne n’a songé à le faire auparavant) que le thème de l’armée anonyme dont les visages sont recouverts de masques à gaz est un point commun à The Crazies et à Dawn of the Dead. Et aussi que tout comme dans Night of the Living Dead, un groupe de rescapés est pris en tenaille entre monstres inhumains et milices ou armées contraintes à devenir non-moins inhumaines, d’où un suspense étouffant qui ne se relâche jamais. Ajoutons que ce sera aussi la structure de Day of the Dead : la société civile y est prise en tenaille de la même manière mais des interactions se produisent entre les trois groupes. En fait, elles se produisent dans les 4 films. N’importe quel individu peut passer d’une catégorie à l’autre à tout moment, au gré des bouleversements de l’action. Romero dit d’ailleurs explicitement dans son entretien que son thème profond n’est pas politique mais proprement cosmologique et donc authentiquement fantastique. Ce qui l’intéresse, c’est l’hypothèse terrifiante du remplacement, de l’absorption du monde humain par un autre monde, par une nouvelle communauté régie par ce qui n’est plus morale ou esprit mais instinct. Le fait que le thème de l’inceste fasse irruption au cœur même du film est un autre signe spectaculaire du bouleversement de l’ordre humain irréversible provoqué par la catastrophe. L’aspect critique et politique qu’on croit lire dans l’œuvre fantastique de Romero, c’est la conséquence morale parallèle de ce chevauchement que Romero s’attache à dépeindre avec précision. La précision d’une peinture eschatologique comme celle-ci engendre inévitablement un aspect critique mais il est secondaire et non primaire car conséquence n’est pas cause. La nuit des fous vivants est donc bien un très grand film, autant que ses cousins indispensable à une évaluation correcte du génie de Romero. Il était scandaleusement négligé et oublié en France et nous félicitons vivement Wild Side de l’avoir réédité en DVD. L’intégralité de la tétralogie romerienne est à présent disponible en France sur support numérique grâce à cette heureuse initiative.Season of the Witch (1973)
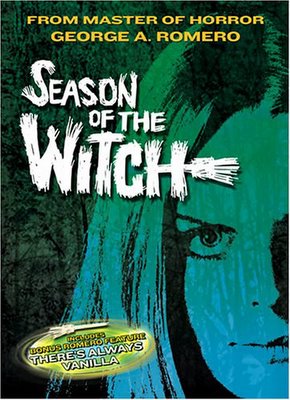 Connu aussi sous les noms "Jack’s Wife", "Hungry Wives", "Witches" Le sommeil de Joan Mitchell, mère de famille aisée mais insatisfaite, est troublé de cauchemars de plus en plus étranges. On lui présente une voisine qui, dit-on, est une sorcière. Elle hésite à la rencontrer mais devient vite fascinée au point qu’elle devient elle-même une sorcière. Imaginaire ou réalité : la ligne est ténue et bientôt rouge de sang. 3ème long-métrage tourné par Romero après Night of the Living Dead (1968) et There’s Always Vanilla (1971) et second échec financier. Romero a eu bien des difficultés à achever le film et même à la tourner. Mais il est, en dépit de son thème très classique, original. Il est tout imprégné de l’esthétique underground des années 70 mais il s’en détache par un strict découpage qui ne laisse pas place au hasard. Son échec commercial est dû tout bonnement à l’absence de violence qui n’intervient que vers la fin du film. L’hésitation entre comédie dramatique, drame psychologique, film underground et cinéma fantastique pur se traduit dans la diversité des titres sous lequel le film est connu : Jack’s Wife / Hungry Wives / Witches. Hésitation de genre, indécision foncière qui sont souvent préjudiciables au succès critique et public d’un film bien qu’elles soient pourtant souvent savoureuses et passionnantes en elles-mêmes et historiquement. C’est bien le cas ici et on s’étonne qu’il ait fallu attendre si longtemps pour découvrir un tel film en France. Les admirateurs de la trilogie/tétralogie seront évidemment un peu déçus. Mais les historiens du cinéma, et ceux qui aspirent à devenir connaisseurs émérites de l’intégralité de la filmographie romérienne, découvriront un film certes inégal mais attachant. Notons que la chanson Season of the Witch est audible dans la bande-son du film et qu’elle confère une étrange résonance à cet essai de fantastique qui dépeint une société aussi strictement contemporaine que les chefs-d’œuvre authentiques qui rendent le maître célèbre. Romero est impitoyable envers la "Beat Generation" : il la critique avec une froide lucidité. Il est de tout cœur du côté de son héroïne : son amant libertaire est présenté du début à la fin comme un personnage ridicule et fat qui ne peut lui apporter ni sincérité ni amour réel. Il n’est pas un meilleur remède à sa solitude que son mari – caricature pour sa part de l’homme américain moyen et intégré, caricature d’ailleurs tout aussi virulente ou que sa fille – adolescente égoïste appartenant à la même "Beat Generation". C’est peut-être du cœur de cette peinture de la solitude féminine – et de cette communauté de solitudes rassemblées autour du thé l’après-midi et très étonnante de vigueur - autant que du thème évident du film que surgit l’aspect proprement et authentiquement fantastique. C’est un aspect de la thématique de Romero qui sera illustré dans Martin (USA 1978) et dans Monkey Shines [Incident de parcours] (USA 1988) : l’impossibilité de communiquer réellement avec autrui engendre un déséquilibre au sein duquel le mal ou la folie naît avec la plus grande facilité. Un point commun, en somme, entre Romero et… Ingmar Bergman ! Mais un point déjà exploité, et autrement mieux, par Terence Fisher. Ce sont les satires à visée contemporaine un peu trop évidente qui vieillissent parfois les plus vites. Celui-ci échappe à cette définition précisément parce qu’il est d’abord et avant tout un honnête conte fantastique, même si habillé aux couleurs "critiques" en vigueur à l’époque.
Connu aussi sous les noms "Jack’s Wife", "Hungry Wives", "Witches" Le sommeil de Joan Mitchell, mère de famille aisée mais insatisfaite, est troublé de cauchemars de plus en plus étranges. On lui présente une voisine qui, dit-on, est une sorcière. Elle hésite à la rencontrer mais devient vite fascinée au point qu’elle devient elle-même une sorcière. Imaginaire ou réalité : la ligne est ténue et bientôt rouge de sang. 3ème long-métrage tourné par Romero après Night of the Living Dead (1968) et There’s Always Vanilla (1971) et second échec financier. Romero a eu bien des difficultés à achever le film et même à la tourner. Mais il est, en dépit de son thème très classique, original. Il est tout imprégné de l’esthétique underground des années 70 mais il s’en détache par un strict découpage qui ne laisse pas place au hasard. Son échec commercial est dû tout bonnement à l’absence de violence qui n’intervient que vers la fin du film. L’hésitation entre comédie dramatique, drame psychologique, film underground et cinéma fantastique pur se traduit dans la diversité des titres sous lequel le film est connu : Jack’s Wife / Hungry Wives / Witches. Hésitation de genre, indécision foncière qui sont souvent préjudiciables au succès critique et public d’un film bien qu’elles soient pourtant souvent savoureuses et passionnantes en elles-mêmes et historiquement. C’est bien le cas ici et on s’étonne qu’il ait fallu attendre si longtemps pour découvrir un tel film en France. Les admirateurs de la trilogie/tétralogie seront évidemment un peu déçus. Mais les historiens du cinéma, et ceux qui aspirent à devenir connaisseurs émérites de l’intégralité de la filmographie romérienne, découvriront un film certes inégal mais attachant. Notons que la chanson Season of the Witch est audible dans la bande-son du film et qu’elle confère une étrange résonance à cet essai de fantastique qui dépeint une société aussi strictement contemporaine que les chefs-d’œuvre authentiques qui rendent le maître célèbre. Romero est impitoyable envers la "Beat Generation" : il la critique avec une froide lucidité. Il est de tout cœur du côté de son héroïne : son amant libertaire est présenté du début à la fin comme un personnage ridicule et fat qui ne peut lui apporter ni sincérité ni amour réel. Il n’est pas un meilleur remède à sa solitude que son mari – caricature pour sa part de l’homme américain moyen et intégré, caricature d’ailleurs tout aussi virulente ou que sa fille – adolescente égoïste appartenant à la même "Beat Generation". C’est peut-être du cœur de cette peinture de la solitude féminine – et de cette communauté de solitudes rassemblées autour du thé l’après-midi et très étonnante de vigueur - autant que du thème évident du film que surgit l’aspect proprement et authentiquement fantastique. C’est un aspect de la thématique de Romero qui sera illustré dans Martin (USA 1978) et dans Monkey Shines [Incident de parcours] (USA 1988) : l’impossibilité de communiquer réellement avec autrui engendre un déséquilibre au sein duquel le mal ou la folie naît avec la plus grande facilité. Un point commun, en somme, entre Romero et… Ingmar Bergman ! Mais un point déjà exploité, et autrement mieux, par Terence Fisher. Ce sont les satires à visée contemporaine un peu trop évidente qui vieillissent parfois les plus vites. Celui-ci échappe à cette définition précisément parce qu’il est d’abord et avant tout un honnête conte fantastique, même si habillé aux couleurs "critiques" en vigueur à l’époque.
