
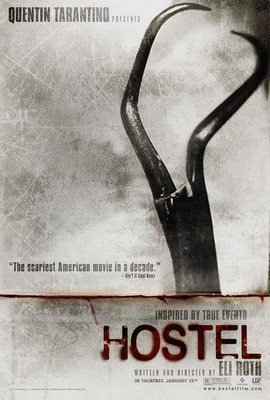


Réalisé par Eli Roth Avec : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson Date de sortie : 1 Mars 2006. Deux étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Avec Oli, un Islandais qu'ils ont rencontré en chemin, ils se retrouvent à Prague dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche : une propriété très spéciale, pleine de filles aussi belles que faciles... Natalya et Svetlana sont effectivement très cools... un peu trop, même. Paxton et Josh vont vite se rendre compte qu'ils sont tombés dans un piège. Ce voyage-là va les conduire au bout de l'horreur... Confirmations des rumeurs : esprit potache, plaisir coupable et violence inouïe. Si Cabin Fever, objet qui a ses fans comme ses détracteurs, pouvait laisser dubitatif par son cynisme sournois et sa propension inquiétante à brasser du vide pour déboucher sur une pirouette finale inattendue à la manière de La baie Sanglante de Mario Bava, Hostel, le nouveau film de Eli Roth a le mérite d’être plus probant même s’il n’est pas exempt de faiblesses. Cette fois-ci, il oublie les rednecks pour causer de thèmes plus sombres (trafic humain, mafia, tourisme sexuel...). Question : notre ami se prendrait-il méchamment au sérieux ? Non, juste l'envie de s'amuser avec des choses horribles. Ce n'est pas pour autant que la tonalité se veut plus tragique. Au contraire, pendant un bon bout de bobine, Hostel laisse présager une pochade estudiantine comme on en voit des pléthores. On a tout faux. Tout a commencé par une simple discussion sur les choses les plus tordues et les plus étranges que l'on pouvait trouver sur le net. Par l'intermédiaire d'un ami, Roth tombe sur un site qui proposait pour une somme d'argent considérable d'être accompagné dans une pièce, de prendre une arme et de s'offrir un humain à tuer. Ces lieux dans lesquels des hommes payent, voire parient, sur la vie d'autres hommes (on en revient toujours à la sempiternelle ritournelle de la dégradation de l'homme par l'homme) sont de plus en plus ouvertement abordés au cinéma (revoir des films aussi antithétiques que Incassable, Battle Royale, Intacto ou même le récent 13 pour comprendre l'ampleur du phénomène). Sujet central du film ? Le business du meurtre dont la morale est résumée par Takashi Miike (jouer peut coûter très cher). Eli Roth n'a bien entendu pas envie de faire dans la thèse et préfère le rire à la grise mine. Il aborde le sujet à sa façon, de manière détournée mais non moins violente, quitte à parfois faire quelques fioritures pour estomper le malaise. Ce n'est que lorsqu'il a parlé du sujet à Quentin Tarantino et que ce dernier lui a fait part de son profond enthousiasme qu'Eli Roth s'est attelé au projet, en oubliant quelques instants The Box, son film coécrit avec Richard Kelly et tiré d'une nouvelle de Richard Matheson. Premier point incontestable qui se ressent à la vision d'Hostel : l’alchimie entre Eli Roth et Quentin Tarantino est plus cohérente que celle du jeune réalisateur avec David Lynch, dont les mondes cinématographiques divergent. Si Lynch aime à instiller des univers troubles, emprunte des chemins tortueux en faisant fi de toute notion rationnelle et dirige ses acteurs avec des métaphores, Roth et Tarantino ont la même façon de préparer leurs films. Ils sélectionnent tous les éléments qui leur plaisent ou leur ont plu dans leur vie de cinéphile, les isolent, les colmatent et orchestrent un festin hautement jubilatoire. Cela s’effectue au détriment même de la vraisemblance. Les trois personnages masculins ne dépassent à aucun moment la dimension caricaturale. Ils sont présentés comme des fumeurs de joints patentés qui ne cachent pas leur immense appétit sexuel. En suivant leur progression (et leur disparition), Hostel peut se fractionner en trois parties inégales. Et c’est l’apparition surréaliste de Takashi Miike qui détermine et crée, par ce qu’il incarne, le changement d’atmosphère comme lui-même le faisait dans Audition, son meilleur film (il partait d’un postulat de comédie romantique fleur bleue pour musarder très rapidement dans l’horreur organique et la violence froide) et référence avouée de Roth. Alors que toute la première partie ressemble à un teenage movie avec une foultitude de plaisirs coupables (hédonisme touristique, myriade de nanas à poil, saphisme, blagues potaches, connotations salaces, bande son obsolète et très eighties), la seconde négocie un virage aussi radical que noir, annoncé par de discrètes bifurcations fantastiques (le Bubble Gum Gang, clan de gamins quasi-démoniaques, regards torves de personnages aux louches intentions, demoiselles possédées comme dans Les femmes de Stepford…). Le dernier tiers verse littéralement dans les délices du gore et du Grand Guignol au point de créer la saturation même chez les aficionados du genre. Sa combinaison est très efficace, même si, en substance, Roth n'invente rien. A quelques exceptions près, Roth ne se départit pas de son humour gaguesque (la scène de la voiture qui repasse sur les corps). Les influences de Roth ont le mérite d’être denses (l’asiatique quasi-fantomatique avec son œil en moins est une allusion aux films de fantômes japonais qu'il a récemment découvert, de même que la traque finale entre la victime et le bourreau évoque inévitablement Marathon Man de John Schlesinger…). Mais elles fonctionnent à double tranchant : le défaut du film naît du manque de personnalité, voire du manque d'âme. Plus roublard que talentueux, plus décomplexé qu’industrieux, Eli Roth profite de ses parrains pour essayer de se différencier du tout-venant alors qu’en fin de compte, il ne révolutionne pas grand-chose. Au gré de ses bobines, le cinéaste assène ses simples objectifs : distraire le spectateur pour qu’il mette ses neurones en stand-by et le faire grincer des dents. Heureusement, cette fois-ci, Roth n’affiche aucun cynisme ou prétention poseuse, ne carbure qu’au premier degré et organise quelques séquences potentiellement impressionnantes dont une qui exploite à bon escient et sans parcimonie les vertus de la tronçonneuse (l’affiche du film qui parodiait celle de Maniac n’était pas trompeuse). La plupart des scènes sulfureuses sont judicieusement placées à la fin pour distiller la gradation horrifique et donnent à voir une sorte de compilation non-stop des pires trouvailles de tortures (talon d’Achille brisé, dépeçage gratiné, énucléation…). Là-dessus, le jeune Roth ne manque point d’imagination (à l’origine, il voulait que le film se termine sur la torture d’une gamine de cinq ans – ce que Murder Set Pieces, de Nick Palumbo, a quasiment osé faire) et atteint mine de rien une sorte de paroxysme dans un genre qui tend à être de plus en plus policé. A l'heure où les lois du consensus mou et du politiquement correct frappent de plein fouet le cinéma US, il va certainement être difficile de faire plus poisseux et malsain. Si on peine à déceler sous l’apparente désinvolture du réal son âme d’artiste - ou même de l'artisan, Eli Roth démontre un certain savoir-faire dans la gestion des effets illustratifs. Avec Hostel, il confirme qu’il tient plus du petit malin que du grand cinéaste. Ce contrepoint accessoire n'entâche qu'en partie la puissance de cette fiction futée et énergique, particulièrement sanguinolente (une sorte d'exploit ?), qui a de quoi remplir les estomacs les plus (a)vides. Mais il vaut mieux prévenir à l’avance : certaines scènes sont si tordues et tripales qu’il serait presque préférable de venir avec son sac à vomi. Oui, à ce point-là. Comme on dit, pour se rassurer, heureusement que tout ce mauvais goût n’est que pour de rire"

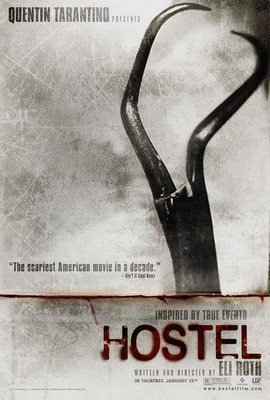

 Réalisé par Eli Roth Avec : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson Date de sortie : 1 Mars 2006. Deux étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Avec Oli, un Islandais qu'ils ont rencontré en chemin, ils se retrouvent à Prague dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche : une propriété très spéciale, pleine de filles aussi belles que faciles... Natalya et Svetlana sont effectivement très cools... un peu trop, même. Paxton et Josh vont vite se rendre compte qu'ils sont tombés dans un piège. Ce voyage-là va les conduire au bout de l'horreur... Confirmations des rumeurs : esprit potache, plaisir coupable et violence inouïe. Si Cabin Fever, objet qui a ses fans comme ses détracteurs, pouvait laisser dubitatif par son cynisme sournois et sa propension inquiétante à brasser du vide pour déboucher sur une pirouette finale inattendue à la manière de La baie Sanglante de Mario Bava, Hostel, le nouveau film de Eli Roth a le mérite d’être plus probant même s’il n’est pas exempt de faiblesses. Cette fois-ci, il oublie les rednecks pour causer de thèmes plus sombres (trafic humain, mafia, tourisme sexuel...). Question : notre ami se prendrait-il méchamment au sérieux ? Non, juste l'envie de s'amuser avec des choses horribles. Ce n'est pas pour autant que la tonalité se veut plus tragique. Au contraire, pendant un bon bout de bobine, Hostel laisse présager une pochade estudiantine comme on en voit des pléthores. On a tout faux. Tout a commencé par une simple discussion sur les choses les plus tordues et les plus étranges que l'on pouvait trouver sur le net. Par l'intermédiaire d'un ami, Roth tombe sur un site qui proposait pour une somme d'argent considérable d'être accompagné dans une pièce, de prendre une arme et de s'offrir un humain à tuer. Ces lieux dans lesquels des hommes payent, voire parient, sur la vie d'autres hommes (on en revient toujours à la sempiternelle ritournelle de la dégradation de l'homme par l'homme) sont de plus en plus ouvertement abordés au cinéma (revoir des films aussi antithétiques que Incassable, Battle Royale, Intacto ou même le récent 13 pour comprendre l'ampleur du phénomène). Sujet central du film ? Le business du meurtre dont la morale est résumée par Takashi Miike (jouer peut coûter très cher). Eli Roth n'a bien entendu pas envie de faire dans la thèse et préfère le rire à la grise mine. Il aborde le sujet à sa façon, de manière détournée mais non moins violente, quitte à parfois faire quelques fioritures pour estomper le malaise. Ce n'est que lorsqu'il a parlé du sujet à Quentin Tarantino et que ce dernier lui a fait part de son profond enthousiasme qu'Eli Roth s'est attelé au projet, en oubliant quelques instants The Box, son film coécrit avec Richard Kelly et tiré d'une nouvelle de Richard Matheson. Premier point incontestable qui se ressent à la vision d'Hostel : l’alchimie entre Eli Roth et Quentin Tarantino est plus cohérente que celle du jeune réalisateur avec David Lynch, dont les mondes cinématographiques divergent. Si Lynch aime à instiller des univers troubles, emprunte des chemins tortueux en faisant fi de toute notion rationnelle et dirige ses acteurs avec des métaphores, Roth et Tarantino ont la même façon de préparer leurs films. Ils sélectionnent tous les éléments qui leur plaisent ou leur ont plu dans leur vie de cinéphile, les isolent, les colmatent et orchestrent un festin hautement jubilatoire. Cela s’effectue au détriment même de la vraisemblance. Les trois personnages masculins ne dépassent à aucun moment la dimension caricaturale. Ils sont présentés comme des fumeurs de joints patentés qui ne cachent pas leur immense appétit sexuel. En suivant leur progression (et leur disparition), Hostel peut se fractionner en trois parties inégales. Et c’est l’apparition surréaliste de Takashi Miike qui détermine et crée, par ce qu’il incarne, le changement d’atmosphère comme lui-même le faisait dans Audition, son meilleur film (il partait d’un postulat de comédie romantique fleur bleue pour musarder très rapidement dans l’horreur organique et la violence froide) et référence avouée de Roth. Alors que toute la première partie ressemble à un teenage movie avec une foultitude de plaisirs coupables (hédonisme touristique, myriade de nanas à poil, saphisme, blagues potaches, connotations salaces, bande son obsolète et très eighties), la seconde négocie un virage aussi radical que noir, annoncé par de discrètes bifurcations fantastiques (le Bubble Gum Gang, clan de gamins quasi-démoniaques, regards torves de personnages aux louches intentions, demoiselles possédées comme dans Les femmes de Stepford…). Le dernier tiers verse littéralement dans les délices du gore et du Grand Guignol au point de créer la saturation même chez les aficionados du genre. Sa combinaison est très efficace, même si, en substance, Roth n'invente rien. A quelques exceptions près, Roth ne se départit pas de son humour gaguesque (la scène de la voiture qui repasse sur les corps). Les influences de Roth ont le mérite d’être denses (l’asiatique quasi-fantomatique avec son œil en moins est une allusion aux films de fantômes japonais qu'il a récemment découvert, de même que la traque finale entre la victime et le bourreau évoque inévitablement Marathon Man de John Schlesinger…). Mais elles fonctionnent à double tranchant : le défaut du film naît du manque de personnalité, voire du manque d'âme. Plus roublard que talentueux, plus décomplexé qu’industrieux, Eli Roth profite de ses parrains pour essayer de se différencier du tout-venant alors qu’en fin de compte, il ne révolutionne pas grand-chose. Au gré de ses bobines, le cinéaste assène ses simples objectifs : distraire le spectateur pour qu’il mette ses neurones en stand-by et le faire grincer des dents. Heureusement, cette fois-ci, Roth n’affiche aucun cynisme ou prétention poseuse, ne carbure qu’au premier degré et organise quelques séquences potentiellement impressionnantes dont une qui exploite à bon escient et sans parcimonie les vertus de la tronçonneuse (l’affiche du film qui parodiait celle de Maniac n’était pas trompeuse). La plupart des scènes sulfureuses sont judicieusement placées à la fin pour distiller la gradation horrifique et donnent à voir une sorte de compilation non-stop des pires trouvailles de tortures (talon d’Achille brisé, dépeçage gratiné, énucléation…). Là-dessus, le jeune Roth ne manque point d’imagination (à l’origine, il voulait que le film se termine sur la torture d’une gamine de cinq ans – ce que Murder Set Pieces, de Nick Palumbo, a quasiment osé faire) et atteint mine de rien une sorte de paroxysme dans un genre qui tend à être de plus en plus policé. A l'heure où les lois du consensus mou et du politiquement correct frappent de plein fouet le cinéma US, il va certainement être difficile de faire plus poisseux et malsain. Si on peine à déceler sous l’apparente désinvolture du réal son âme d’artiste - ou même de l'artisan, Eli Roth démontre un certain savoir-faire dans la gestion des effets illustratifs. Avec Hostel, il confirme qu’il tient plus du petit malin que du grand cinéaste. Ce contrepoint accessoire n'entâche qu'en partie la puissance de cette fiction futée et énergique, particulièrement sanguinolente (une sorte d'exploit ?), qui a de quoi remplir les estomacs les plus (a)vides. Mais il vaut mieux prévenir à l’avance : certaines scènes sont si tordues et tripales qu’il serait presque préférable de venir avec son sac à vomi. Oui, à ce point-là. Comme on dit, pour se rassurer, heureusement que tout ce mauvais goût n’est que pour de rire"
Réalisé par Eli Roth Avec : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson Date de sortie : 1 Mars 2006. Deux étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Avec Oli, un Islandais qu'ils ont rencontré en chemin, ils se retrouvent à Prague dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche : une propriété très spéciale, pleine de filles aussi belles que faciles... Natalya et Svetlana sont effectivement très cools... un peu trop, même. Paxton et Josh vont vite se rendre compte qu'ils sont tombés dans un piège. Ce voyage-là va les conduire au bout de l'horreur... Confirmations des rumeurs : esprit potache, plaisir coupable et violence inouïe. Si Cabin Fever, objet qui a ses fans comme ses détracteurs, pouvait laisser dubitatif par son cynisme sournois et sa propension inquiétante à brasser du vide pour déboucher sur une pirouette finale inattendue à la manière de La baie Sanglante de Mario Bava, Hostel, le nouveau film de Eli Roth a le mérite d’être plus probant même s’il n’est pas exempt de faiblesses. Cette fois-ci, il oublie les rednecks pour causer de thèmes plus sombres (trafic humain, mafia, tourisme sexuel...). Question : notre ami se prendrait-il méchamment au sérieux ? Non, juste l'envie de s'amuser avec des choses horribles. Ce n'est pas pour autant que la tonalité se veut plus tragique. Au contraire, pendant un bon bout de bobine, Hostel laisse présager une pochade estudiantine comme on en voit des pléthores. On a tout faux. Tout a commencé par une simple discussion sur les choses les plus tordues et les plus étranges que l'on pouvait trouver sur le net. Par l'intermédiaire d'un ami, Roth tombe sur un site qui proposait pour une somme d'argent considérable d'être accompagné dans une pièce, de prendre une arme et de s'offrir un humain à tuer. Ces lieux dans lesquels des hommes payent, voire parient, sur la vie d'autres hommes (on en revient toujours à la sempiternelle ritournelle de la dégradation de l'homme par l'homme) sont de plus en plus ouvertement abordés au cinéma (revoir des films aussi antithétiques que Incassable, Battle Royale, Intacto ou même le récent 13 pour comprendre l'ampleur du phénomène). Sujet central du film ? Le business du meurtre dont la morale est résumée par Takashi Miike (jouer peut coûter très cher). Eli Roth n'a bien entendu pas envie de faire dans la thèse et préfère le rire à la grise mine. Il aborde le sujet à sa façon, de manière détournée mais non moins violente, quitte à parfois faire quelques fioritures pour estomper le malaise. Ce n'est que lorsqu'il a parlé du sujet à Quentin Tarantino et que ce dernier lui a fait part de son profond enthousiasme qu'Eli Roth s'est attelé au projet, en oubliant quelques instants The Box, son film coécrit avec Richard Kelly et tiré d'une nouvelle de Richard Matheson. Premier point incontestable qui se ressent à la vision d'Hostel : l’alchimie entre Eli Roth et Quentin Tarantino est plus cohérente que celle du jeune réalisateur avec David Lynch, dont les mondes cinématographiques divergent. Si Lynch aime à instiller des univers troubles, emprunte des chemins tortueux en faisant fi de toute notion rationnelle et dirige ses acteurs avec des métaphores, Roth et Tarantino ont la même façon de préparer leurs films. Ils sélectionnent tous les éléments qui leur plaisent ou leur ont plu dans leur vie de cinéphile, les isolent, les colmatent et orchestrent un festin hautement jubilatoire. Cela s’effectue au détriment même de la vraisemblance. Les trois personnages masculins ne dépassent à aucun moment la dimension caricaturale. Ils sont présentés comme des fumeurs de joints patentés qui ne cachent pas leur immense appétit sexuel. En suivant leur progression (et leur disparition), Hostel peut se fractionner en trois parties inégales. Et c’est l’apparition surréaliste de Takashi Miike qui détermine et crée, par ce qu’il incarne, le changement d’atmosphère comme lui-même le faisait dans Audition, son meilleur film (il partait d’un postulat de comédie romantique fleur bleue pour musarder très rapidement dans l’horreur organique et la violence froide) et référence avouée de Roth. Alors que toute la première partie ressemble à un teenage movie avec une foultitude de plaisirs coupables (hédonisme touristique, myriade de nanas à poil, saphisme, blagues potaches, connotations salaces, bande son obsolète et très eighties), la seconde négocie un virage aussi radical que noir, annoncé par de discrètes bifurcations fantastiques (le Bubble Gum Gang, clan de gamins quasi-démoniaques, regards torves de personnages aux louches intentions, demoiselles possédées comme dans Les femmes de Stepford…). Le dernier tiers verse littéralement dans les délices du gore et du Grand Guignol au point de créer la saturation même chez les aficionados du genre. Sa combinaison est très efficace, même si, en substance, Roth n'invente rien. A quelques exceptions près, Roth ne se départit pas de son humour gaguesque (la scène de la voiture qui repasse sur les corps). Les influences de Roth ont le mérite d’être denses (l’asiatique quasi-fantomatique avec son œil en moins est une allusion aux films de fantômes japonais qu'il a récemment découvert, de même que la traque finale entre la victime et le bourreau évoque inévitablement Marathon Man de John Schlesinger…). Mais elles fonctionnent à double tranchant : le défaut du film naît du manque de personnalité, voire du manque d'âme. Plus roublard que talentueux, plus décomplexé qu’industrieux, Eli Roth profite de ses parrains pour essayer de se différencier du tout-venant alors qu’en fin de compte, il ne révolutionne pas grand-chose. Au gré de ses bobines, le cinéaste assène ses simples objectifs : distraire le spectateur pour qu’il mette ses neurones en stand-by et le faire grincer des dents. Heureusement, cette fois-ci, Roth n’affiche aucun cynisme ou prétention poseuse, ne carbure qu’au premier degré et organise quelques séquences potentiellement impressionnantes dont une qui exploite à bon escient et sans parcimonie les vertus de la tronçonneuse (l’affiche du film qui parodiait celle de Maniac n’était pas trompeuse). La plupart des scènes sulfureuses sont judicieusement placées à la fin pour distiller la gradation horrifique et donnent à voir une sorte de compilation non-stop des pires trouvailles de tortures (talon d’Achille brisé, dépeçage gratiné, énucléation…). Là-dessus, le jeune Roth ne manque point d’imagination (à l’origine, il voulait que le film se termine sur la torture d’une gamine de cinq ans – ce que Murder Set Pieces, de Nick Palumbo, a quasiment osé faire) et atteint mine de rien une sorte de paroxysme dans un genre qui tend à être de plus en plus policé. A l'heure où les lois du consensus mou et du politiquement correct frappent de plein fouet le cinéma US, il va certainement être difficile de faire plus poisseux et malsain. Si on peine à déceler sous l’apparente désinvolture du réal son âme d’artiste - ou même de l'artisan, Eli Roth démontre un certain savoir-faire dans la gestion des effets illustratifs. Avec Hostel, il confirme qu’il tient plus du petit malin que du grand cinéaste. Ce contrepoint accessoire n'entâche qu'en partie la puissance de cette fiction futée et énergique, particulièrement sanguinolente (une sorte d'exploit ?), qui a de quoi remplir les estomacs les plus (a)vides. Mais il vaut mieux prévenir à l’avance : certaines scènes sont si tordues et tripales qu’il serait presque préférable de venir avec son sac à vomi. Oui, à ce point-là. Comme on dit, pour se rassurer, heureusement que tout ce mauvais goût n’est que pour de rire"


