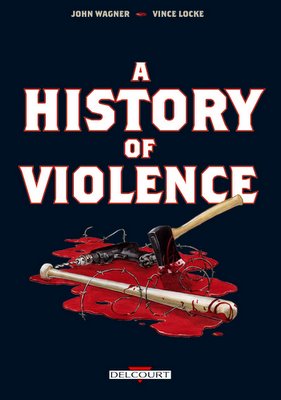
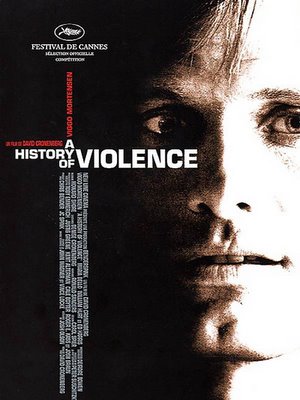
Sortons ce ridicule sticker " la B.D du film" : Bouquin pas mal même si j'accroche pas du tout au dessin. Film de la B.D assez réussi même si j'accroche pas du tout à Mortensen. "Au cours d’un braquage, Tom Stall abat deux malfrats qui menaçaient la vie d'employés et de clients de son restaurant. Il est acclamé en héros par les habitants de sa petite ville et son aventure s’étale à la une des médias. Alors qu’il essaie de retrouver une vie normale, un certain Carl Fogarty débarque, convaincu d’avoir reconnu en Tom celui avec qui il a eu autrefois de violents démêlés. Tom a beau nier, Fogarty et ses hommes le traquent et menacent sa famille…David Cronenberg fait la révolution par l’épure dans sa mise en scène. "A History of Violence suit un schéma simple mais efficace, une intrigue linéaire. L’apparente tranquillité de l’ "American Way of Life", comme le dit ironiquement le mafieux joué par Ed Harris, se trouble seulement lors de scènes d’ultra-violence. Le contraste qui est ainsi provoqué a deux conséquences, elles aussi très contradictoires. Au choc et à l’effroi devant les chairs déchirées et sanguinolentes s’ajoute souvent un rire qui protège cette réalité grotesque de la mort. Cronenberg joue beaucoup sur cette ironie cruelle pour donner du jeu, de la distance mais aussi un certain degré de réflexion au film. La violence dont parle le titre entraîne de multiples conséquences inattendues dans la vie de cette famille parfaite. Elle remplace l’insouciance par la peur et la paranoïa. Elle suscite la haine et la colère là où il y avait un amour inconditionnel. Le cinéaste va plus loin en montrant que cette même violence peut susciter l’admiration et la gloire quand elle est utilisée pour le "bien" d’une communauté et aussi engendrer un désir sexuel irrépressible. Avant l’attaque du restaurant, la sexualité de Tom et Edie est tranquille et tendre, la subversion se limitant à une tenue de cheerleader et à un 69 passionné. Ils dérivent ensuite vers une attraction plus brutale mêlée de haine et de sentiments excessifs. Les concepts de Cronenberg n’ont rien perdu de leur férocité, même s’ils suintaient d’une façon plus maniérée et plus complexe dans ses derniers films. Une tranquille petite famille américaine peut devenir féroce devant le danger. Cette même famille peut tuer des hommes qui la menacent de l’extérieur tout comme de l’intérieur. A l’instar de la pratique de la bicyclette, un homme n’oublie jamais comment frapper et tuer. L’instinct de violence s’avère parfois être purement génétique. "A History of Violence" fascine aussi par ses acteurs totalement charismatiques tels Ed Harris et William Hurt et par le magnétique Viggo Mortensen. Les émotions les plus brutales passent sur son visage de doux chef de famille comme des nuages inquiétants, ravageurs, venus dont ne sait quelle pulsion enfouie. La petite ferme construite aux alentours d’une charmante bourgade, son shérif honnête et perspicace qui veut maintenir le calme de sa communauté de "gens biens", son petit resto plein d’habitués sympas collés devant leur "donut", ce paysage à l’ "americana" est perturbé par l’arrivée de méchants flegmatiques à la technique meurtrière redoutable. Ces éléments archétypaux donnent au film un petit air de déjà-vu, de bon vieux western ou de polar à l’ancienne façon John Sturges. « A History of Violence » n’en demeure pas moins un film à part, une singularité qui ne dépare pas dans l’œuvre noire du maître Cronenberg. Dès son premier plan, A History of Violence est une promesse de fiction. Une fiction intégrée, réalisée dans le réel. Superbe plan séquence qui, dans un motel, impose dès ses premières images l’espace du film comme second rôle. Le motel américain (et peu importe que ce soit celui vu dans eXisTenZ, près de Toronto), comme non-lieu d’où la désintégration de l’humain dans le capital se réalise, c’est aussi la possibilité d’une fiction, un espace investi par l’imaginaire, la mythologie américaine, un royaume de signes et d’hypothèses. Pour Cronenberg, cette ouverture dans le motel place immédiatement le film dans un rapport qu’il ne cessera de déplier, celui d’un engendrement, d’une contamination entre le réel et la fiction, jusqu’à l’indistinction, la non séparation. Après l’ivresse de ce premier plan dont la rupture laisse planer une menace encore indistincte, une menace presque théorique et à la fois en parfaite symbiose avec le rôle du motel (anonymat du lieu, anonymat des tueurs, violence gratuite et dénuée de sens, de réponse à quelque chose, déshumanisation générale), Cronenberg enchaîne longuement sur la seconde mise en place topographique et mythologique du film. Lente découverte de Tom Stall (Viggo Mortensen) et de sa petite famille, lui tient un diner, son fils joue au base-ball dans l’équipe du lycée, sa femme joue les pom-pom girls pour réaliser un fantasme. Parfait vernis, couche d’une réalité presque hyper codée, multiplication de jeu sur les signes dans le décor, enseignes, objets, paysages du Midwest, intérieurs, tout entre en parfaite adéquation avec l’imaginaire collectif d’une Amérique profonde et moyenne, paisible. Dans cette petite ville vivent des gens bien dira le shérif, air connu du western (dont le film est une variation). Le passage du motel à la vie de Tom Stall crée la seconde strate du récit, qui ne cessera de jouer sur ce procédé de cassure. Menace surgie au coeur de l’American dream Ce long passage qui nous installe avec une volonté de précision et de détail dans la réalité de Tom Stall, homme banal, crée un sentiment de sécurité qui ne cesse pourtant d’être contrarié par la première bulle fictionnelle, la scène du motel. A un espace en creux, déshumanisé, Cronenberg confronte un espace habité. La rencontre de l’abstraction (les tueurs semblant errer sans but, tuer pour tuer) et du réel (la ville, la vie cohérente de Tom Stall), constitue le second basculement du film et la deuxième irruption de violence encore difficile à assigner. Lorsque les tueurs débarquent dans le diner de Tom, et que celui-ci les élimine avec une dextérité incroyable, le film brise toute présupposition du récit, la menace abstraite et théorique plonge dans la tangible réalité de Tom Stall, elle fait irruption dans l’American dream. Commence alors l’une des passions favorites du cinéma de Cronenberg, contenue déjà dans toute cette première partie, celle de faire cohabiter des réalités multiples. Là où eXisTenZ appuyait sommairement sur l’indistinction entre réel et virtuel, A History of Violence propose une vision beaucoup plus subtile et troublante. Ici les réalités ne sont plus repérables, elles sont fragmentées dans un corps ou des espaces en apparence homogènes, elles coexistent. La réalité contient la fiction ; et l’image, le jeu sur les signes, montrent comment la mythologie n’est pas une chose abstraite mais concrète. Là où A History of Violence s’en tire aussi plus subtilement que Spider, c’est dans cette possibilité qu’un être en habite un autre. Tom Stall ne se révèle jamais comme Matt Damon dans The Bourne Identity, le geste ne précède jamais la pensée ni ne re-dévoile l’individu à lui-même ou son passé. Le passé est contenu dans le présent, tout juste est-il actualisé. Joey Cusack (sa véritable identité) vit toujours en lui, rien ne pourrait faire reset de cette mémoire, mais il peut se scinder, cohabiter en paix avec son passé dès lors qu’il s’est marié et que l’espace du Midwest devient la promesse réelle d’une nouvelle fiction. La grande supposition de A History of Violence, pour peu que l’on mette entre parenthèses la problématique (importante) de la violence (et ses processus d’imitation, contamination...), c’est la possibilité de s’inventer un personnage. En posant l’idée de l’être comme personnage potentiel, dans un environnement qui par ce choix se transforme et devient donc une fiction réalisée, Cronenberg montre plusieurs choses. D’abord comment l’American dream n’est pas une simple idée, un idéal, mais qu’il correspond à une réalité concrète, à des lieux, des individus, donc qu’il est le rêve devenu réalité. Il a une couleur, des espaces, et tout ceci s’est justement créé par la puissance d’un désir absolu de réalisation d’un imaginaire. Le film travaille ensuite deux aspects de cette mythologie américaine : 1) la liberté possible de se refaire une vie ailleurs (possibilité d’un espace, mythe des frontières), de retrouver son anonymat ; 2) la famille. La famille est l’un des aspects fictionnels les plus forts du film. En travaillant la famille comme une entité assimilée, où tout ce qui la constitue crée un système de reconnaissance à la fois conforme au réel et un cliché, Cronenberg montre comment la famille de Tom s’est constituée, par son « mensonge », sur une fiction qui n’en est plus une puisque les régimes de distinction s’effondrent. Pourtant lorsque la vérité éclate avec la véritable identité de Tom, sa famille tombe sous un coup de réel si extraordinaire que celui-ci devient plus fictionnel que la fiction elle-même. Toute la famille et son idéal, donc à la fois sa projection, son image intégrée au monde vacillent, elle bascule dans une nouvelle réalité qu’il va falloir apprendre à vivre, mieux en laquelle il va falloir croire. C’est toute la puissance du plan final, d’une beauté et d’une simplicité rare. Tom, après être passé par la dernière bulle de fiction autonome du récit - à la rencontre de son frère vivant dans une réplique de château truffé de bodyguards patibulaires -, a cherché à protéger sa famille en éliminant le mal à sa source. A partir d’un subtil jeu de décalage, la scène est l’avant-dernière strate du récit et, pour y nous y mener, quelques ellipses nous font traverser l’Amérique en une nuit. A l’arrivée, une autre fiction, une autre modalité, un autre cinéma, presque de genre cette fois, mais sans ses codes, sans taxinomie, rien que des signes mous, fuyants. D’une réalité à l’autre Tom, Viggo Mortensen, passe, il est presque comme nous un spectateur. Faire corps d’une réalité (ou d’une fiction, il n’y a donc bien plus aucune différence) à l’autre devient non pas pour lui une manière de les faire tenir ensemble, mais la possibilité d’en sauver une seule, celle qu’il a choisie, sa famille. C’est là où s’insère enfin ce plan final qui fait d’un regard de quelques secondes entre Tom et Edie (Maria Bello), sa femme, le point de départ d’une nouvelle croyance. Ce bref échange installe la possibilité d’une nouvelle fiction, celle d’une famille réunie, malgré tout, parce que le pacte de croyance est le moteur de la réalité de ce monde.
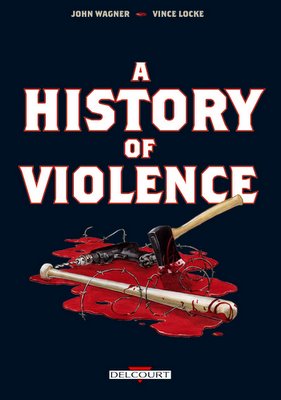
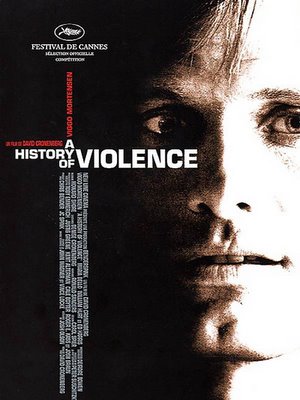 Sortons ce ridicule sticker " la B.D du film" : Bouquin pas mal même si j'accroche pas du tout au dessin. Film de la B.D assez réussi même si j'accroche pas du tout à Mortensen. "Au cours d’un braquage, Tom Stall abat deux malfrats qui menaçaient la vie d'employés et de clients de son restaurant. Il est acclamé en héros par les habitants de sa petite ville et son aventure s’étale à la une des médias. Alors qu’il essaie de retrouver une vie normale, un certain Carl Fogarty débarque, convaincu d’avoir reconnu en Tom celui avec qui il a eu autrefois de violents démêlés. Tom a beau nier, Fogarty et ses hommes le traquent et menacent sa famille…David Cronenberg fait la révolution par l’épure dans sa mise en scène. "A History of Violence suit un schéma simple mais efficace, une intrigue linéaire. L’apparente tranquillité de l’ "American Way of Life", comme le dit ironiquement le mafieux joué par Ed Harris, se trouble seulement lors de scènes d’ultra-violence. Le contraste qui est ainsi provoqué a deux conséquences, elles aussi très contradictoires. Au choc et à l’effroi devant les chairs déchirées et sanguinolentes s’ajoute souvent un rire qui protège cette réalité grotesque de la mort. Cronenberg joue beaucoup sur cette ironie cruelle pour donner du jeu, de la distance mais aussi un certain degré de réflexion au film. La violence dont parle le titre entraîne de multiples conséquences inattendues dans la vie de cette famille parfaite. Elle remplace l’insouciance par la peur et la paranoïa. Elle suscite la haine et la colère là où il y avait un amour inconditionnel. Le cinéaste va plus loin en montrant que cette même violence peut susciter l’admiration et la gloire quand elle est utilisée pour le "bien" d’une communauté et aussi engendrer un désir sexuel irrépressible. Avant l’attaque du restaurant, la sexualité de Tom et Edie est tranquille et tendre, la subversion se limitant à une tenue de cheerleader et à un 69 passionné. Ils dérivent ensuite vers une attraction plus brutale mêlée de haine et de sentiments excessifs. Les concepts de Cronenberg n’ont rien perdu de leur férocité, même s’ils suintaient d’une façon plus maniérée et plus complexe dans ses derniers films. Une tranquille petite famille américaine peut devenir féroce devant le danger. Cette même famille peut tuer des hommes qui la menacent de l’extérieur tout comme de l’intérieur. A l’instar de la pratique de la bicyclette, un homme n’oublie jamais comment frapper et tuer. L’instinct de violence s’avère parfois être purement génétique. "A History of Violence" fascine aussi par ses acteurs totalement charismatiques tels Ed Harris et William Hurt et par le magnétique Viggo Mortensen. Les émotions les plus brutales passent sur son visage de doux chef de famille comme des nuages inquiétants, ravageurs, venus dont ne sait quelle pulsion enfouie. La petite ferme construite aux alentours d’une charmante bourgade, son shérif honnête et perspicace qui veut maintenir le calme de sa communauté de "gens biens", son petit resto plein d’habitués sympas collés devant leur "donut", ce paysage à l’ "americana" est perturbé par l’arrivée de méchants flegmatiques à la technique meurtrière redoutable. Ces éléments archétypaux donnent au film un petit air de déjà-vu, de bon vieux western ou de polar à l’ancienne façon John Sturges. « A History of Violence » n’en demeure pas moins un film à part, une singularité qui ne dépare pas dans l’œuvre noire du maître Cronenberg. Dès son premier plan, A History of Violence est une promesse de fiction. Une fiction intégrée, réalisée dans le réel. Superbe plan séquence qui, dans un motel, impose dès ses premières images l’espace du film comme second rôle. Le motel américain (et peu importe que ce soit celui vu dans eXisTenZ, près de Toronto), comme non-lieu d’où la désintégration de l’humain dans le capital se réalise, c’est aussi la possibilité d’une fiction, un espace investi par l’imaginaire, la mythologie américaine, un royaume de signes et d’hypothèses. Pour Cronenberg, cette ouverture dans le motel place immédiatement le film dans un rapport qu’il ne cessera de déplier, celui d’un engendrement, d’une contamination entre le réel et la fiction, jusqu’à l’indistinction, la non séparation. Après l’ivresse de ce premier plan dont la rupture laisse planer une menace encore indistincte, une menace presque théorique et à la fois en parfaite symbiose avec le rôle du motel (anonymat du lieu, anonymat des tueurs, violence gratuite et dénuée de sens, de réponse à quelque chose, déshumanisation générale), Cronenberg enchaîne longuement sur la seconde mise en place topographique et mythologique du film. Lente découverte de Tom Stall (Viggo Mortensen) et de sa petite famille, lui tient un diner, son fils joue au base-ball dans l’équipe du lycée, sa femme joue les pom-pom girls pour réaliser un fantasme. Parfait vernis, couche d’une réalité presque hyper codée, multiplication de jeu sur les signes dans le décor, enseignes, objets, paysages du Midwest, intérieurs, tout entre en parfaite adéquation avec l’imaginaire collectif d’une Amérique profonde et moyenne, paisible. Dans cette petite ville vivent des gens bien dira le shérif, air connu du western (dont le film est une variation). Le passage du motel à la vie de Tom Stall crée la seconde strate du récit, qui ne cessera de jouer sur ce procédé de cassure. Menace surgie au coeur de l’American dream Ce long passage qui nous installe avec une volonté de précision et de détail dans la réalité de Tom Stall, homme banal, crée un sentiment de sécurité qui ne cesse pourtant d’être contrarié par la première bulle fictionnelle, la scène du motel. A un espace en creux, déshumanisé, Cronenberg confronte un espace habité. La rencontre de l’abstraction (les tueurs semblant errer sans but, tuer pour tuer) et du réel (la ville, la vie cohérente de Tom Stall), constitue le second basculement du film et la deuxième irruption de violence encore difficile à assigner. Lorsque les tueurs débarquent dans le diner de Tom, et que celui-ci les élimine avec une dextérité incroyable, le film brise toute présupposition du récit, la menace abstraite et théorique plonge dans la tangible réalité de Tom Stall, elle fait irruption dans l’American dream. Commence alors l’une des passions favorites du cinéma de Cronenberg, contenue déjà dans toute cette première partie, celle de faire cohabiter des réalités multiples. Là où eXisTenZ appuyait sommairement sur l’indistinction entre réel et virtuel, A History of Violence propose une vision beaucoup plus subtile et troublante. Ici les réalités ne sont plus repérables, elles sont fragmentées dans un corps ou des espaces en apparence homogènes, elles coexistent. La réalité contient la fiction ; et l’image, le jeu sur les signes, montrent comment la mythologie n’est pas une chose abstraite mais concrète. Là où A History of Violence s’en tire aussi plus subtilement que Spider, c’est dans cette possibilité qu’un être en habite un autre. Tom Stall ne se révèle jamais comme Matt Damon dans The Bourne Identity, le geste ne précède jamais la pensée ni ne re-dévoile l’individu à lui-même ou son passé. Le passé est contenu dans le présent, tout juste est-il actualisé. Joey Cusack (sa véritable identité) vit toujours en lui, rien ne pourrait faire reset de cette mémoire, mais il peut se scinder, cohabiter en paix avec son passé dès lors qu’il s’est marié et que l’espace du Midwest devient la promesse réelle d’une nouvelle fiction. La grande supposition de A History of Violence, pour peu que l’on mette entre parenthèses la problématique (importante) de la violence (et ses processus d’imitation, contamination...), c’est la possibilité de s’inventer un personnage. En posant l’idée de l’être comme personnage potentiel, dans un environnement qui par ce choix se transforme et devient donc une fiction réalisée, Cronenberg montre plusieurs choses. D’abord comment l’American dream n’est pas une simple idée, un idéal, mais qu’il correspond à une réalité concrète, à des lieux, des individus, donc qu’il est le rêve devenu réalité. Il a une couleur, des espaces, et tout ceci s’est justement créé par la puissance d’un désir absolu de réalisation d’un imaginaire. Le film travaille ensuite deux aspects de cette mythologie américaine : 1) la liberté possible de se refaire une vie ailleurs (possibilité d’un espace, mythe des frontières), de retrouver son anonymat ; 2) la famille. La famille est l’un des aspects fictionnels les plus forts du film. En travaillant la famille comme une entité assimilée, où tout ce qui la constitue crée un système de reconnaissance à la fois conforme au réel et un cliché, Cronenberg montre comment la famille de Tom s’est constituée, par son « mensonge », sur une fiction qui n’en est plus une puisque les régimes de distinction s’effondrent. Pourtant lorsque la vérité éclate avec la véritable identité de Tom, sa famille tombe sous un coup de réel si extraordinaire que celui-ci devient plus fictionnel que la fiction elle-même. Toute la famille et son idéal, donc à la fois sa projection, son image intégrée au monde vacillent, elle bascule dans une nouvelle réalité qu’il va falloir apprendre à vivre, mieux en laquelle il va falloir croire. C’est toute la puissance du plan final, d’une beauté et d’une simplicité rare. Tom, après être passé par la dernière bulle de fiction autonome du récit - à la rencontre de son frère vivant dans une réplique de château truffé de bodyguards patibulaires -, a cherché à protéger sa famille en éliminant le mal à sa source. A partir d’un subtil jeu de décalage, la scène est l’avant-dernière strate du récit et, pour y nous y mener, quelques ellipses nous font traverser l’Amérique en une nuit. A l’arrivée, une autre fiction, une autre modalité, un autre cinéma, presque de genre cette fois, mais sans ses codes, sans taxinomie, rien que des signes mous, fuyants. D’une réalité à l’autre Tom, Viggo Mortensen, passe, il est presque comme nous un spectateur. Faire corps d’une réalité (ou d’une fiction, il n’y a donc bien plus aucune différence) à l’autre devient non pas pour lui une manière de les faire tenir ensemble, mais la possibilité d’en sauver une seule, celle qu’il a choisie, sa famille. C’est là où s’insère enfin ce plan final qui fait d’un regard de quelques secondes entre Tom et Edie (Maria Bello), sa femme, le point de départ d’une nouvelle croyance. Ce bref échange installe la possibilité d’une nouvelle fiction, celle d’une famille réunie, malgré tout, parce que le pacte de croyance est le moteur de la réalité de ce monde.
Sortons ce ridicule sticker " la B.D du film" : Bouquin pas mal même si j'accroche pas du tout au dessin. Film de la B.D assez réussi même si j'accroche pas du tout à Mortensen. "Au cours d’un braquage, Tom Stall abat deux malfrats qui menaçaient la vie d'employés et de clients de son restaurant. Il est acclamé en héros par les habitants de sa petite ville et son aventure s’étale à la une des médias. Alors qu’il essaie de retrouver une vie normale, un certain Carl Fogarty débarque, convaincu d’avoir reconnu en Tom celui avec qui il a eu autrefois de violents démêlés. Tom a beau nier, Fogarty et ses hommes le traquent et menacent sa famille…David Cronenberg fait la révolution par l’épure dans sa mise en scène. "A History of Violence suit un schéma simple mais efficace, une intrigue linéaire. L’apparente tranquillité de l’ "American Way of Life", comme le dit ironiquement le mafieux joué par Ed Harris, se trouble seulement lors de scènes d’ultra-violence. Le contraste qui est ainsi provoqué a deux conséquences, elles aussi très contradictoires. Au choc et à l’effroi devant les chairs déchirées et sanguinolentes s’ajoute souvent un rire qui protège cette réalité grotesque de la mort. Cronenberg joue beaucoup sur cette ironie cruelle pour donner du jeu, de la distance mais aussi un certain degré de réflexion au film. La violence dont parle le titre entraîne de multiples conséquences inattendues dans la vie de cette famille parfaite. Elle remplace l’insouciance par la peur et la paranoïa. Elle suscite la haine et la colère là où il y avait un amour inconditionnel. Le cinéaste va plus loin en montrant que cette même violence peut susciter l’admiration et la gloire quand elle est utilisée pour le "bien" d’une communauté et aussi engendrer un désir sexuel irrépressible. Avant l’attaque du restaurant, la sexualité de Tom et Edie est tranquille et tendre, la subversion se limitant à une tenue de cheerleader et à un 69 passionné. Ils dérivent ensuite vers une attraction plus brutale mêlée de haine et de sentiments excessifs. Les concepts de Cronenberg n’ont rien perdu de leur férocité, même s’ils suintaient d’une façon plus maniérée et plus complexe dans ses derniers films. Une tranquille petite famille américaine peut devenir féroce devant le danger. Cette même famille peut tuer des hommes qui la menacent de l’extérieur tout comme de l’intérieur. A l’instar de la pratique de la bicyclette, un homme n’oublie jamais comment frapper et tuer. L’instinct de violence s’avère parfois être purement génétique. "A History of Violence" fascine aussi par ses acteurs totalement charismatiques tels Ed Harris et William Hurt et par le magnétique Viggo Mortensen. Les émotions les plus brutales passent sur son visage de doux chef de famille comme des nuages inquiétants, ravageurs, venus dont ne sait quelle pulsion enfouie. La petite ferme construite aux alentours d’une charmante bourgade, son shérif honnête et perspicace qui veut maintenir le calme de sa communauté de "gens biens", son petit resto plein d’habitués sympas collés devant leur "donut", ce paysage à l’ "americana" est perturbé par l’arrivée de méchants flegmatiques à la technique meurtrière redoutable. Ces éléments archétypaux donnent au film un petit air de déjà-vu, de bon vieux western ou de polar à l’ancienne façon John Sturges. « A History of Violence » n’en demeure pas moins un film à part, une singularité qui ne dépare pas dans l’œuvre noire du maître Cronenberg. Dès son premier plan, A History of Violence est une promesse de fiction. Une fiction intégrée, réalisée dans le réel. Superbe plan séquence qui, dans un motel, impose dès ses premières images l’espace du film comme second rôle. Le motel américain (et peu importe que ce soit celui vu dans eXisTenZ, près de Toronto), comme non-lieu d’où la désintégration de l’humain dans le capital se réalise, c’est aussi la possibilité d’une fiction, un espace investi par l’imaginaire, la mythologie américaine, un royaume de signes et d’hypothèses. Pour Cronenberg, cette ouverture dans le motel place immédiatement le film dans un rapport qu’il ne cessera de déplier, celui d’un engendrement, d’une contamination entre le réel et la fiction, jusqu’à l’indistinction, la non séparation. Après l’ivresse de ce premier plan dont la rupture laisse planer une menace encore indistincte, une menace presque théorique et à la fois en parfaite symbiose avec le rôle du motel (anonymat du lieu, anonymat des tueurs, violence gratuite et dénuée de sens, de réponse à quelque chose, déshumanisation générale), Cronenberg enchaîne longuement sur la seconde mise en place topographique et mythologique du film. Lente découverte de Tom Stall (Viggo Mortensen) et de sa petite famille, lui tient un diner, son fils joue au base-ball dans l’équipe du lycée, sa femme joue les pom-pom girls pour réaliser un fantasme. Parfait vernis, couche d’une réalité presque hyper codée, multiplication de jeu sur les signes dans le décor, enseignes, objets, paysages du Midwest, intérieurs, tout entre en parfaite adéquation avec l’imaginaire collectif d’une Amérique profonde et moyenne, paisible. Dans cette petite ville vivent des gens bien dira le shérif, air connu du western (dont le film est une variation). Le passage du motel à la vie de Tom Stall crée la seconde strate du récit, qui ne cessera de jouer sur ce procédé de cassure. Menace surgie au coeur de l’American dream Ce long passage qui nous installe avec une volonté de précision et de détail dans la réalité de Tom Stall, homme banal, crée un sentiment de sécurité qui ne cesse pourtant d’être contrarié par la première bulle fictionnelle, la scène du motel. A un espace en creux, déshumanisé, Cronenberg confronte un espace habité. La rencontre de l’abstraction (les tueurs semblant errer sans but, tuer pour tuer) et du réel (la ville, la vie cohérente de Tom Stall), constitue le second basculement du film et la deuxième irruption de violence encore difficile à assigner. Lorsque les tueurs débarquent dans le diner de Tom, et que celui-ci les élimine avec une dextérité incroyable, le film brise toute présupposition du récit, la menace abstraite et théorique plonge dans la tangible réalité de Tom Stall, elle fait irruption dans l’American dream. Commence alors l’une des passions favorites du cinéma de Cronenberg, contenue déjà dans toute cette première partie, celle de faire cohabiter des réalités multiples. Là où eXisTenZ appuyait sommairement sur l’indistinction entre réel et virtuel, A History of Violence propose une vision beaucoup plus subtile et troublante. Ici les réalités ne sont plus repérables, elles sont fragmentées dans un corps ou des espaces en apparence homogènes, elles coexistent. La réalité contient la fiction ; et l’image, le jeu sur les signes, montrent comment la mythologie n’est pas une chose abstraite mais concrète. Là où A History of Violence s’en tire aussi plus subtilement que Spider, c’est dans cette possibilité qu’un être en habite un autre. Tom Stall ne se révèle jamais comme Matt Damon dans The Bourne Identity, le geste ne précède jamais la pensée ni ne re-dévoile l’individu à lui-même ou son passé. Le passé est contenu dans le présent, tout juste est-il actualisé. Joey Cusack (sa véritable identité) vit toujours en lui, rien ne pourrait faire reset de cette mémoire, mais il peut se scinder, cohabiter en paix avec son passé dès lors qu’il s’est marié et que l’espace du Midwest devient la promesse réelle d’une nouvelle fiction. La grande supposition de A History of Violence, pour peu que l’on mette entre parenthèses la problématique (importante) de la violence (et ses processus d’imitation, contamination...), c’est la possibilité de s’inventer un personnage. En posant l’idée de l’être comme personnage potentiel, dans un environnement qui par ce choix se transforme et devient donc une fiction réalisée, Cronenberg montre plusieurs choses. D’abord comment l’American dream n’est pas une simple idée, un idéal, mais qu’il correspond à une réalité concrète, à des lieux, des individus, donc qu’il est le rêve devenu réalité. Il a une couleur, des espaces, et tout ceci s’est justement créé par la puissance d’un désir absolu de réalisation d’un imaginaire. Le film travaille ensuite deux aspects de cette mythologie américaine : 1) la liberté possible de se refaire une vie ailleurs (possibilité d’un espace, mythe des frontières), de retrouver son anonymat ; 2) la famille. La famille est l’un des aspects fictionnels les plus forts du film. En travaillant la famille comme une entité assimilée, où tout ce qui la constitue crée un système de reconnaissance à la fois conforme au réel et un cliché, Cronenberg montre comment la famille de Tom s’est constituée, par son « mensonge », sur une fiction qui n’en est plus une puisque les régimes de distinction s’effondrent. Pourtant lorsque la vérité éclate avec la véritable identité de Tom, sa famille tombe sous un coup de réel si extraordinaire que celui-ci devient plus fictionnel que la fiction elle-même. Toute la famille et son idéal, donc à la fois sa projection, son image intégrée au monde vacillent, elle bascule dans une nouvelle réalité qu’il va falloir apprendre à vivre, mieux en laquelle il va falloir croire. C’est toute la puissance du plan final, d’une beauté et d’une simplicité rare. Tom, après être passé par la dernière bulle de fiction autonome du récit - à la rencontre de son frère vivant dans une réplique de château truffé de bodyguards patibulaires -, a cherché à protéger sa famille en éliminant le mal à sa source. A partir d’un subtil jeu de décalage, la scène est l’avant-dernière strate du récit et, pour y nous y mener, quelques ellipses nous font traverser l’Amérique en une nuit. A l’arrivée, une autre fiction, une autre modalité, un autre cinéma, presque de genre cette fois, mais sans ses codes, sans taxinomie, rien que des signes mous, fuyants. D’une réalité à l’autre Tom, Viggo Mortensen, passe, il est presque comme nous un spectateur. Faire corps d’une réalité (ou d’une fiction, il n’y a donc bien plus aucune différence) à l’autre devient non pas pour lui une manière de les faire tenir ensemble, mais la possibilité d’en sauver une seule, celle qu’il a choisie, sa famille. C’est là où s’insère enfin ce plan final qui fait d’un regard de quelques secondes entre Tom et Edie (Maria Bello), sa femme, le point de départ d’une nouvelle croyance. Ce bref échange installe la possibilité d’une nouvelle fiction, celle d’une famille réunie, malgré tout, parce que le pacte de croyance est le moteur de la réalité de ce monde. 
