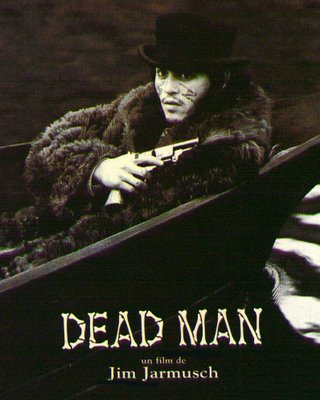
Revu ce film. Formidable Jarmush, Incroyable OST de N.Young. "Originaire de Cleveland, William Blake postule pour une place de comptable à Machine Town. Dans le train qui le mène à la scierie Dickinson, un inconnu le met en garde. Ce n’est pas la fortune qu’il l’attend là-bas, mais la Mort en personne. Le premier soir, Blake est blessé par balle pour un funeste quiproquo. C’est le début d’une longue errance, guidée par Nobody l’Indien philosophe. Un voyage circulaire sans queue ni tête, à la fois opaque et étrangement charnel. Un voyage mystique et intense, à rebours des conventions du western, tournant le dos à un héroïsme sécurisant. Désarticulée, l’odyssée de William "Bill" Blake ne donne jamais l’impression d’aboutir. Le comptable ignorant de Cleveland est d’entrée un personnage inexistant, terrassé par de grands méchants loups aux cœurs vérolés. Les maux et les imbroglios s’enchevêtrent; Dead Man réverbère un maelström d’hallucinations et d’effets secondaires. Les violentes chasses à l’homme broient les icônes et réduisent au silence les prières inquiètes. Les desseins contraires se cognent les uns aux autres. Au cœur de la tourmente, un guide satisfait fredonne les vers d’un prophète. William Blake survit. Mais pour combien de temps? Son identité est double (fonctionnaire esquinté ou poète des armes à feu?), sa vision embuée (les lunettes disparaissent). Son cerveau assailli par le doute résiste à l’envie irrépressible d’abandonner la terre ferme… L’élévation spirituelle de Blake rime avec un authentique crescendo formel, des rails horizontaux de la locomotive aux troncs d’arbre séculaires. C’est toute l’Amérique, brutale et impulsive, qu’observe Jim Jarmusch dans une fable sur l’effondrement, un retour à une campagne primitive, où se cramponne une poignée de brigands. Machine Town, désigné comme la succursale de l’enfer, célèbre une ère industrielle rongée par le vice. L’artère principale qui s’ouvre devant William Blake fait souffler un vent de panique. Petit prince immaculé, engoncé dans un costume trop raide, l’étranger prend vite conscience de sa vanité. Son corps est aussi frêle qu’un faon mort couché sur l’herbe. Sa tête plus friable qu’un crâne de squelette. William Blake l’employé modèle devient pourtant William Blake le poète sanguinaire. Ironie du hasard, c’est un Indien caractériel, éduqué par un Européen et surnommé Nobody ("personne"), qui le rebaptise pour son dernier voyage. Complice de longue date auquel Jarmusch s’identifie sans mal, Johnny Depp réussit à palper l’inconsistance de Blake, en lui inoculant des touches tragiques d’une extraordinaire finesse. Le couple formé avec Nobody, tiraillé entre deux sociétés et condamné à l’errance, accentue la singularité de la randonnée. Rejetés par les leurs, les vaincus s’entraident, se disputent, et s’entendent tacitement sur une destinée toute tracée. Persuadé d’avoir affaire au véritable William Blake, le guide se sent investi d’une mission: escorter Bill jusqu’au "miroir", là où se touchent le ciel et la terre. Nobody réécrit avidement de l’histoire du comptable. Or Dead Man est précisément un film sans histoire, sans bravoure, sans vengeance ni morale. Jim Jarmusch retourne l’Ouest américain, comme il tâte les entrailles d’un cadavre. Le mythe de la renaissance est éclipsé par une agonie existentielle. Nobody ne guérit pas son patient, il ne peut que transporter sa dépouille de l’autre côté de la rive. Le profil même de l’Indien, bon vivant potelé, ne correspond pas aux stéréotypes de l’athlète introverti. Anti-héros flasque et transparent, Blake titube d’un cheval à un canoë. Les trois tueurs dépêchés par Dickinson disparaissent aussi rapidement qu’ils sont apparus, sans ménagement. Jim Jarmusch s’intéresse moins au western (dont il maltraite la belle dialectique), qu’aux fondations d’une culture véhémente. William Blake et Nobody piétinent un pays où prospèrent les armes à feu (Thel Russell le justifie par un laconique: "on est en Amérique"). Les trappeurs tirent sur les bisons comme ils s’exerceraient aux fléchettes, les rôdeurs dégainent leurs jouets métalliques pour ruiner toute diplomatie. La civilisation des Dickinson, Cole Wilson et autres Johnny Pickett, excelle dans l’infamie et se distingue par une absence notoire de civilité. Aride et gangrenée, l’amour est une impasse. Bill se laisse séduire par une ex-prostituée, la malheureuse dulcinée de Charlie Dickinson. Quand ce dernier les surprend, Blake s’enfuit tout penaud en grenouillère, en laissant deux macchabées dans son sillage. A peine caressé l’espoir d’une vie aisée, le pantin disloqué de Dead Man s’enfonce dans l’abîme. L’anarchie supplante la raison, les semblants d’intrigues se rétractent, les pieds nickelés balaient furieusement les cendres récalcitrantes. Affublé d’une coiffe et d’une robe défraîchies, Iggy Pop fait une apparition cocasse en sauvageon insolite. Jarmusch réunit deux tueurs et deux marshals aux patronymes malicieux : Wilson et Pickett, Lee et Marvin. Dead Man oscille entre un humour désespéré et un pragmatisme résigné. Les légions dispersées sont incapables d’entretenir la moindre conversation. La folie galopante est la seule réponse envisageable à un monde fossilisé. Apaisé par des rites surnaturels, Blake entrevoit un royaume secret. "Je vois les poètes comme des visionnaires hors-la-loi", confie Jim Jarmusch (The Guardian, novembre 1999). Imitant ses précédentes dérives narratives, le cinéaste isole les silhouettes, réitère les incidents, sculpte ses gravures comme il accorderait des instruments. La séquence d’ouverture épouse aussitôt les travellings latéraux de Mystery Train, signature récurrente de Jarmusch. Le passage du fleuve évoque l’échappée belle de Down by Law. Le noir et blanc, magnifié par Robby Müller, reste la texture fétiche. Mais Jarmusch va jusqu’au bout de sa logique déliquescente. Le corps ankylosé de Blake dicte la marche à suivre. Plus les kilomètres s’étirent, plus la pellicule semble s’effilocher. Pareils aux strophes d’un poème, la structure lâche et les fondus au noir matérialisent les évanouissements de Bill. Délaissant les corps putrides et les jeux d’osselets du générique, Dead Man met en lumière une autre héroïne : la musique, instinctive, lancinante, amplement majestueuse. Les improvisations de Neil Young respectent les silences et les entailles du montage. Face à la fuite du sens, le fractionnement du temps et l’éparpillement des rôles secondaires (Jim Jarmusch fait pour la première fois appel à une directrice de casting), les saturations d’une guitare traduisent avec justesse les écarts somnambules de William Blake, toujours plus insistants. L’horizon se dégage peu à peu. Les plans oppressants, au plus près des visages, s’estompent au profit des grands espaces. Nobody et Bill se laissent submerger par une nature ensorceleuse. Dead Man s’achève là où il a commencé: la nacelle en bois qui sert de sépulture est la parfaite antithèse du train, emblème du monde moderne. Délesté de tout balluchon, William Blake est prêt pour un nouveau voyage."
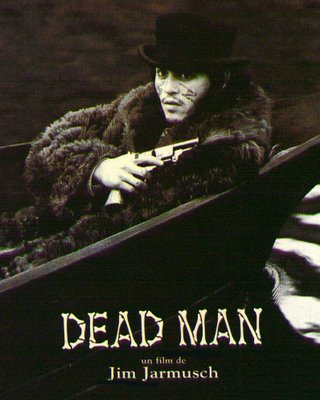 Revu ce film. Formidable Jarmush, Incroyable OST de N.Young. "Originaire de Cleveland, William Blake postule pour une place de comptable à Machine Town. Dans le train qui le mène à la scierie Dickinson, un inconnu le met en garde. Ce n’est pas la fortune qu’il l’attend là-bas, mais la Mort en personne. Le premier soir, Blake est blessé par balle pour un funeste quiproquo. C’est le début d’une longue errance, guidée par Nobody l’Indien philosophe. Un voyage circulaire sans queue ni tête, à la fois opaque et étrangement charnel. Un voyage mystique et intense, à rebours des conventions du western, tournant le dos à un héroïsme sécurisant. Désarticulée, l’odyssée de William "Bill" Blake ne donne jamais l’impression d’aboutir. Le comptable ignorant de Cleveland est d’entrée un personnage inexistant, terrassé par de grands méchants loups aux cœurs vérolés. Les maux et les imbroglios s’enchevêtrent; Dead Man réverbère un maelström d’hallucinations et d’effets secondaires. Les violentes chasses à l’homme broient les icônes et réduisent au silence les prières inquiètes. Les desseins contraires se cognent les uns aux autres. Au cœur de la tourmente, un guide satisfait fredonne les vers d’un prophète. William Blake survit. Mais pour combien de temps? Son identité est double (fonctionnaire esquinté ou poète des armes à feu?), sa vision embuée (les lunettes disparaissent). Son cerveau assailli par le doute résiste à l’envie irrépressible d’abandonner la terre ferme… L’élévation spirituelle de Blake rime avec un authentique crescendo formel, des rails horizontaux de la locomotive aux troncs d’arbre séculaires. C’est toute l’Amérique, brutale et impulsive, qu’observe Jim Jarmusch dans une fable sur l’effondrement, un retour à une campagne primitive, où se cramponne une poignée de brigands. Machine Town, désigné comme la succursale de l’enfer, célèbre une ère industrielle rongée par le vice. L’artère principale qui s’ouvre devant William Blake fait souffler un vent de panique. Petit prince immaculé, engoncé dans un costume trop raide, l’étranger prend vite conscience de sa vanité. Son corps est aussi frêle qu’un faon mort couché sur l’herbe. Sa tête plus friable qu’un crâne de squelette. William Blake l’employé modèle devient pourtant William Blake le poète sanguinaire. Ironie du hasard, c’est un Indien caractériel, éduqué par un Européen et surnommé Nobody ("personne"), qui le rebaptise pour son dernier voyage. Complice de longue date auquel Jarmusch s’identifie sans mal, Johnny Depp réussit à palper l’inconsistance de Blake, en lui inoculant des touches tragiques d’une extraordinaire finesse. Le couple formé avec Nobody, tiraillé entre deux sociétés et condamné à l’errance, accentue la singularité de la randonnée. Rejetés par les leurs, les vaincus s’entraident, se disputent, et s’entendent tacitement sur une destinée toute tracée. Persuadé d’avoir affaire au véritable William Blake, le guide se sent investi d’une mission: escorter Bill jusqu’au "miroir", là où se touchent le ciel et la terre. Nobody réécrit avidement de l’histoire du comptable. Or Dead Man est précisément un film sans histoire, sans bravoure, sans vengeance ni morale. Jim Jarmusch retourne l’Ouest américain, comme il tâte les entrailles d’un cadavre. Le mythe de la renaissance est éclipsé par une agonie existentielle. Nobody ne guérit pas son patient, il ne peut que transporter sa dépouille de l’autre côté de la rive. Le profil même de l’Indien, bon vivant potelé, ne correspond pas aux stéréotypes de l’athlète introverti. Anti-héros flasque et transparent, Blake titube d’un cheval à un canoë. Les trois tueurs dépêchés par Dickinson disparaissent aussi rapidement qu’ils sont apparus, sans ménagement. Jim Jarmusch s’intéresse moins au western (dont il maltraite la belle dialectique), qu’aux fondations d’une culture véhémente. William Blake et Nobody piétinent un pays où prospèrent les armes à feu (Thel Russell le justifie par un laconique: "on est en Amérique"). Les trappeurs tirent sur les bisons comme ils s’exerceraient aux fléchettes, les rôdeurs dégainent leurs jouets métalliques pour ruiner toute diplomatie. La civilisation des Dickinson, Cole Wilson et autres Johnny Pickett, excelle dans l’infamie et se distingue par une absence notoire de civilité. Aride et gangrenée, l’amour est une impasse. Bill se laisse séduire par une ex-prostituée, la malheureuse dulcinée de Charlie Dickinson. Quand ce dernier les surprend, Blake s’enfuit tout penaud en grenouillère, en laissant deux macchabées dans son sillage. A peine caressé l’espoir d’une vie aisée, le pantin disloqué de Dead Man s’enfonce dans l’abîme. L’anarchie supplante la raison, les semblants d’intrigues se rétractent, les pieds nickelés balaient furieusement les cendres récalcitrantes. Affublé d’une coiffe et d’une robe défraîchies, Iggy Pop fait une apparition cocasse en sauvageon insolite. Jarmusch réunit deux tueurs et deux marshals aux patronymes malicieux : Wilson et Pickett, Lee et Marvin. Dead Man oscille entre un humour désespéré et un pragmatisme résigné. Les légions dispersées sont incapables d’entretenir la moindre conversation. La folie galopante est la seule réponse envisageable à un monde fossilisé. Apaisé par des rites surnaturels, Blake entrevoit un royaume secret. "Je vois les poètes comme des visionnaires hors-la-loi", confie Jim Jarmusch (The Guardian, novembre 1999). Imitant ses précédentes dérives narratives, le cinéaste isole les silhouettes, réitère les incidents, sculpte ses gravures comme il accorderait des instruments. La séquence d’ouverture épouse aussitôt les travellings latéraux de Mystery Train, signature récurrente de Jarmusch. Le passage du fleuve évoque l’échappée belle de Down by Law. Le noir et blanc, magnifié par Robby Müller, reste la texture fétiche. Mais Jarmusch va jusqu’au bout de sa logique déliquescente. Le corps ankylosé de Blake dicte la marche à suivre. Plus les kilomètres s’étirent, plus la pellicule semble s’effilocher. Pareils aux strophes d’un poème, la structure lâche et les fondus au noir matérialisent les évanouissements de Bill. Délaissant les corps putrides et les jeux d’osselets du générique, Dead Man met en lumière une autre héroïne : la musique, instinctive, lancinante, amplement majestueuse. Les improvisations de Neil Young respectent les silences et les entailles du montage. Face à la fuite du sens, le fractionnement du temps et l’éparpillement des rôles secondaires (Jim Jarmusch fait pour la première fois appel à une directrice de casting), les saturations d’une guitare traduisent avec justesse les écarts somnambules de William Blake, toujours plus insistants. L’horizon se dégage peu à peu. Les plans oppressants, au plus près des visages, s’estompent au profit des grands espaces. Nobody et Bill se laissent submerger par une nature ensorceleuse. Dead Man s’achève là où il a commencé: la nacelle en bois qui sert de sépulture est la parfaite antithèse du train, emblème du monde moderne. Délesté de tout balluchon, William Blake est prêt pour un nouveau voyage."
Revu ce film. Formidable Jarmush, Incroyable OST de N.Young. "Originaire de Cleveland, William Blake postule pour une place de comptable à Machine Town. Dans le train qui le mène à la scierie Dickinson, un inconnu le met en garde. Ce n’est pas la fortune qu’il l’attend là-bas, mais la Mort en personne. Le premier soir, Blake est blessé par balle pour un funeste quiproquo. C’est le début d’une longue errance, guidée par Nobody l’Indien philosophe. Un voyage circulaire sans queue ni tête, à la fois opaque et étrangement charnel. Un voyage mystique et intense, à rebours des conventions du western, tournant le dos à un héroïsme sécurisant. Désarticulée, l’odyssée de William "Bill" Blake ne donne jamais l’impression d’aboutir. Le comptable ignorant de Cleveland est d’entrée un personnage inexistant, terrassé par de grands méchants loups aux cœurs vérolés. Les maux et les imbroglios s’enchevêtrent; Dead Man réverbère un maelström d’hallucinations et d’effets secondaires. Les violentes chasses à l’homme broient les icônes et réduisent au silence les prières inquiètes. Les desseins contraires se cognent les uns aux autres. Au cœur de la tourmente, un guide satisfait fredonne les vers d’un prophète. William Blake survit. Mais pour combien de temps? Son identité est double (fonctionnaire esquinté ou poète des armes à feu?), sa vision embuée (les lunettes disparaissent). Son cerveau assailli par le doute résiste à l’envie irrépressible d’abandonner la terre ferme… L’élévation spirituelle de Blake rime avec un authentique crescendo formel, des rails horizontaux de la locomotive aux troncs d’arbre séculaires. C’est toute l’Amérique, brutale et impulsive, qu’observe Jim Jarmusch dans une fable sur l’effondrement, un retour à une campagne primitive, où se cramponne une poignée de brigands. Machine Town, désigné comme la succursale de l’enfer, célèbre une ère industrielle rongée par le vice. L’artère principale qui s’ouvre devant William Blake fait souffler un vent de panique. Petit prince immaculé, engoncé dans un costume trop raide, l’étranger prend vite conscience de sa vanité. Son corps est aussi frêle qu’un faon mort couché sur l’herbe. Sa tête plus friable qu’un crâne de squelette. William Blake l’employé modèle devient pourtant William Blake le poète sanguinaire. Ironie du hasard, c’est un Indien caractériel, éduqué par un Européen et surnommé Nobody ("personne"), qui le rebaptise pour son dernier voyage. Complice de longue date auquel Jarmusch s’identifie sans mal, Johnny Depp réussit à palper l’inconsistance de Blake, en lui inoculant des touches tragiques d’une extraordinaire finesse. Le couple formé avec Nobody, tiraillé entre deux sociétés et condamné à l’errance, accentue la singularité de la randonnée. Rejetés par les leurs, les vaincus s’entraident, se disputent, et s’entendent tacitement sur une destinée toute tracée. Persuadé d’avoir affaire au véritable William Blake, le guide se sent investi d’une mission: escorter Bill jusqu’au "miroir", là où se touchent le ciel et la terre. Nobody réécrit avidement de l’histoire du comptable. Or Dead Man est précisément un film sans histoire, sans bravoure, sans vengeance ni morale. Jim Jarmusch retourne l’Ouest américain, comme il tâte les entrailles d’un cadavre. Le mythe de la renaissance est éclipsé par une agonie existentielle. Nobody ne guérit pas son patient, il ne peut que transporter sa dépouille de l’autre côté de la rive. Le profil même de l’Indien, bon vivant potelé, ne correspond pas aux stéréotypes de l’athlète introverti. Anti-héros flasque et transparent, Blake titube d’un cheval à un canoë. Les trois tueurs dépêchés par Dickinson disparaissent aussi rapidement qu’ils sont apparus, sans ménagement. Jim Jarmusch s’intéresse moins au western (dont il maltraite la belle dialectique), qu’aux fondations d’une culture véhémente. William Blake et Nobody piétinent un pays où prospèrent les armes à feu (Thel Russell le justifie par un laconique: "on est en Amérique"). Les trappeurs tirent sur les bisons comme ils s’exerceraient aux fléchettes, les rôdeurs dégainent leurs jouets métalliques pour ruiner toute diplomatie. La civilisation des Dickinson, Cole Wilson et autres Johnny Pickett, excelle dans l’infamie et se distingue par une absence notoire de civilité. Aride et gangrenée, l’amour est une impasse. Bill se laisse séduire par une ex-prostituée, la malheureuse dulcinée de Charlie Dickinson. Quand ce dernier les surprend, Blake s’enfuit tout penaud en grenouillère, en laissant deux macchabées dans son sillage. A peine caressé l’espoir d’une vie aisée, le pantin disloqué de Dead Man s’enfonce dans l’abîme. L’anarchie supplante la raison, les semblants d’intrigues se rétractent, les pieds nickelés balaient furieusement les cendres récalcitrantes. Affublé d’une coiffe et d’une robe défraîchies, Iggy Pop fait une apparition cocasse en sauvageon insolite. Jarmusch réunit deux tueurs et deux marshals aux patronymes malicieux : Wilson et Pickett, Lee et Marvin. Dead Man oscille entre un humour désespéré et un pragmatisme résigné. Les légions dispersées sont incapables d’entretenir la moindre conversation. La folie galopante est la seule réponse envisageable à un monde fossilisé. Apaisé par des rites surnaturels, Blake entrevoit un royaume secret. "Je vois les poètes comme des visionnaires hors-la-loi", confie Jim Jarmusch (The Guardian, novembre 1999). Imitant ses précédentes dérives narratives, le cinéaste isole les silhouettes, réitère les incidents, sculpte ses gravures comme il accorderait des instruments. La séquence d’ouverture épouse aussitôt les travellings latéraux de Mystery Train, signature récurrente de Jarmusch. Le passage du fleuve évoque l’échappée belle de Down by Law. Le noir et blanc, magnifié par Robby Müller, reste la texture fétiche. Mais Jarmusch va jusqu’au bout de sa logique déliquescente. Le corps ankylosé de Blake dicte la marche à suivre. Plus les kilomètres s’étirent, plus la pellicule semble s’effilocher. Pareils aux strophes d’un poème, la structure lâche et les fondus au noir matérialisent les évanouissements de Bill. Délaissant les corps putrides et les jeux d’osselets du générique, Dead Man met en lumière une autre héroïne : la musique, instinctive, lancinante, amplement majestueuse. Les improvisations de Neil Young respectent les silences et les entailles du montage. Face à la fuite du sens, le fractionnement du temps et l’éparpillement des rôles secondaires (Jim Jarmusch fait pour la première fois appel à une directrice de casting), les saturations d’une guitare traduisent avec justesse les écarts somnambules de William Blake, toujours plus insistants. L’horizon se dégage peu à peu. Les plans oppressants, au plus près des visages, s’estompent au profit des grands espaces. Nobody et Bill se laissent submerger par une nature ensorceleuse. Dead Man s’achève là où il a commencé: la nacelle en bois qui sert de sépulture est la parfaite antithèse du train, emblème du monde moderne. Délesté de tout balluchon, William Blake est prêt pour un nouveau voyage."
